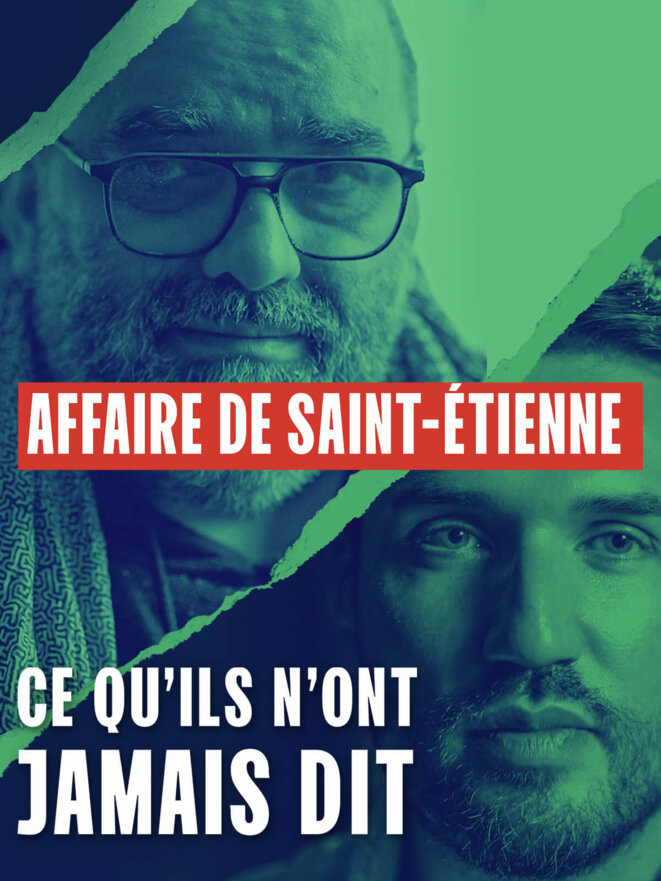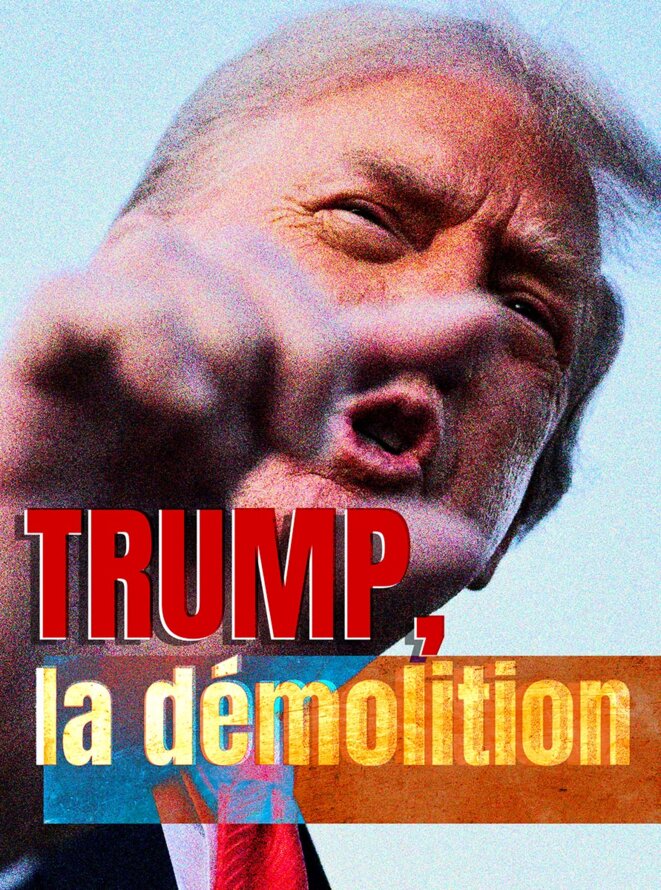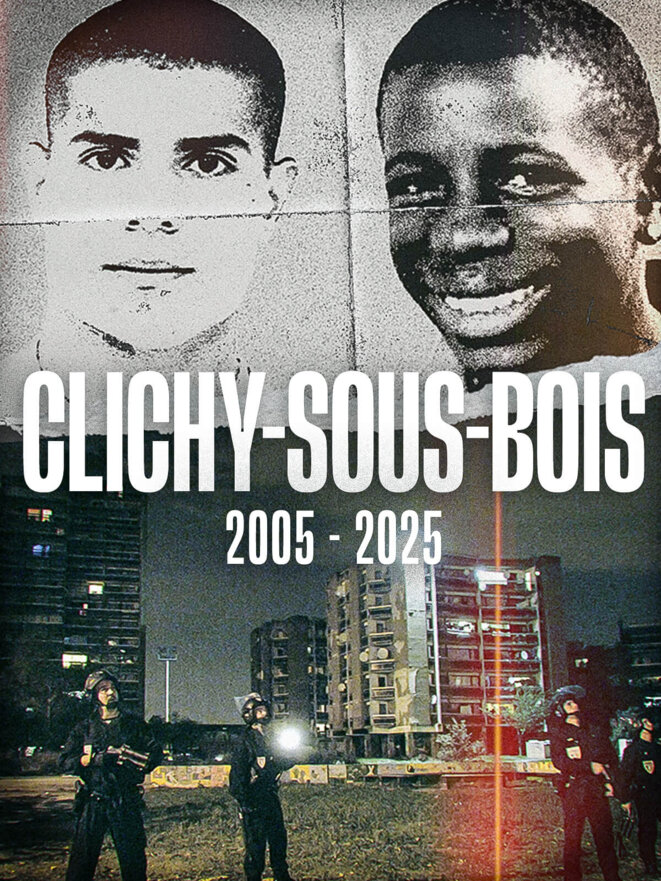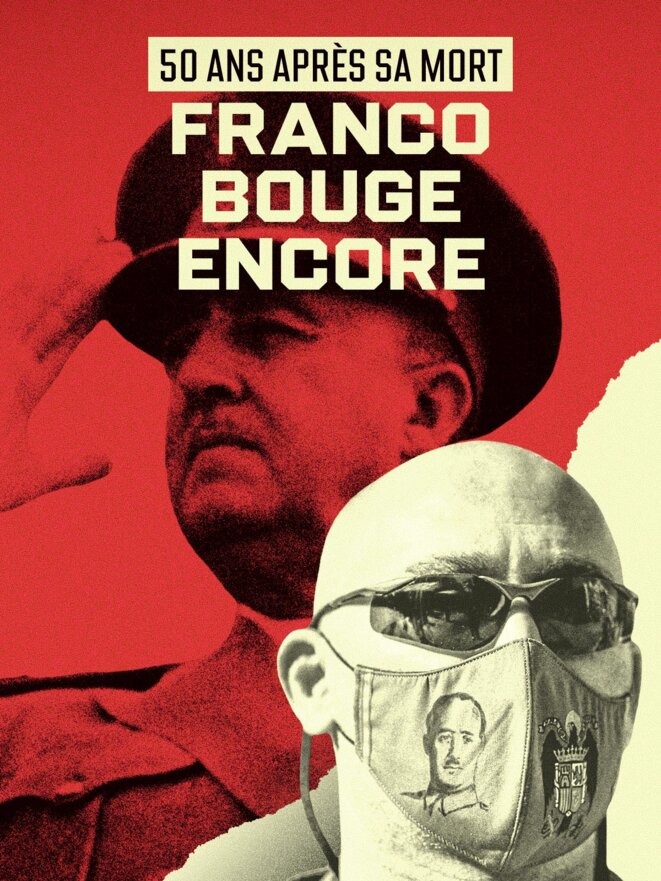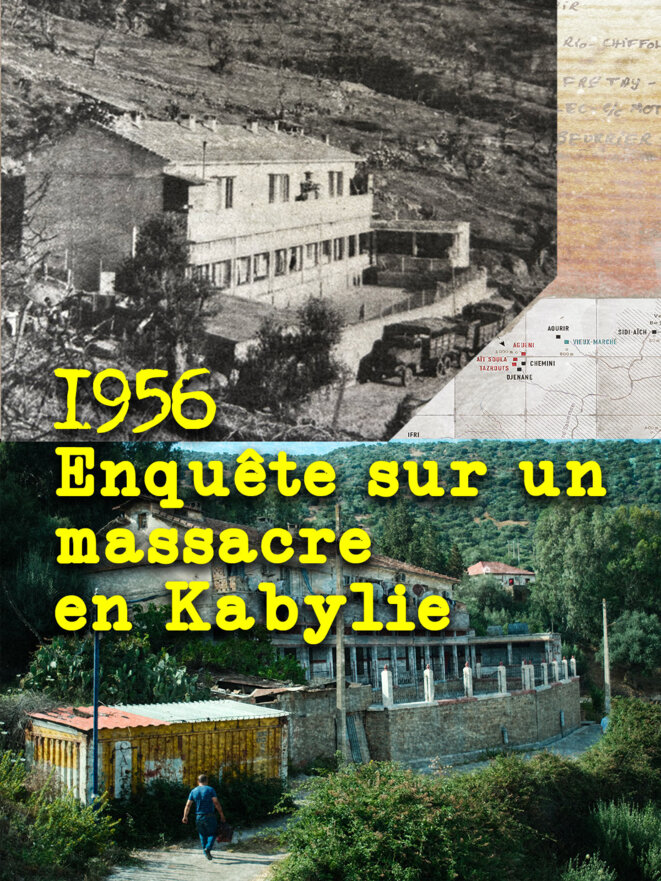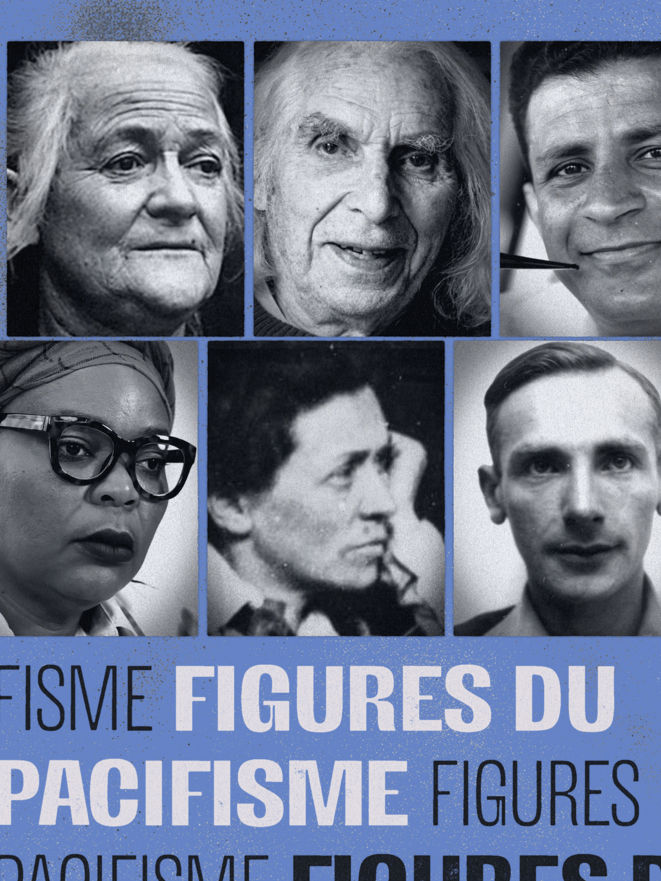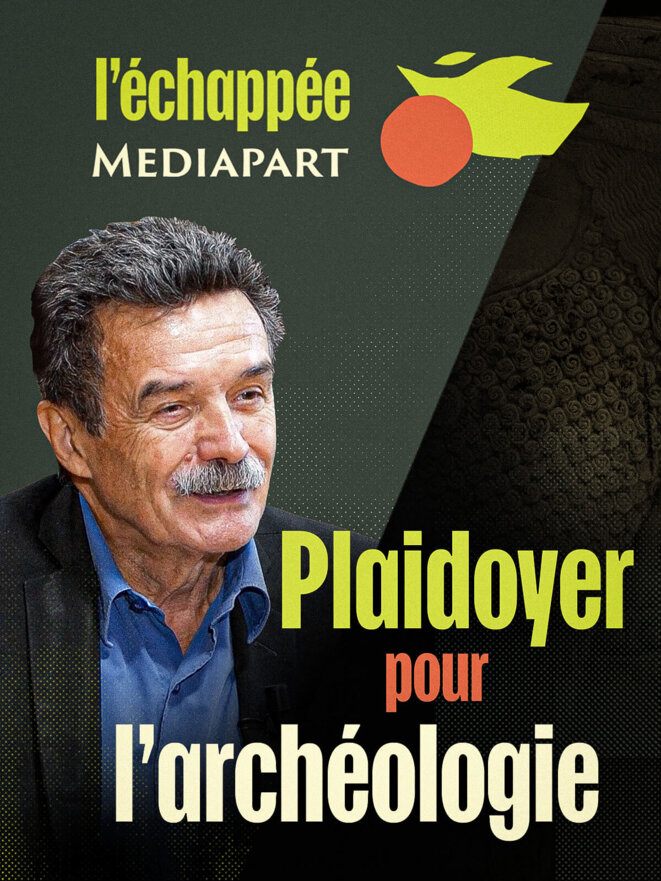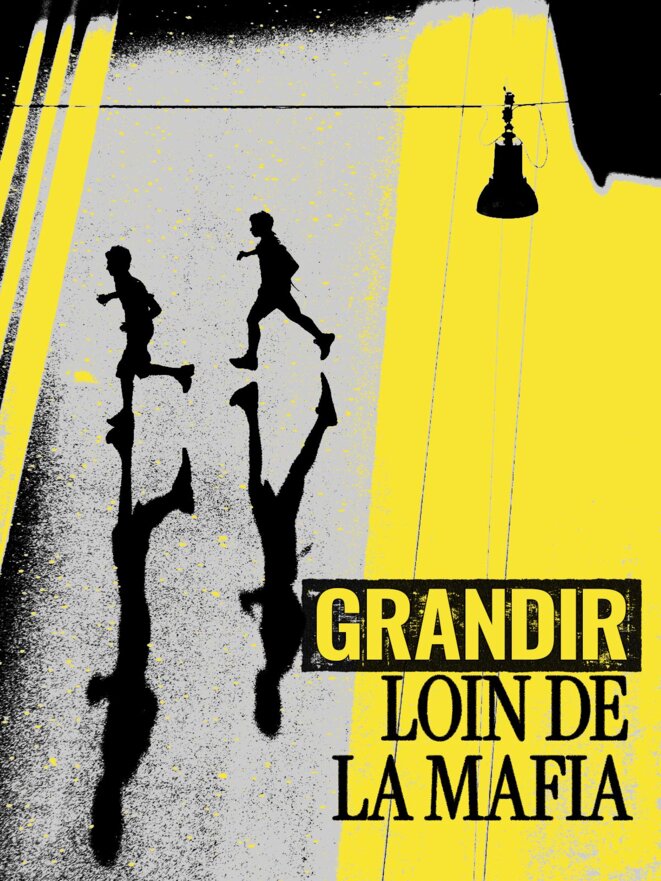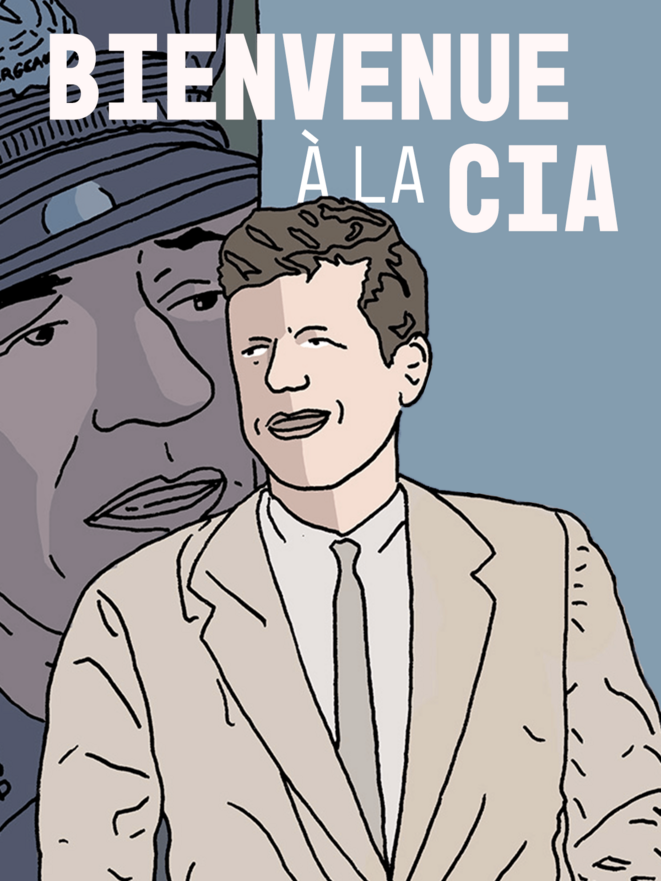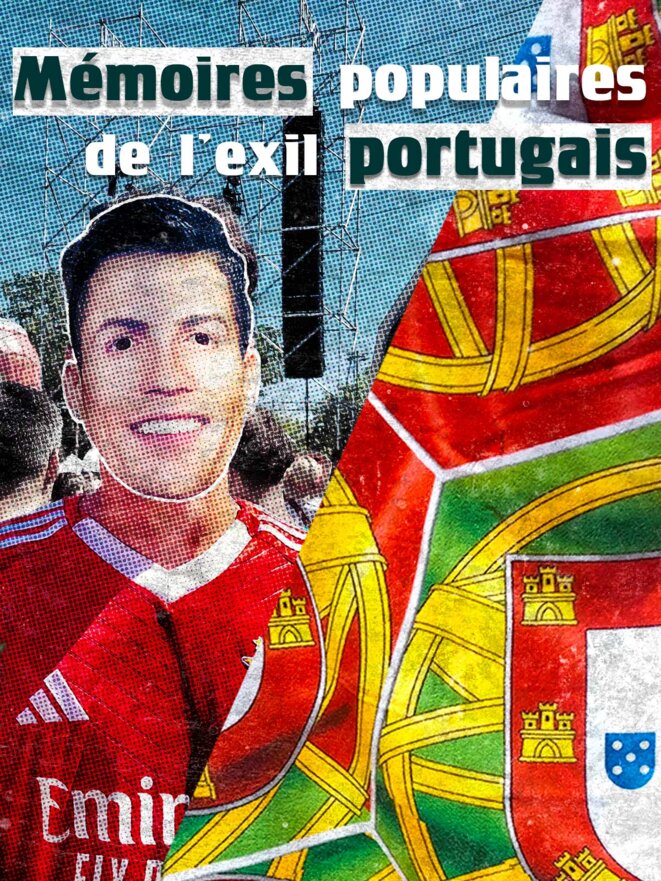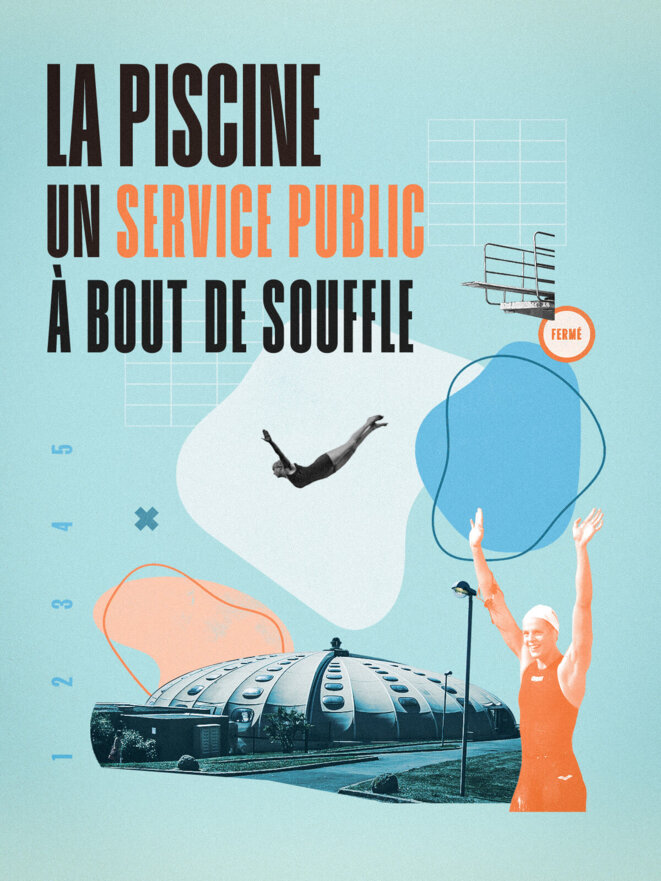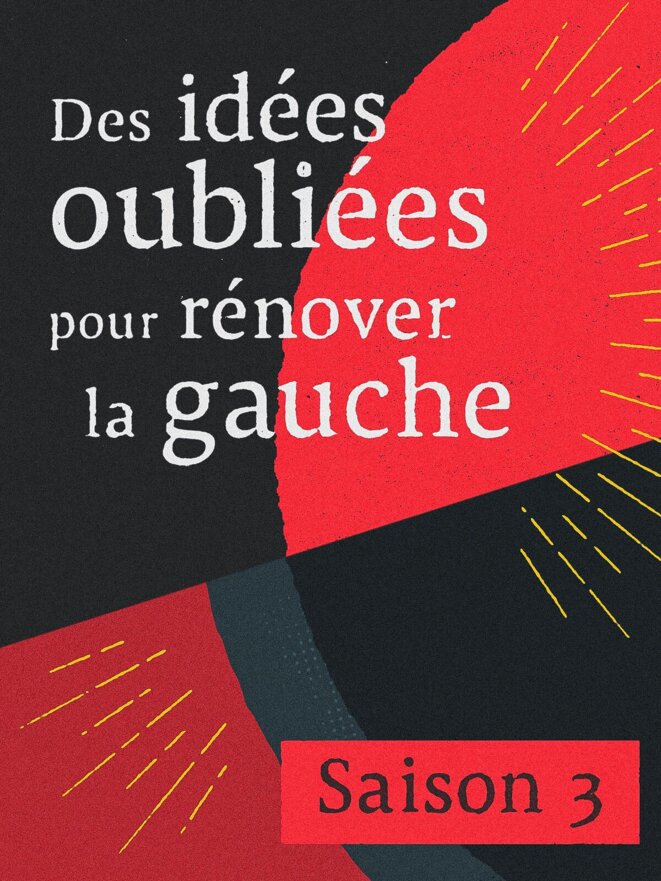Agrandissement : Illustration 1

L'Inconnu du lac, présenté ce vendredi 17 mai dans la section “Un certain regard”, est le premier des films d'Alain Guiraudie à porter un titre littéral. Longtemps, ses moyens et longs métrages s'intitulèrent Du soleil pour les gueux (2001) ou Voici venu le temps (2005), Ce vieux rêve qui bouge (2001) ou Pas de repos pour les braves (2003). Il y a quatre ans, Le Roi de l'évasion avait pour protagoniste le dénommé Armand, évadé métaphorique plutôt que repris de justice, vendeur de matériel agricole tentant de ruser avec toutes les sollicitations du désir pour mieux les retrouver in extremis, dans une scène de sexe dont la douceur et l'évidence annonçaient celles, aussi nombreuses qu’explicites, de L'Inconnu du lac.
L'Inconnu du lac fait donc ce qu'il dit : c'est l'histoire d'un lac et de son inconnu. D'un lac situé quelque part dans le Sud-Ouest, décor de bronzage, de drague et de baise, et d'un bel inconnu à moustache prénommé Michel sortant de l'eau un soir d’été pour subjuguer et tourmenter Franck, habitué du lieu en quête de rencontres. Au temps de Du soleil pour les gueux et Pas de repos pour les braves, les personnages guiraudiens s'appelaient, et c’était merveille, Djema Gaouda Laon, Johnny Goth ou bien Pool Oxanosas Daï. À présent ils ont banalement nom Franck et Michel (tous deux interprétés, il est vrai, par des acteurs aux noms chantants, Pierre Deladonchamps et Christophe Paou, accompagnés d’un troisième, Patrick D’Assumçao, dans le rôle d’un bûcheron séparé de sa « nana »). Leur terre n'est plus quelque improbable pays de cocagne, c’est un lac ordinaire non loin duquel se garent quelques voitures – dont une R25, saluée comme le trésor sauvé de quelque temps révolu – et à la force d'attraction sexuelle et amoureuse assez puissante pour polariser la totalité de l'action.
La fantaisie, le picaresque auraient-ils disparu, et avec eux cette sorte de souffle utopique qui a fait la renommée, et parfois la gloire, du maître de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) ? On pressent que non. La fantaisie est juste passée ailleurs, ou plutôt, puisque c'est de cela qu'il s'agit : elle est passée ici, entièrement ici, en ce lieu que le film ne quitte pas un seul instant. Non sans s'amuser de ce surplace : à qui leur fait remarquer qu'on les croise beaucoup, ces jours-ci, Franck et les autres répliquent en effet qu'ils ne viennent pas si souvent au bord du lac. Ils ont une vie, dont ces heures de baignade et de plaisir n'occupent qu'une petite partie. Sans doute, et tant mieux pour eux. Reste qu’on ne les verra jamais ailleurs : ces intermittences, ces pauses dans la vie sont toute la vie que l’on ne leur connaîtra jamais.
Sous ce drame il y a donc une comédie, à nouveau, et sous ce film un second, virtuel, qui bruisse à chaque intonation, chaque bifurcation de dialogue, chaque évocation d'autres lieux. Mais cette comédie, cet autre film restent un mirage, une possibilité, un reflet pareil à ceux qu'au crépuscule le soleil fait à plusieurs reprises, et toujours superbement, dans l'eau du lac autour duquel rôde notre inconnu. C'est cela qui ravit, dans L'Inconnu du lac : Alain Guiraudie n'a jamais été aussi précis ni aussi direct avec son désir. Son désir de parler du désir, du désir en général et du désir en particulier, spécialement celui qui circule entre les hommes.
Jusque-là, Guiraudie avait toujours eu soin d'imaginer des fables faites, croyait-on, pour mettre des obstacles et des détours sur le chemin de ce désir. Comme si une part essentielle de son invention, et de son intention, narrer des histoires de bandits et de héros, loin d’un cinéma français dénoncé par lui, à ses débuts, comment tristement médiocre, petit-bourgeois, dénué d’horizon, lui avait servi à dissimuler, voire à différer une autre part, peut-être plus essentielle encore : offrir à la France un cinéma du désir homosexuel digne de celui que Pier Paolo Pasolini et Rainer Werner Fassbinder offrirent à l’Italie et à l’Allemagne.
Ici, plus de détour : la ligne est droite, les sexes, les bouches et les culs filmés en gros plan, le désir affirmé d'emblée et répété sans cesse, de cette manière à la fois bonhomme et impérieuse, parfaitement évidente et parfaitement absurde qui fait de Guiraudie, outre un dialoguiste de génie, le plus bienveillant des cinéastes. Plus de détour : le film s'écoule, solaire, aussi calme qu'inexorable. Grand bonheur : si Guiraudie aura éprouvé quelque difficulté à trouver le tempo du long métrage, après le doublé Du soleil et Ce vieux rêve, deux moyens métrages superbes et dûment salués, notamment par Jean-Luc Godard en personne, si Pas de repos et Voici venu avaient quelque peu déçu pour cette raison même et en proportion de l’attente, Le Roi de l’évasion était un premier triomphe, un premier vrai film long. L’Inconnu du lac est le second triomphe, le plus éclatant à ce jour. Dans cette eau et dans ce soleil, dans leurs reflets changeants selon les heures du jour et à l'approche de la nuit, Guiraudie a enfin trouvé l’image temporelle, le rythme qu’il a longtemps cherchés.
Le soleil ni la mort
Qu'il n'y ait plus de détour, que L’Inconnu du lac soit exactement ce qu’il est, qu'il n'ait pas crainte de regarder la vérité en face, et avec elle le soleil et la mort, n’en fait pas pour autant un film dénué de volutes et de vertiges. Bien au contraire. C'est toujours la même répétition badine et pince-sans-rire des mêmes quelques situations, sans rien de chic pourtant, rien d'arrogant ni, justement, de pincé : la rude sagesse du western n'est jamais loin, avec Guiraudie. Baignade, discussion le sexe au vent au bord de l'eau, baise dans les fourrés. Polos rayés, T-shirts de couleurs, bermudas et baskets. Apollons superbement montés et petits gros se tirant dérisoirement la queue entre deux doigts. C'est donc encore le même théâtre égalitaire et souriant où des corps jeunes et sveltes voisinent des corps moins jeunes et plus lourds, Michel et Franck celui du bûcheron Henri, par exemple, venu de ce côté-ci du lac non pour draguer, mais pour le plaisir d’une discussion gratuite, sans engagement.
Le précédent film s'appelait Le Roi de l'évasion, et Du soleil pour les gueux, avec ses « guerriers de poursuite » et ses « bandits d'escapade », mettait en scène Guiraudie lui-même dans le rôle d'un meurtrier de hasard hésitant sans cesse entre rester et partir, fuir et ne pas fuir, ne sachant que faire, « partir aujourd'hui ou rester pour toujours ». Cela encore, le meurtre et la nécessité de fuir, le meurtre et l'impossibilité de fuir, est dans L'Inconnu du lac. C'en est même le cœur. Mais justement c'est un cœur, à présent. Ce n'est plus ce qui écarte sans cesse le film de lui-même dans un jeu parfois vain, souvent excessif, de départs et de retours. C'est au contraire ce qui le mène à l'épure.
C'est au fond assez simple, et d'autant plus fort : Guiraudie cerne au plus près ici, mieux que jamais, ce qui aimante son cinéma. Cela tient, sans doute, à un certain rapport entre désir et histoire, aux deux sens que prend ce mot dans le langage amoureux et dans le langage dramatique. Entre autres difficultés – n'en disons pas trop –, le beau Michel pose en effet à Franck celle-ci : tout exigeant qu’il soit, son désir ne semble pas déboucher sur ce que, justement, on appelle une histoire. Dîner ensemble, dormir ensemble, passer du temps loin du lac, tout cela l'indiffère, tout cela reste au dehors, loin de ces rives, loin de ce havre. Dès lors, L’Inconnu du lac est l'histoire– si l’on peut dire – de ce jeu entre le désir pur, sans histoire, et la possibilité, malgré tout, d'une histoire. Dès lors, ce film montrant l'amour physique comme rarement aujourd'hui est traversé, de manière à la fois narquoise et profondément angoissée, par une question : cela suffit-il ? Ou bien nous faut-il quelque chose de plus, à moi Alain Guiraudie, à mes personnages, à mon cinéma, pour faire une vie, pour faire un film ?

Agrandissement : Illustration 2

C'est pourquoi le film est si drôle, alors qu'il est par ailleurs si grave. Si inquiet, alors qu'il est par ailleurs si souverain. Pourquoi il miroite tant, alors qu'il est par ailleurs si mat. Superbes sont ainsi les instants – autant de gags – où Untel, par exemple un inspecteur de police aussi curieux que bien intentionné, semblant s'étonner du film lui-même, se demande comment un homme peut en désirer un autre si fort sans souhaiter connaître son prénom, son numéro de téléphone, son état civil… Sans entrer avec lui dans rien qui ressemble à un commencement de drame.
Guiraudie a toujours aimé les fables, les réinventions du monde, les personnages incroyables, et sa fantaisie a toujours servi à en exalter les aberrations, les merveilleuses impossibilités. En même temps, elle a toujours également servi à l'inverse, mais jamais aussi bien, aussi nettement qu'ici : suggérer que chaque moment, chaque caresse pourraient avoir sa suffisance, sinon son éternité. Suggérer qu'il pourrait très bien n'y avoir plus d'histoire du tout, ou que toute histoire, si elle est promesse, est également menace. Tout cela pourrait durer indéfiniment, ce ballet de voitures et corps, d'étreintes et de coups, quelque part entre un parking, un bois et une étendue d'eau. La vie, en somme, et le cinéma, pourraient n'être faits que de rencontres et de scintillements : que d'images, et rien d'autre que de cela.
Qu’est-ce qu’un film ? Quel appel nécessaire et désespéré – voyez, entendez le dernier plan – y résonne, l'entraînant sans cesse plus loin, au-delà de sa clôture ? Dans les jours qui viennent, à Cannes et ici même, d’autres cinéastes français succéderont à Alain Guiraudie. Toutes sections confondues et sans garantie d’exhaustivité : François Ozon et Serge Bozon, Claire Denis et Justine Triet, Arnaud Desplechin et Arnaud Des Pallières, Katell Quillévéré et Rebecca Zlotowski, Claude Lanzmann et Marcel Ophuls, Adbellatif Kechiche et Antonin Peretjatko… Connus et moins connus, habitués ou nouveaux venus au festival. Il n’est pas dit d’ailleurs que nous aurons le temps de tous les évoquer. Une chose est sûre : cela fait bien longtemps que la sélection française n’a été aussi riche. C’est donc l’occasion ou jamais de tenter une « Situation du cinéma français », esthétique et politique, à l’heure où celui-ci est secoué par les débats que l’on sait.
Demain (jeudi 16 mai) : Jeune & jolie de François Ozon (“Compétition”).