Nos temps de crise démocratique donnent une nouvelle jeunesse aux anciennes promesses. Ainsi le programme du Conseil national de la Résistance (CNR), adopté dans la clandestinité en mars 1944, mettait-il au chapitre de « l’établissement de la démocratie la plus large » l’exigence non seulement de « la liberté de la presse » mais aussi de « son honneur », c’est-à-dire « son indépendance à l’égard de l’Etat (et) des puissances d’argent ». Le pari réussi de Mediapart, créé il y a quatre ans, le 16 mars 2008, était de prouver l’actualité de ces idéaux. Reste à les inscrire dans la durée.

Agrandissement : Illustration 1
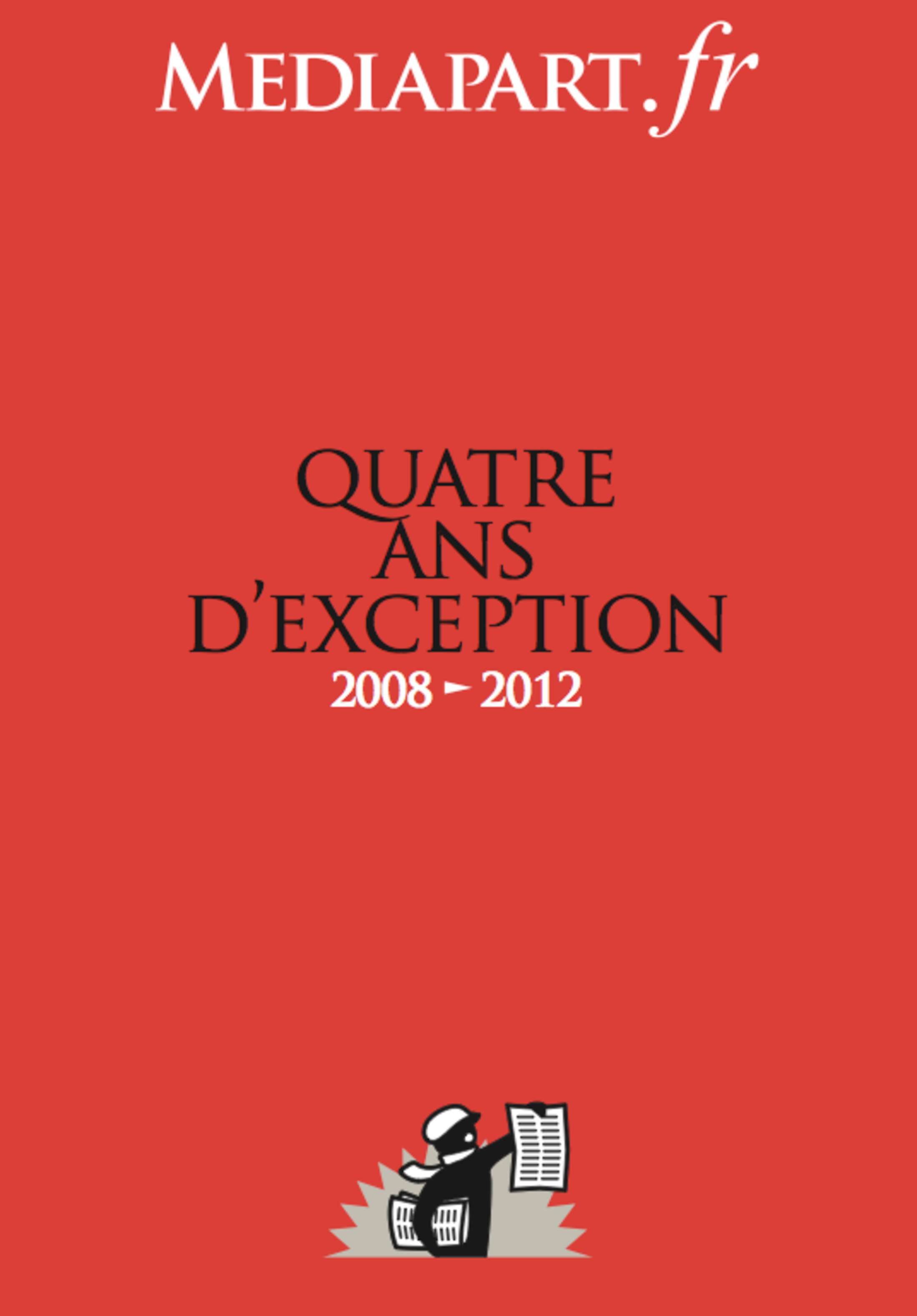
L’évocation de l’honneur de la presse par le CNR était une forme d’injonction morale lancée aux journalistes. Une façon de leur dire qu’ils sont dépositaires, gardiens et serviteurs de principes démocratiques fondamentaux : droit de savoir, pluralisme de l’information, souci de la vérité, respect du public. En d’autres termes qu’il leur revient, à eux aussi, à eux d’abord, de les défendre, sauf à perdre leur honneur, à déshonorer leur profession et leur métier. S’ils se font spectateurs muets et passifs de la dégradation de l’une et de l’autre, ils ne peuvent s’étonner du discrédit qui les frappe.
Dès les premiers jours de la Libération de Paris, en août 1944, Albert Camus, dans ses éditoriaux de Combat, se fit le porte-voix de cette exigence, en des termes qui lui vaudraient sans doute, aujourd’hui, ces moqueries que nous connaissons bien sur l’esprit de sérieux ou les leçons de morale. Ceci, par exemple : « Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Une société qui supporte d’être distraite par une presse déshonorée (…) court à l’esclavage malgré les protestations de ceux-là mêmes qui contribuent à sa dégradation. (…) C’est pourtant notre tâche de refuser cette sale complicité. Notre honneur dépend de l’énergie avec laquelle nous refuserons la compromission. »
L’honneur, donc. Cet honneur retrouvé dont Mediapart a voulu montrer que, loin d’être un idéal vaincu, il restait la seule voie d’un redressement professionnel et d’une renaissance économique pour nos métiers et nos industries. Le journalisme n’a d’autre vocation que le service du public qui a le droit de connaître tout ce qui se fait en son nom afin d’être acteur de la démocratie, libre dans ses choix, autonome dans ses décisions. A l’heure de la révolution numérique, nous avons voulu faire la preuve qu’en cheminant sur cette ligne d’exigence, nous pouvions créer une entreprise de presse innovante, à la fois indépendante et rentable. Indépendante parce que rentable. Mais, surtout, rentable parce qu’indépendante.
Nos résultats, nos chiffres et nos comptes
Comme chaque année à cette date, Mediapart rend publics tous ces chiffres, comptes et données. Vous pouvez télécharger (et diffuser largement) ici en format PDF le dossier de presse qui résume nos quatre ans d’exception. Mediapart vit d’une seule recette, la fidélité de ses abonnés qui étaient près de 58 500 fin 2011 et qui sont, à la date d’aujourd’hui, plus de 62 000. Avec un chiffre d’affaires de 5,1 millions d’euros, que ne grève aucun endettement, Mediapart a dégagé en 2011 un résultat net de 572 349 euros. Régulière et constante, la croissance de Mediapart s’accompagne d’une augmentation de son audience, avec plus d’un million de visiteurs uniques par mois.
Voici les principaux tableaux de ce dossier de presse. D’abord les abonnements et l’audience :

Ensuite le chiffre d’affaires, suivi de toutes les précisions, au centime près, sur les aides et subventions reçues par Mediapart pour les années 2009 et 2010 (nous avons décidé de ne plus en solliciter maintenant que nous sommes rentables) :

Enfin notre bilan comptable et le compte de résultats 2011 (avec Le Canard enchaîné, Mediapart est le seul journal d’information générale à publier chaque année ses comptes, en toute transparence) :

Agrandissement : Illustration 4

L'indépendance, l'enquête et la confiance
L’indépendance, l’enquête et la confiance pourraient être les mots-clés de la réussite de Mediapart. Indépendance d’un journal sans fil à la patte relié à des pouvoirs financiers ou politiques ; enquête placée au cœur de la culture collective d’une rédaction soucieuse d’apporter des informations instructives parce qu’inédites ; confiance de lecteurs associés à cette aventure unique parce que participative et contributive, ouverte à leurs débats et à leurs critiques, à leur pluralisme d’opinions et à leur expertise de citoyens. C’est de cette triple alliance qu’est venue cette réussite qu’il nous faut maintenant rendre solide et durable.
Cela suppose de mettre définitivement à l’abri Mediapart, aussi bien des éventuels aléas de la conjoncture que des appétits suscités par sa réussite. Le premier objectif suppose de continuer, avec votre aide, notre croissance afin d’imposer Mediapart comme la nouvelle presse de référence et de qualité à l’heure de la révolution numérique. Nos objectifs de développement pour 2012, détaillés en décembre dernier dans cet article, ont pour but essentiel de consolider la fidélité de nos abonnés, en les incitant notamment à privilégier l’abonnement par prélèvement automatique sur compte bancaire afin de limiter l’effet négatif des incidents de paiement liés aux cartes de crédit (sur cette question un peu technique, lire ici mon billet de blog).
Quant au second objectif, il est au cœur des réflexions de notre conseil d’administration, dont la composition inscrit dans le marbre l’indépendance de Mediapart par la prépondérance des fondateurs (tous quatre salariés de l’entreprise). Notre actionnariat n’a pas changé depuis notre ultime augmentation de capital, à l’été 2009, avec une majorité contrôlée par les fondateurs et les Amis de Mediapart, ainsi que l’illustre le schéma ci-dessous :

Le pacte qui lie les divers actionnaires de Mediapart comporte une échéance au printemps 2014, qui donne une opportunité de sortie aux investisseurs partenaires qui ont bien voulu nous accompagner dans cette aventure. Nous avons donc deux ans pour essayer d’inventer une solution qui soit conforme à notre engagement de départ : faire de Mediapart une entreprise de presse contrôlée par ceux qui y travaillent. C’est un chantier difficile, et désormais urgent, qui supposera de résoudre diverses questions délicates, tant de droit, de capital et de gouvernance que de calendrier.

Si nous ne connaissons pas encore la réponse, que nous espérons novatrice et efficace, nous connaissons la question qui nous est posée. C’était celle qu’énonçait Albert Camus en 1944 : « Toute réforme morale de la presse serait vaine si elle ne s’accompagnait pas de mesures politiques propres à garantir aux journaux une indépendance réelle vis-à-vis du capital. » C’était aussi celle que posait, au printemps 1968, le premier président de la première société de rédacteurs, celle du Monde, Jean Schwœbel, dans un livre dont le programme est toujours actuel, La Presse, le Pouvoir et l’Argent. Défendant la presse indépendante comme « un service d’intérêt public qui ne soit pas sous la tutelle des pouvoirs publics », il y dessinait les contours de « sociétés de presse à lucrativité limitée et à participation des journalistes ».
Refonder l'écosystème de l'information
Reste que, si Mediapart est à l’évidence une exception dans un paysage médiatique plutôt délabré, il serait bon qu’elle fasse école. Le sympathique compliment qui nous est souvent adressé de faire preuve de courage laisse entendre qu’un journaliste ne pourrait faire dignement son travail qu’à condition d’être courageux, de prendre des risques, de s’exposer dangereusement. Curieuse exigence, tout de même – même si, à Mediapart, nous revendiquons cette énergie des francs-tireurs. Car demande-t-on à des petits poissons qui, face à de gros requins, nagent dans une mer polluée d’être courageux ? Ou bien s’occupe-t-on plutôt d’urgence de dépolluer la mer ?
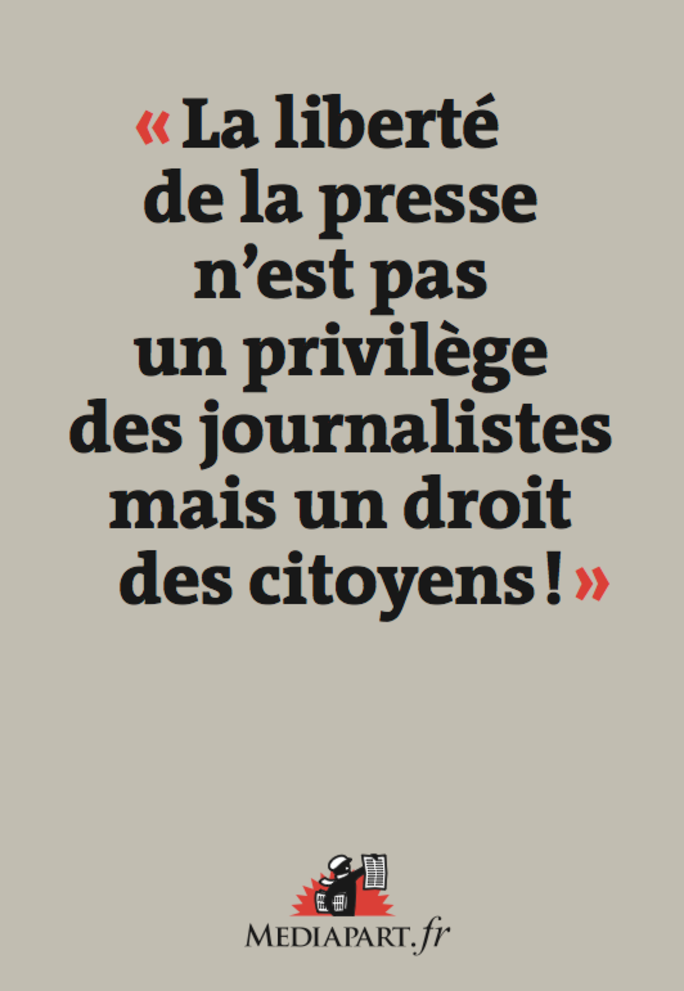
Agrandissement : Illustration 7
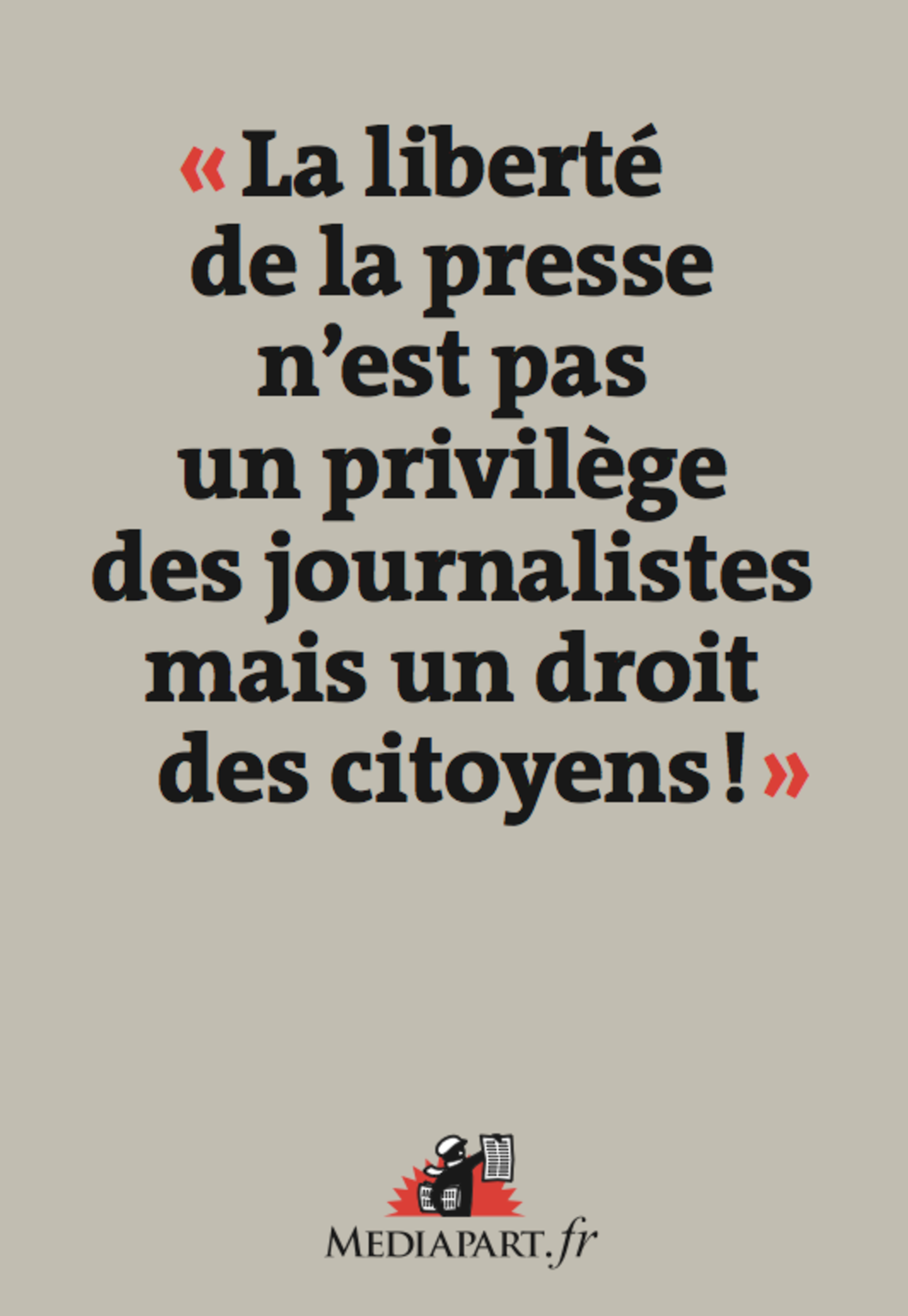
Si les citoyens ne se préoccupent pas eux-mêmes des conditions qui déterminent l’exercice de leur propre droit à une information libre, honnête et pluraliste, qu’ils ne s’étonnent pas du désastreux résultat médiatique qu’ils déplorent. Autrement dit, pour que le journalisme se redresse et que la presse (entendue ici indépendamment de son support) se refonde, il faut changer l’écosystème qui, aujourd’hui, conditionne l’une et l’autre.
Or ce n’est pas la seule affaire des journalistes, mais celle de la volonté populaire que d’en finir avec ce scandale qui fait honte à notre supposée démocratie d’un système médiatique sous la coupe d’industriels extérieurs à nos métiers, corrompu par les conflits d’intérêts et les mélanges des genres, soumis aux pressions aggravées du pouvoir exécutif, dépendant d’aides publiques directes opaques et malsaines, gagné par la course à l’audience et au divertissement qui va avec, tournant de plus en plus le dos à cet objectif ambitieux que fixait Camus, encore lui, à une presse soucieuse de « mettre le public à la hauteur de ce qu’il y a de meilleur en lui » : « Elever ce pays en élevant son langage ».
Comme nous l’avons expliqué lors de la soirée que nous avons organisée, en février, à la Colline en présence de représentants de François Bayrou, François Hollande, Eva Joly et Jean-Luc Mélenchon (voir ici son compte rendu intégral), Mediapart souhaite qu’une nouvelle majorité parlementaire donne le cadre législatif de cet écosystème médiatique vertueux. Nous plaidons pour une loi fondamentale de la même ampleur que celle du 28 juillet 1881 par laquelle la République a imposé la liberté de la presse, dans un contexte semblable au nôtre, de refondation démocratique nécessaire et de révolution industrielle décisive. Lors de cette rencontre, j’en ai expliqué les grandes lignes dans une intervention en forme d’interpellation des forces politiques :
Par sa réussite, Mediapart fait la démonstration que ces questions, posées à toute notre profession, ne sont pas des lubies d’idéalistes déconnectés des réalités. Elles sont au ressort d’une création de valeur saine et durable, prouvant que le journalisme à lui seul peut assurer la survie économique d’une entreprise de presse. L’honneur du journalisme est la garantie de son succès. C’est en ne cédant pas sur sa mission, ses valeurs et ses principes, en défendant farouchement son indépendance, en se mettant au service du public, et de lui seul, qu’il peut espérer créer des emplois, consolider des entreprises, garantir leur solidité.
Préfaçant en 1968 le livre de Jean Schwœbel, le philosophe Paul Ricœur réclamait déjà cette invention politique qui protégerait l’information des ingérences, celles de l’argent et du pouvoir, qui corrompent son nécessaire rôle de « service d’intérêt public ». Et il en soulignait l’enjeu démocratique face au risque que « la direction des affaires soit accaparée par des oligarchies de compétents », lesquels seraient notamment « associés aux puissances d’argent ».
« Partout, insistait-il, c’est la même confiscation. Et tout nous y incline : la complexité croissante des problèmes dans les sociétés industrielles avancées, la paresse des citoyens, leur appétit de bien-être sans trouble de pensée, la commodité des compétents eux-mêmes, l’intérêt des féodalités. La dépolitisation, dans son fond, n’est pas autre chose que cette démission de la plupart, réciproque de la confiscation de la décision par quelques-uns. C’est ici que l’information est condition de démocratisation : car qu’est-ce que la démocratie, sinon le régime qui assure au plus grand nombre – à la limite à tous –, à tous les degrés, la participation à la décision ? »
Démentant momentanément ce sombre pronostic, l’heureux sursaut de Mai 68 n’aura pas suffi à éloigner définitivement ce spectre d’une confiscation. Tout au contraire, il entend bien prendre sa revanche, rôdant avec de plus en plus d’insistance. A nous, à nous tous, là où nous sommes requis, dans nos métiers et nos entreprises, de le conjurer et de le chasser par le secours d’une volonté radicalement démocratique.


