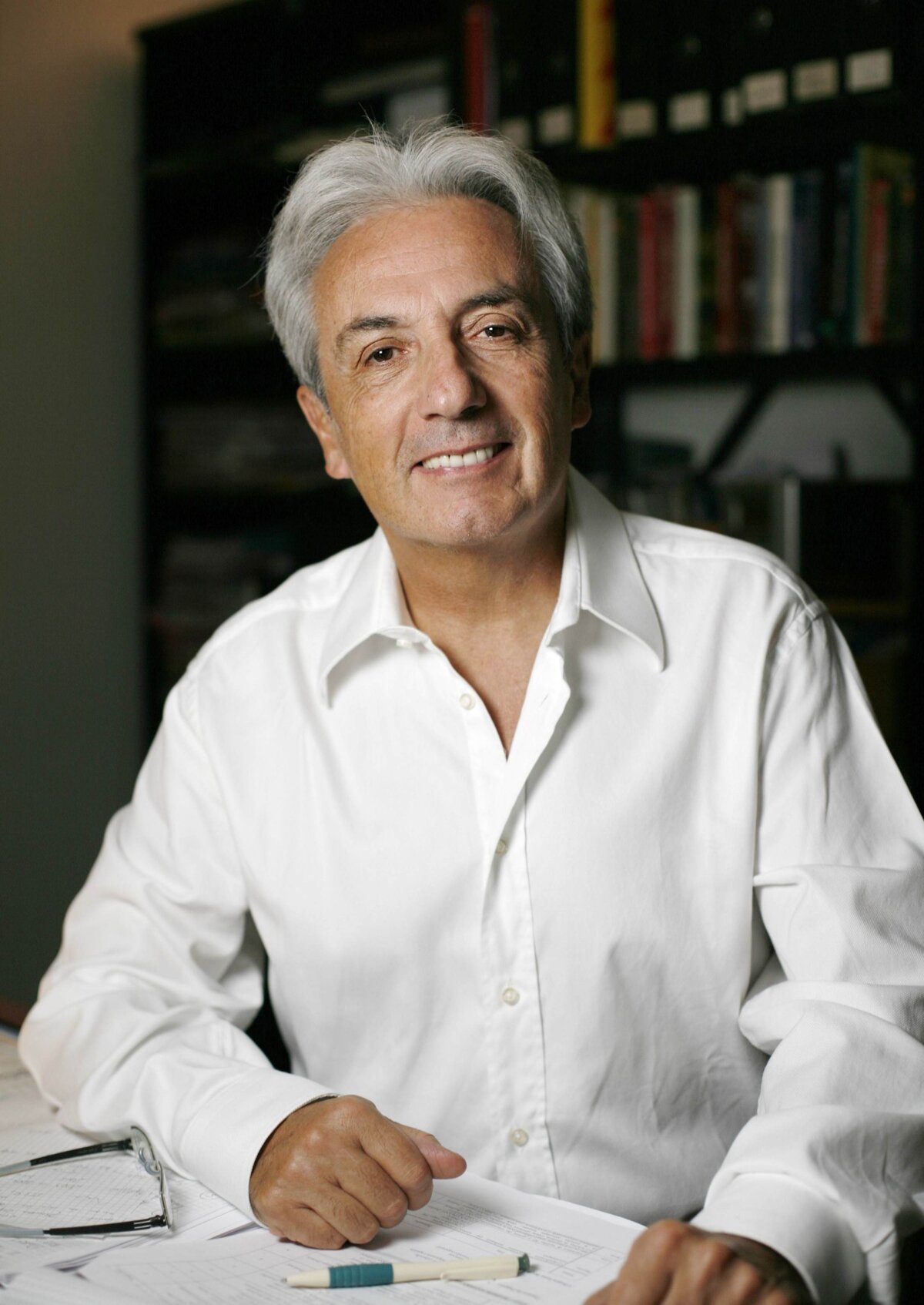
Agrandissement : Illustration 1
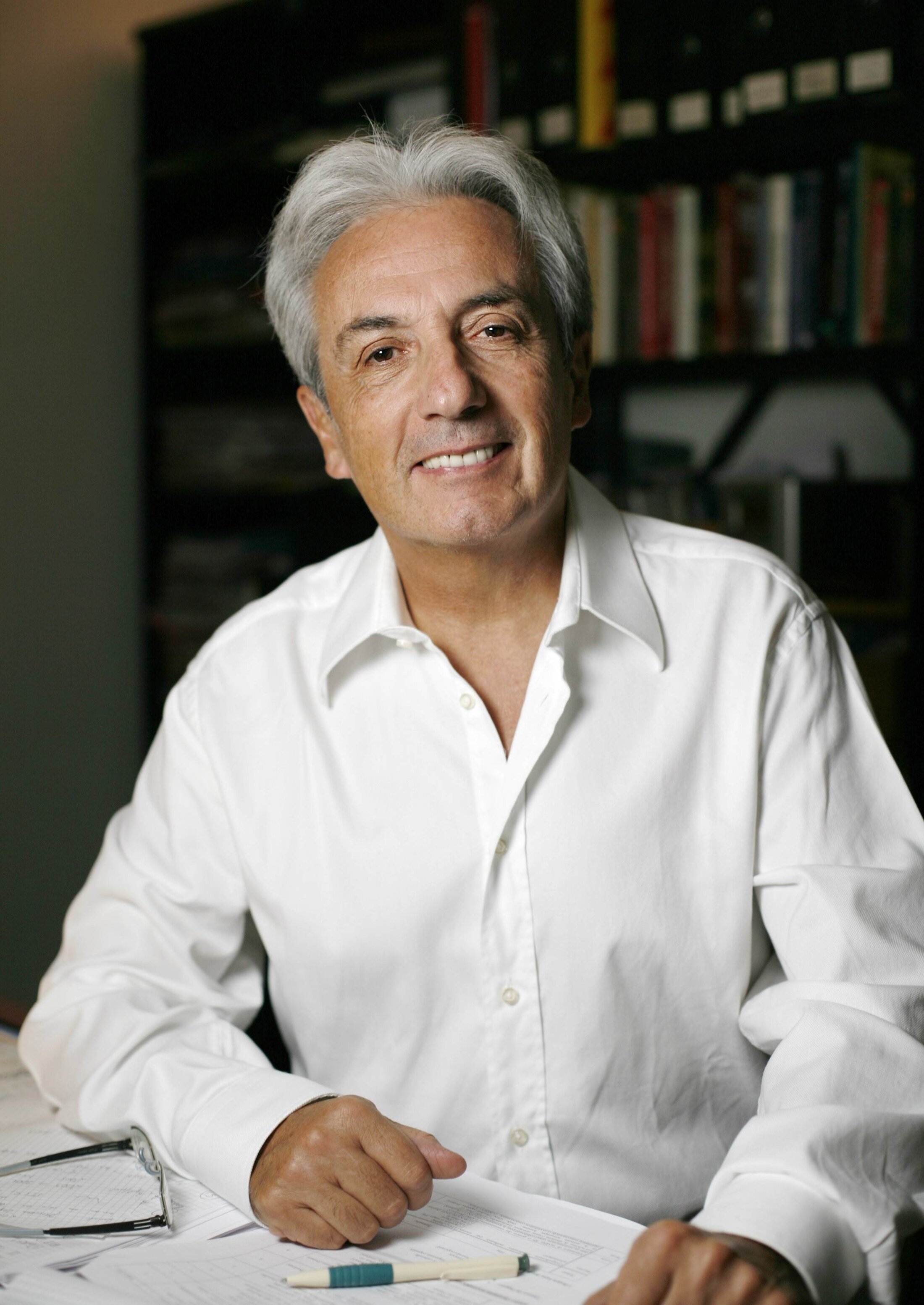
Prix Nobel de physique en 2007, Albert Fert n'est pas seulement l'un des plus prestigieux scientifiques français : il est aussi un témoin privilégié de la réforme en cours de la recherche. C'est lors d'une cérémonie d'hommage au physicien que Nicolas Sarkozy a prononcé son discours programmatique sur la recherche, annonçant la transformation du CNRS en agence de moyen (lire également l'onglet "Prolonger").
Il prend aujourd'hui la parole pour défendre le CNRS, principal "moteur" de la recherche hexagonale. Il pose des conditions à sa transformation en instituts, s'inquiète d'un financement à trop court terme et, s'il reconnaît au politique le rôle de fixer des priorités à la recherche, il s'oppose au pilotage des orientations scientifiques par les gouvernants. Surtout, il replace la réforme du CNRS dans le contexte de la profonde mutation du monde international de la recherche.
Que pensez-vous de la réforme en cours du CNRS?
On ne peut parler de réforme du CNRS sans expliquer le contexte. En fait, on est dans un long processus. La mutation du système de recherche français a commencé en 2006 avec la création de l'Agence nationale de la recherche (ANR) et de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES). Puis, elle s'est poursuivie en 2007, avec la loi dite d'autonomie des universités (LRU). De son côté, le CNRS se transforme pour s'adapter à ce nouveau paysage.
Extrait audio : à quoi sert le CNRS?
Ces réformes vont dans le sens de la constitution d'une «économie de la connaissance». Que pensez-vous de l'idée que la recherche doive se mettre au service de la croissance économique ?
Notre économie a besoin d'une recherche performante. Il est clair, par exemple, que nous résisterons à la concurrence des pays asiatiques dans le domaine des industries de haute technologie si nous conservons notre avance dans les recherches de pointe.
Mais tout se tient. Il faut d'abord des recherches fondamentales, a priori éloignées des applications, mais qui sont le socle de recherches plus finalisées. Délaisser les premières c'est stériliser les secondes. Et puis il y a également les sciences du vivant et ses applications en médecine, et aussi des domaines de recherche, par exemple en astrophysique, physique des particules, archéologie, histoire, etc., que l'on doit développer simplement pour faire progresser la connaissance du monde dans lequel nous vivons.
La nécessité d'un équilibre entre ces divers types de recherche est partagée par l'ensemble de la communauté internationale de la recherche.
Cette économie de la connaissance passe par la création d'indicateurs de performance, le financement sur projet et appels d'offres, la contractualisation... Ces nouvelles formes de management vous semblent-elles en mesure de renforcer la recherche ?
On peut amener de nouveaux outils, l'ANR et l'AERES par exemple, mais il faut les introduire intelligemment après une analyse des forces et des faiblesses du système précédent. En bref, il faut amener de nouveaux outils tout en conservant les meilleurs outils actuels. De mon point de vue de scientifique (de scientifique travaillant dans un laboratoire à l'interface entre recherche publique et entreprise), un très bon outil, à qui l'on doit la qualité de notre recherche aujourd'hui, est le CNRS.

Quand vous avez reçu le Prix Nobel l'année dernière, vous avez déclaré que dans un système financé par l'ANR, vous n'auriez pas trouvé d'argent pour vos recherches. Condamnez-vous ce système ?
Une agence comme l'ANR est utile. Un financement sur projet est un levier pour impulser des axes (les thèmes sélectionnés par l'ANR) où ont été identifiés des besoins de la société. Egalement il stimule l'émulation entre les équipes.
Pour en revenir aux recherches qui ont été récompensées par mon prix Nobel, une ANR n'aurait pas connu l'idée nouvelle d'une électronique exploitant le spin de l'électron et n'aurait pas programmé de thème sur cet axe. Au CNRS, la possibilité d'un dialogue direct entre chercheur et Direction scientifique m'a permis d'expliquer mes idées et d'obtenir les financements nécessaires.
Avec une agence comme l'ANR, j'aurais pu essayer d'être financé dans la catégorie de projets hors thème (« projets blancs »), mais avec la faible proportion de financements de projets blancs dans l'ANR d'aujourd'hui (moitié moins qu'à la National Science Foundation américaine), mes chances pour un projet hors des modes auraient été faibles. Un financement sur projet ponctuel peut aussi disperser les efforts.
Coordonner l'activité d'un labo n'est pas facile si chaque équipe a envie d'aller chercher du financement sur les derniers thèmes « à la mode ». Je ne veux pas cependant être trop critique pour une ANR encore jeune et imparfaite. Je dirai seulement que l'ANR ne peut remplacer un organisme comme le CNRS pour coordonner la recherche au plan national et structurer les labos. L'argent public sera mieux utilisé si on arrive à un équilibre entre financement par des organismes comme le CNRS et financement ANR (avec aussi plus de projets blancs à l'ANR).
"Le CNRS est plus ouvert que d'autres organismes"

Agrandissement : Illustration 4

Nicolas Sarkozy à l'université Paris-Dauphine
Le président de la République a dit vouloir mettre l'université au centre de notre dispositif de recherche. Est-ce une bonne idée?
Dans la situation actuelle en France, une très grande partie des meilleures recherches est réalisée dans des laboratoires mixtes CNRS/Université. Cependant, l'appauvrissement des universités, l'alourdissement des charges d'enseignement et quelques autres facteurs font que les universités n'ont pas les moyens d'intervenir fortement dans la politique scientifique de ces laboratoires mixtes.
Le CNRS en est le moteur principal, en coordonnant également la stratégie de l'ensemble des labos mixtes au plan national. L'objectif affiché est d'avoir des université autonomes capables de renforcer leurs points forts en recherche et, en particulier, de piloter d'égal à égal avec le CNRS la politique scientifique des laboratoires mixtes CNRS/Université.
La mise en place de la loi d'autonomie des universités (LRU) est en cours (parfois avec des difficultés) et la fin du processus est prévu pour 2010. On peut espérer que les universités, tout au moins certaines, pourront dans quelques années être des moteurs dans les laboratoires mixtes, à égalité avec le CNRS et autres organismes. Cela peut cependant prendre un certain temps, on ne fabrique pas Harvard ou Berkeley en quelques années.
Ce que je reproche à certains discours de nos dirigeants, c'est de supposer que, à coup sûr, les universités autonomes seront très bientôt capables d'une politique scientifique clairvoyante et efficace et que l'on peut déjà enlever au CNRS certains leviers de son pilotage. Quand on a un bon outil, il faut le conserver précieusement tant que l'on n'a pas testé les nouveaux outils.
Extrait audio : les universités peuvent-elles remplacer le CNRS?
Je voudrais ajouter qu'il y a aujourd'hui un certain consensus pour aller vers une mixité plus grande entre CNRS et universités, en particulier entre carrières de chercheur et d'enseignant-chercheur. Dans des domaines de recherche impliquant des technologies lourdes, des charges d'enseignement trop importantes (3 fois plus qu'à mes débuts) font que beaucoup de jeunes enseignants-chercheurs ne peuvent s'investir suffisamment dans leur recherche pour réellement prendre place dans la compétition internationale.
Le CNRS envisage la création de « chaires CNRS », postes d'accueil qui devraient permettre à de jeunes enseignants-chercheurs de s'investir pendant cinq ou dix ans sur leur projet de recherche.
Occupation du CNRS, le 19 juin 2008 :

Qu'est-ce que la création des instituts va apporter au CNRS ?
Cela dépend du statut de ces instituts. La condition essentielle est que le CNRS garde la possibilité d'une politique d'ensemble et d'actions interdisciplinaires (transverses entre instituts de différentes disciplines). Les avancées se font souvent à l'interface entre deux domaines. Il est important que subsiste une direction scientifique du CNRS forte qui puisse coordonner ces actions interdisciplinaires.
Les conditions pratiques, c'est que le CNRS garde un budget global, que les directeurs d'instituts soient nommés sur propositions de comités scientifiques internationaux et non directement par le pouvoir politique. On attend encore des garanties sur ces points.
Extrait audio : des instituts pour quoi faire?
Vous avez l'air réservé.
Le discours du ministère n'a pas toujours été parfaitement clair sur le statut des instituts. Il a provoqué la révolte d'un certain nombre de personnes inquiètes que le CNRS ne puisse avoir l'autonomie qu'ont les organismes semblables dans les pays développés (l'Institut Max Planck en Allemagne par exemple).
La concertation avait bien commencé. Mais le processus s'est bloqué sur des problèmes particuliers, par exemple au sujet des sciences du vivant. Elles sont développées au CNRS mais aussi à l'Inserm et à l'Inra. C'est donc assez compliqué puisque l'institut est supposé avoir une action de pilotage sur l'ensemble de ce domaine.
Il y a eu une déclaration un peu maladroite de Valérie Pécresse qui a pu laisser supposer que le CNRS aurait un département et non un institut en biologie, et que peut-être cet institut serait centré sur l'Inserm. Depuis, la concertation entre ministère, direction du CNRS et représentants de notre communauté a repris et on peut espérer des résultats positifs. Par contre, il me semble certain que des actions comme le blocage du conseil d'administration du CNRS, envisagé par certains, ne pourra rien amener de positif pour notre communauté.
L'un des arguments en faveur des instituts est de dire qu'ils amélioreront la visibilité du CNRS. Le CNRS est-il aujourd'hui invisible à l'étranger ?
Le CNRS n'est pas du tout invisible à l'étranger, il est vu très favorablement, beaucoup plus que les universités. C'est plus une question de visibilité interne, des instituts coordonnant au plan national la recherche dans une discipline pouvant permettre au pouvoir politique une vision plus globale.

Agrandissement : Illustration 8

Valérie Pécresse
Valérie Pécresse dit aussi qu'aujourd'hui le CNRS est trop fermé sur lui-même. A quoi et comment les instituts pourraient-ils l'ouvrir ?
Le CNRS est beaucoup plus ouvert que d'autres organismes, la plus grande partie de ses laboratoires sont « mixtes » : laboratoires mixtes avec des universités, le CEA, l'INSERM, des entreprises (comme celui où je travaille), des laboratoires d'autres pays européens ou non-européens, etc.
Les «chaires CNRS», dont j'ai déjà parlé, vont aussi dans la direction de plus de mixité entre les fonctions d'enseignant-chercheur et de chercheur. Cependant le concept d'institut national pourrait éventuellement renforcer le rôle de coordination dans une discipline donnée.
Pas assez de liens entre public et privé

Agrandissement : Illustration 9

Vous appartenez à une unité mixe de recherche CNRS-Thalès-université Paris-11 : le manque de coordination entre recherche publique et industrie vous semble-t-il lié à la manière dont la recherche publique est organisée ou à la culture de l'industrie française?
Albert Fert, pendant une conférence en Italie, juillet 2007
Le manque de coopération entre recherche publique et privée est un problème en France. Traditionnellement, les deux communautés, ingénieurs d'entreprises et chercheurs publics, suivent en grande partie des formations séparées, écoles d'ingénieurs et universités. La proportion de docteurs titulaires de thèses dans les entreprises françaises est beaucoup plus faible qu'aux Etats-Unis.
Si nous avons pu créer le labo mixte CNRS/Thales, c'est parce que la compagnie Thomson CSF – devenue Thalès depuis – avait une tradition de collaboration avec l'université. Je connaissais beaucoup de ses ingénieurs qui avaient fait leur thèse à l'université d'Orsay, avec moi ou d'autres collègues. Ce type de liens entre public et privé n'existe pas dans beaucoup d'autres secteurs de l'industrie française. Malgré la bonne volonté des deux côtés, il y a un fossé difficile à franchir et un frein à la transmission de connaissances.
Je plaide pour que le diplôme de doctorat soit plus reconnu, notamment financièrement, dans les entreprises françaises, ce qui inciterait plus d'élèves d'écoles d'ingénieurs à préparer un doctorat et devenir ainsi familiers de la communauté de la recherche. Cela inciterait aussi plus d'universitaires à aller vers les entreprises.
Au niveau de mon laboratoire, la plupart des anciens doctorants ou post-docs travaillant aujourd'hui dans l'industrie sont partis à l'étranger, à part ceux qui avaient un diplôme d'ingénieur et qui ont trouvé leur place dans l'Hexagone. Rapprocher les écoles d'ingénieurs des universités et de leurs laboratoires pourrait être une deuxième étape de la transformation du système français.

Agrandissement : Illustration 10

Manifestation de chercheurs contre le discours de Nicolas Sarkozy à l'université de Paris-Sud (Orsay), le 28 janvier 2008.
Le système de recherche français vous semble-t-il «vieux», menacé de «balkanisation» et de «paralysie» comme l'a décrit Nicolas Sarkozy dans son discours en hommage à votre Nobel ?
Nicolas Sarkozy a été un peu provocateur. Dans le domaine que je connais le mieux, je peux garantir que la recherche français est à un très bon niveau, c'est-à-dire au niveau de la recherche des Etats-Unis, du Japon et des meilleurs pays européens.
Parmi les prix Nobel de physique, depuis 1990, il y a eu quatre Français (Pierre-Gilles de Gennes, Georges Charpak, Claude Cohen-Tannoudji et moi-même), six Allemands et, je crois bien, il n'y a pas eu de Britannique. Si l'on veut comparer Europe et le reste du monde: sur les six prix Nobel cette année, quatre étaient européens. Par ailleurs, je sais que nos post-docs sont extrêmement cotés aux Etats-Unis.
Il y a en France un problème de transmission entre recherche publique et entreprises. C'est lié essentiellement à la formation différente des deux communautés. Je peux cependant certifier que, chez les chercheurs du public, l'état d'esprit n'est plus celui des années 60 et 70 : les gens sont conscients que la recherche peut servir l'économie. Avoir des recherches qui aboutissent à des applications, c'est de toute façon très valorisant pour un chercheur dans la communauté internationale de la recherche.
Extrait audio : la recherche française est-elle de bon niveau?
Compte tenu de cet enjeu de rayonnement international, êtes-vous favorable à une recherche pilotée par le politique comme le souhaite Nicolas Sarkozy, qui expliquait dans son discours d'Orsay du 28 janvier : «C'est bien au Parlement, au gouvernement, et particulièrement au ministère en charge de la recherche, qu'il appartient (...) de fixer les orientations stratégiques» de la recherche ?
Je n'y suis pas favorable et, par ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit exactement l'idée de Nicolas Sarkozy. Dans tous les pays de recherche de pointe, il y a autonomie du scientifique par rapport au politique. Le politique détermine le enjeux sociétaux, décide d'axes prioritaires (énergie, cancer, etc.), fixe les budgets généraux et évalue les résultats globaux. Mais il n'est pas apte à établir une stratégie scientifique de recherche.
C'est la communauté scientifique qui, en faisant remonter des idées et en les analysant, détermine comment les priorités du pouvoir politique peuvent se traduire en stratégies scientifiques. Il faut, par exemple, prendre en compte les recherches à long terme qui ne peuvent se décrire comme un chemin en ligne droite vers un application bien identifiée. Il faut aussi prendre en compte la nécessité de recherches destinées à simplement repousser les frontières de la connaissance.


