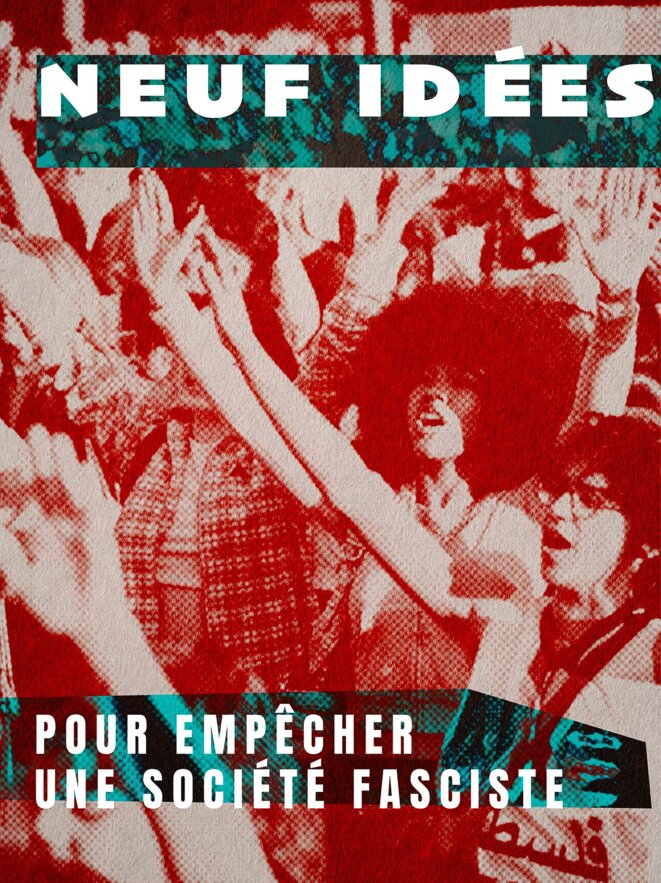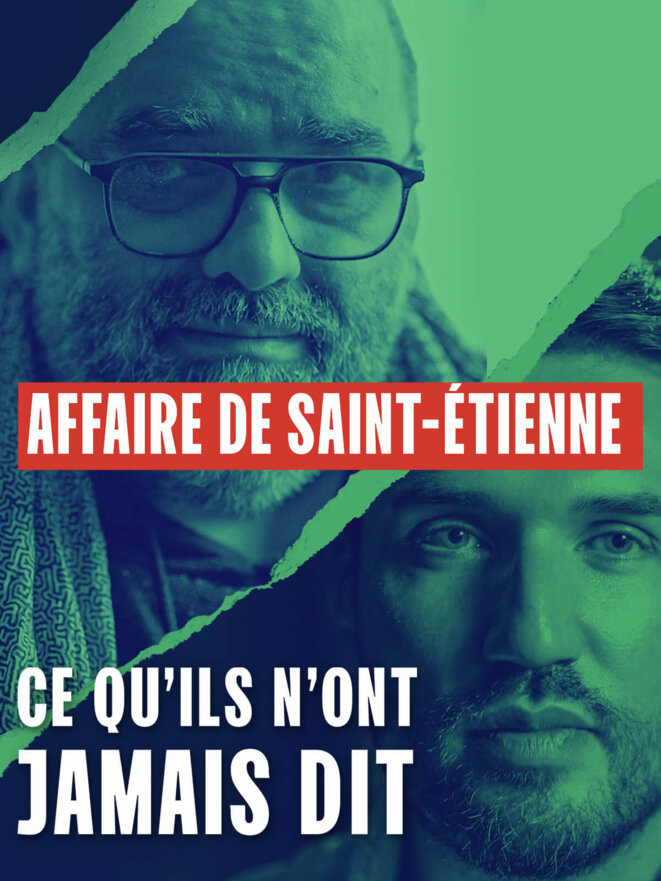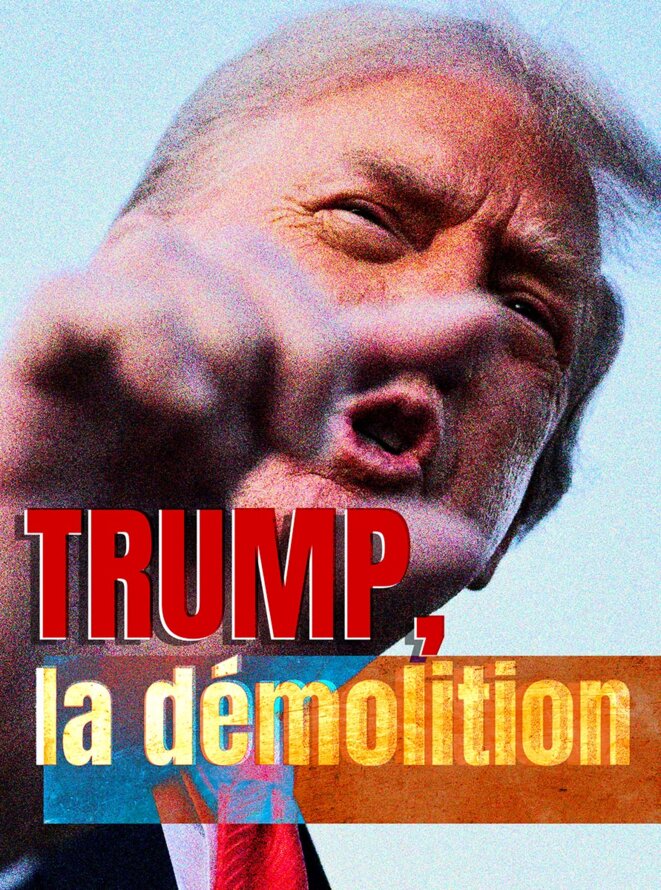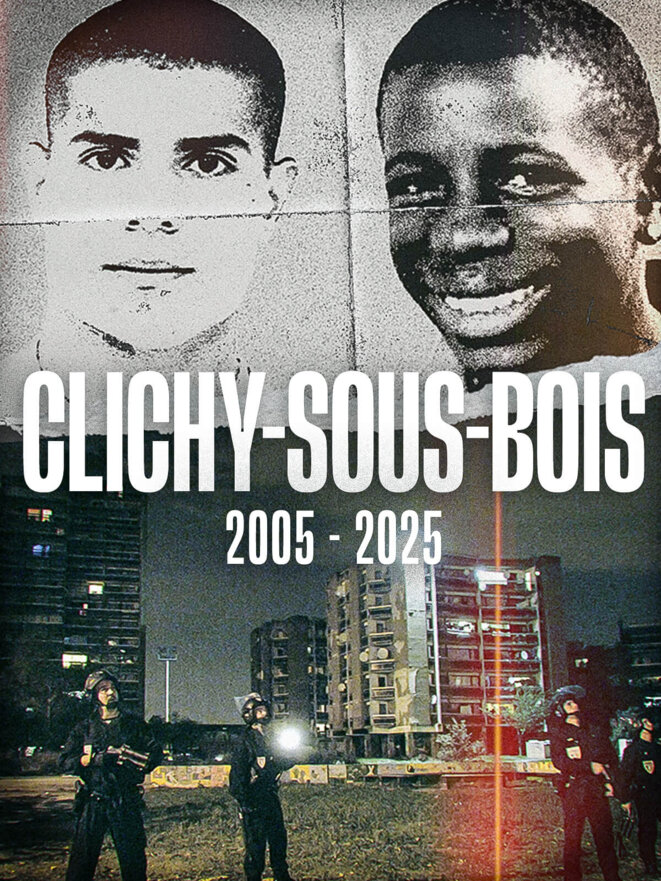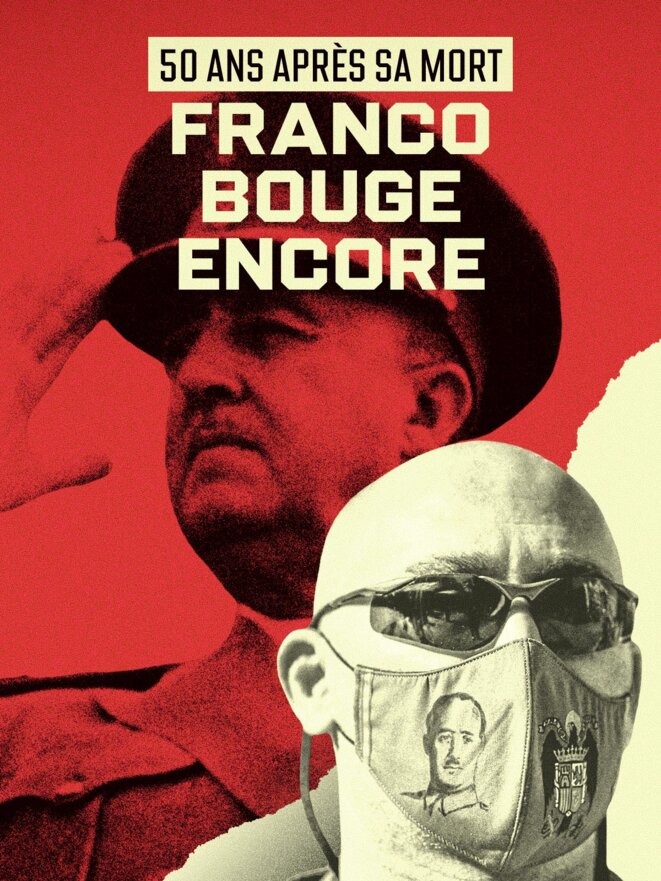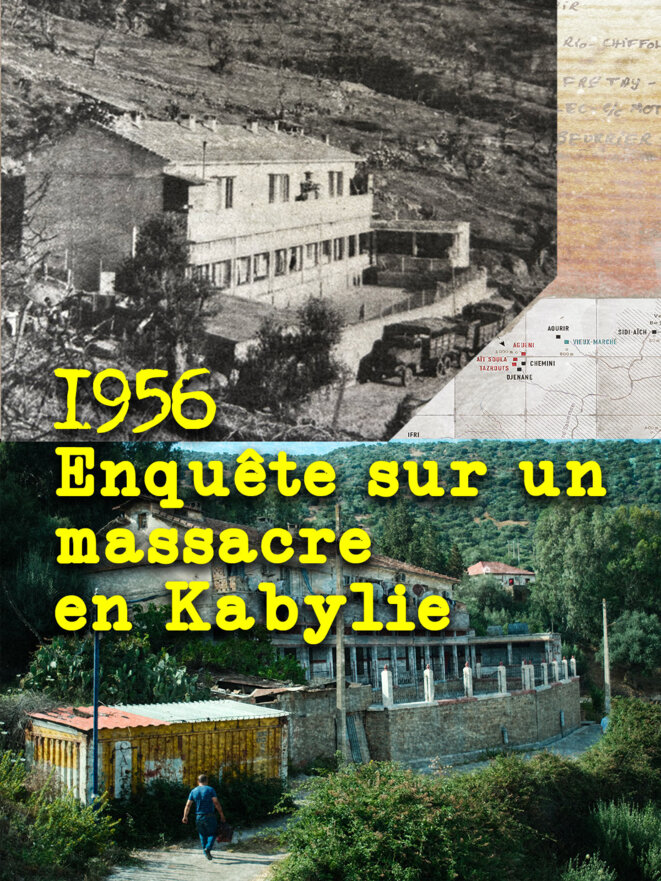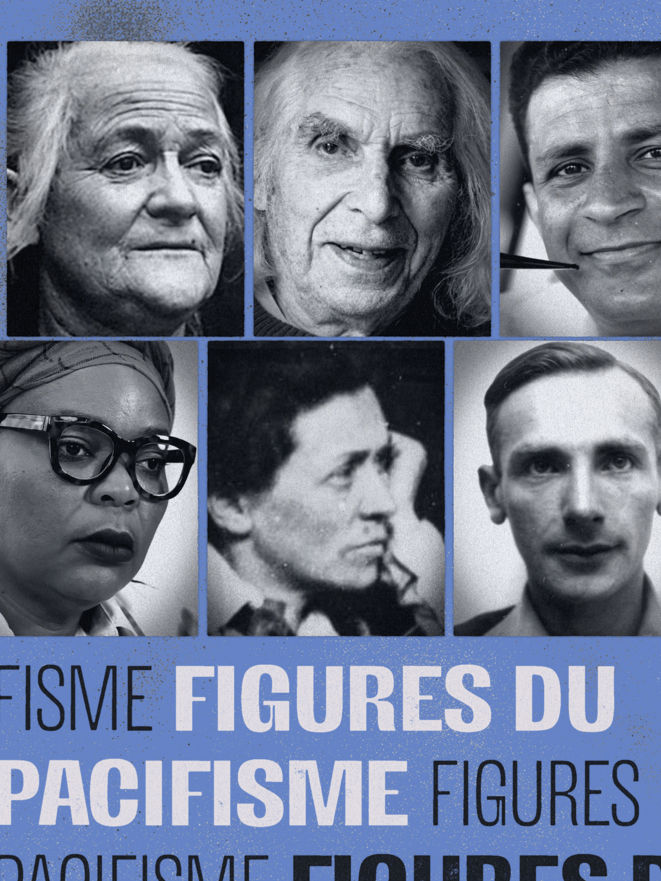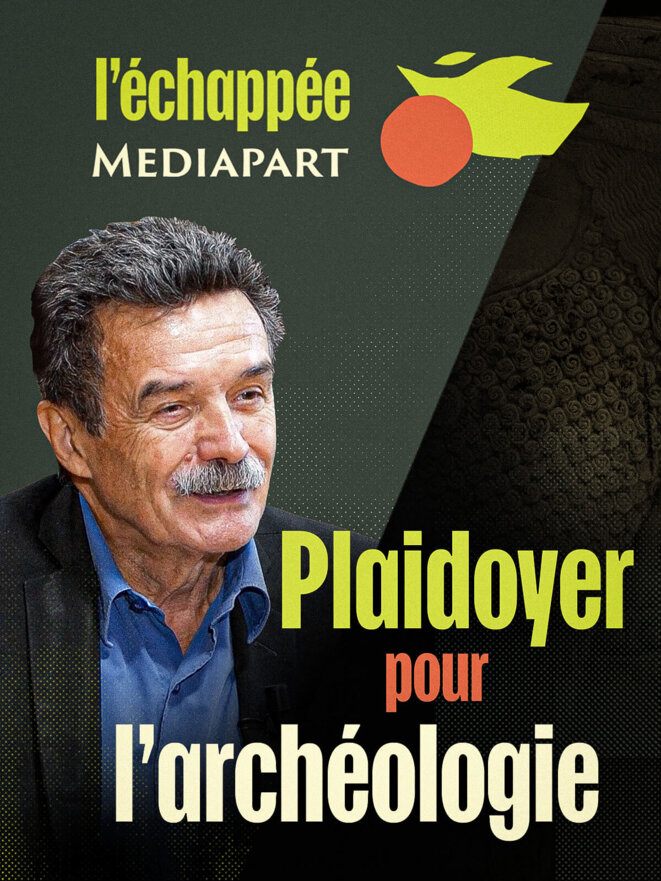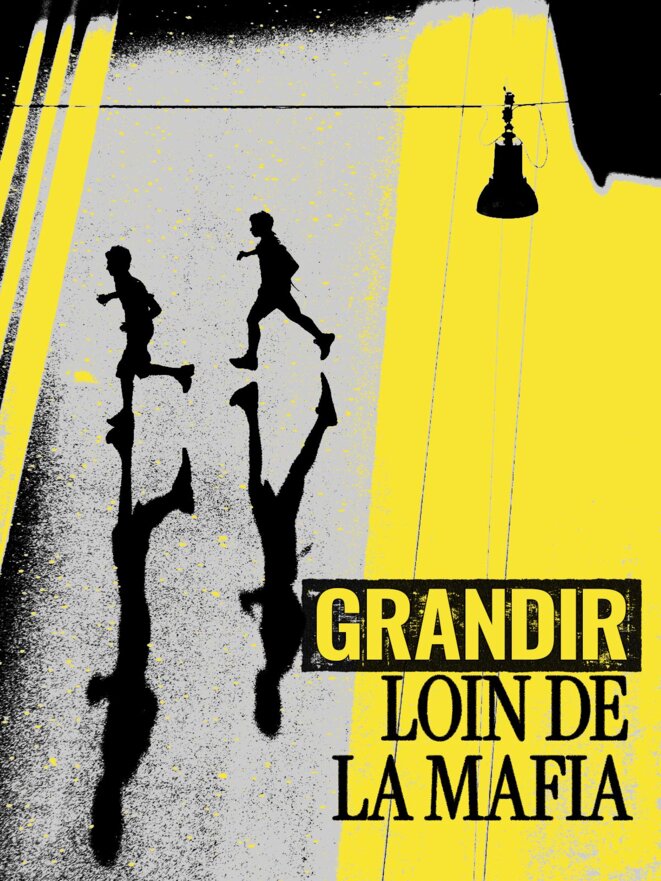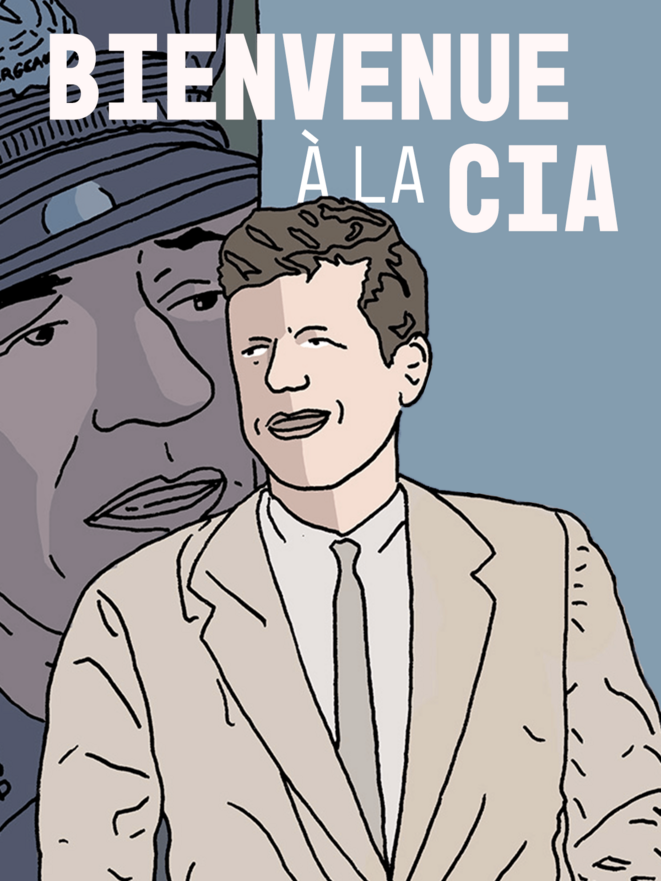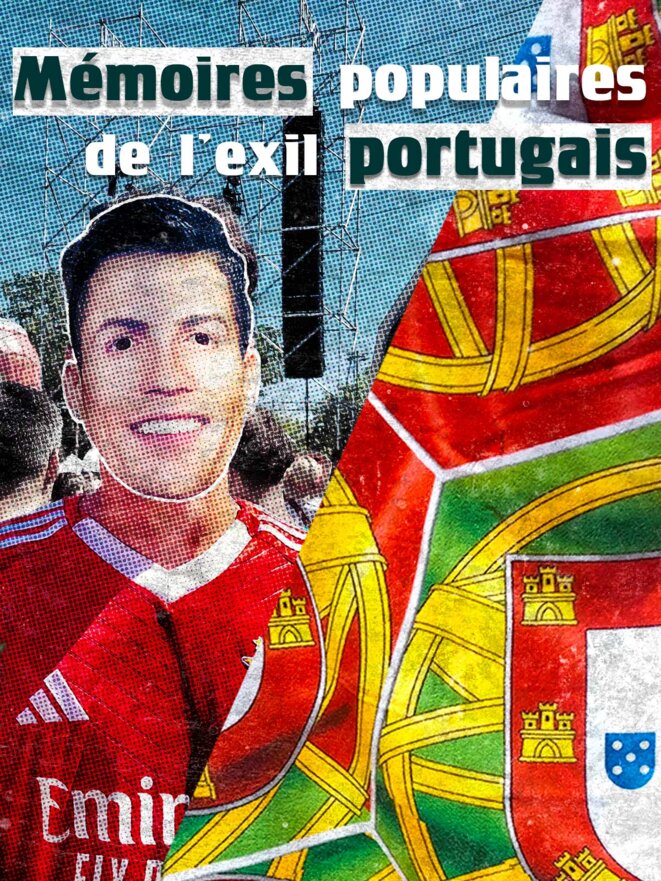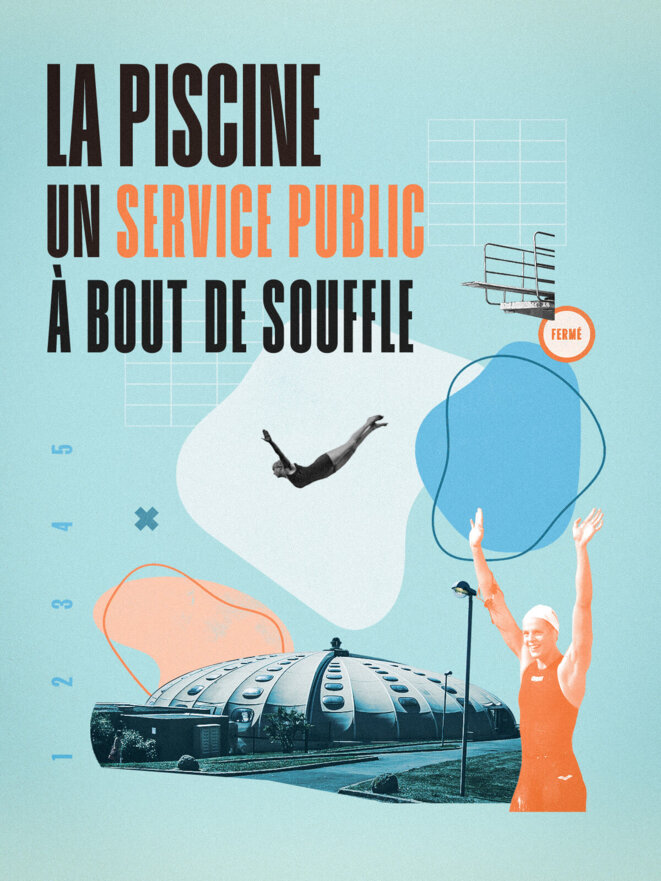Face à un présent qui peut paraître bouché et à des lendemains inquiétants, la Revue du Crieur, Mediapart et le festival d’Avignon s’associent, cet été (le programme est ici), pour enjamber ces temporalités ensablées et « penser le monde d’après-demain ». Dans ce cadre, Felwine Sarr, écrivain et universitaire sénégalais, constate que nous sommes passés, concernant l’Afrique, d’une « vague afro-pessimiste » à une rhétorique de l’euphorie plus récente, selon laquelle le futur serait désormais africain. Mais qu’il s’agisse de « la violence symbolique avec laquelle le destin de centaines de millions d’individus a été envisagé, traité, représenté, inscrit dans l’imaginaire collectif sur le mode de l’échec, du déficit, du handicap », ou de la vision optimiste et béate d’un continent africain devenu le futur Eldorado du capitalisme, « ce sont les rêves produits par d’autres, au cours d’une nuit de sommeil où les principaux concernés ne furent pas conviés au songe collectif, qui s’expriment ».
Série Épisode 1 Série: Penser le monde d'après-demain
Vers l’Afrotopia
Alors qu’Emmanuel Macron juge que le défi de l’Afrique pour demain est « civilisationnel », Felwine Sarr, universitaire et écrivain sénégalais, auteur d’Afrotopia, veut s’émanciper de ce genre de lecture et s’extraire « d’une dialectique de l’euphorie ou du désespoir ». Premier entretien vidéo d’une série intitulée « Penser le monde d’après-demain ».