« Penser oui et pas non », « mettez-vous au défi », « débrouillez-vous par vous-même »… Les salariés de Virgin Megastore vont probablement devoir méditer ces grandes leçons de vie extraites de l’autobiographie du fondateur de la marque Virgin, Richard Branson, intitulée Ma petite philosophie connaît pas la crise.
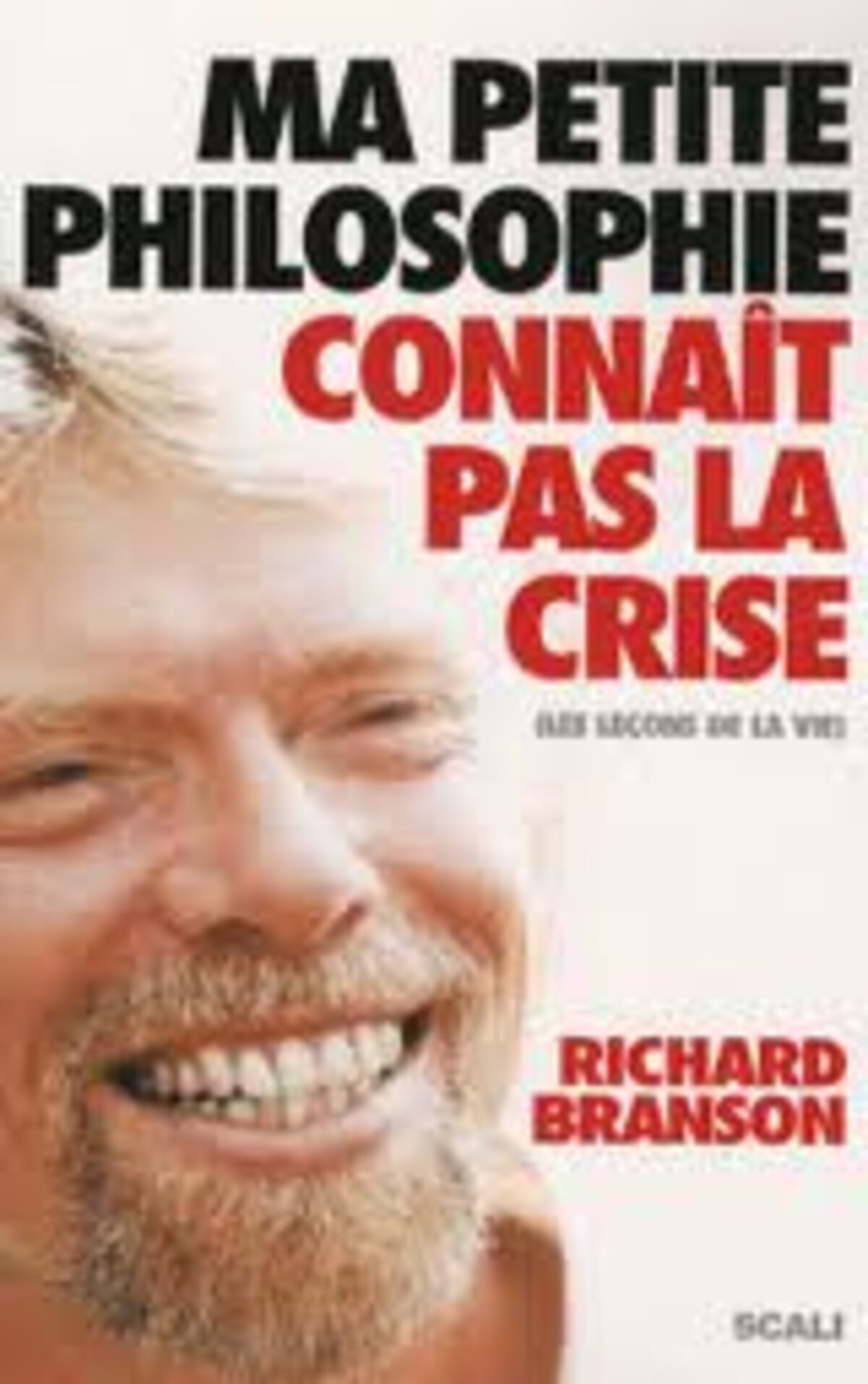
Eux, contrairement au milliardaire britannique, vivent en effet une crise : une crise de management et de stratégie, elle-même inscrite dans un bouleversement plus général de l’économie de la culture, qui fragilise l’enseigne détenue par le fonds d’investissement Butler Capital Partners (BCP).
Le tribunal de commerce de Paris a examiné lundi dernier, 14 janvier, le dossier de cessation de paiement déposé par le distributeur de biens culturels Virgin. L’enseigne a été placée en redressement judiciaire et un administrateur a été nommé pour une période de quatre mois. Si la liquidation judiciaire, qui aurait signifié la mort de l’entreprise, n’a pas été prononcée, les mille salariés que compte Virgin en France ont plus que du souci à se faire. Leur disparition pourrait bien être seulement différée puisque le dépôt de bilan de l’entreprise sanctionne autant la mauvaise gestion du financier Walter Butler qu’elle incarne la fin d’une époque : celle des mégastores.

Un phénomène qui ne touche pas seulement la France, puisque, le lendemain de cette décision du tribunal de commerce de Paris, de l’autre côté de la Manche, la marque mythique HMW a également été placée en redressement judiciaire, faisant craindre la disparition de la dernière chaîne de magasins de disques en Grande-Bretagne, avec 4 000 suppressions d’emplois à la clef.
Walter Butler, propriétaire à 74 % des magasins Virgin, les avait rachetés à Lagardère en 2008. À la tête du fonds d’investissement Butler Capital Partners (BCP), cet ancien inspecteur des finances et ancien banquier d’affaires chez Goldman Sachs, s’est spécialisé dans la reprise à bas prix de groupes en difficulté.
En 2005, il avait ainsi racheté à l’État près de 38 % de la SNCM, Société nationale Corse-Méditerranée, avant de quintupler sa mise en revendant ses parts, payées 13 millions d’euros, pour 73 millions à Veolia Transport en décembre 2008. Une pirouette permise par l’injection massive de fonds publics dans la compagnie de transports maritimes (voir l’article de Philippe Riès à ce sujet).
Sa méthode de cost killer lui a permis de remettre sur pied quelques entreprises revendues ensuite à bon prix, comme France Champignon, cédée en 2010 à Bonduelle. Mais lorsque le « retournement » d’une entreprise en difficulté en structure florissante lui semble impossible, même en taillant drastiquement dans les coûts et les effectifs, Walter Butler n’hésite pas à laisser tomber, comme cela avait été le cas pour la Sernam, et ce quelles qu’en soient les conséquences sociales.

Il est donc peu probable que Walter Butler se démène pour conserver Virgin Megastore, d’autant que ce dépôt de bilan lui laisse quand même quelques jolies perspectives de rentrée d’argent frais. D’après le JDD, l’homme est propriétaire d’une licence perpétuelle sur le célèbre logo rouge et blanc, estimée à 20 millions d’euros, auxquels il faudrait ajouter le bail du Megastore des Champs-Élysées pour 20 millions d’euros, des autres magasins Virgin pour 20 millions également, et une trésorerie de 35 millions d’euros.
Ce qui expliquerait notamment l’intérêt, annoncé par le journal dominical, du spécialiste des loisirs créatifs Cultura pour une reprise, totale ou partielle, des magasins Virgin.
« Ne pas diaboliser l’économie numérique »
Quoi qu’il en soit, la « faute de management » dénoncée par la ministre de l’économie numérique, Fleur Pellerin, ne tient pas seulement à une sous-estimation des coûts liés aux loyers des magasins. Même si Virgin ne paye plus ses bailleurs, dont les exigences ont été croissantes, en particulier sur des Champs-Élysées où le Virgin était à peu près la dernière destination populaire de l’avenue, l’échec de BCP ne se réduit pas à ce facteur locatif. Le groupe, depuis deux ans, est structurellement déficitaire et a déjà fermé plusieurs magasins et réduit ses effectifs, faute d’avoir su construire une stratégie de vente dématérialisée.
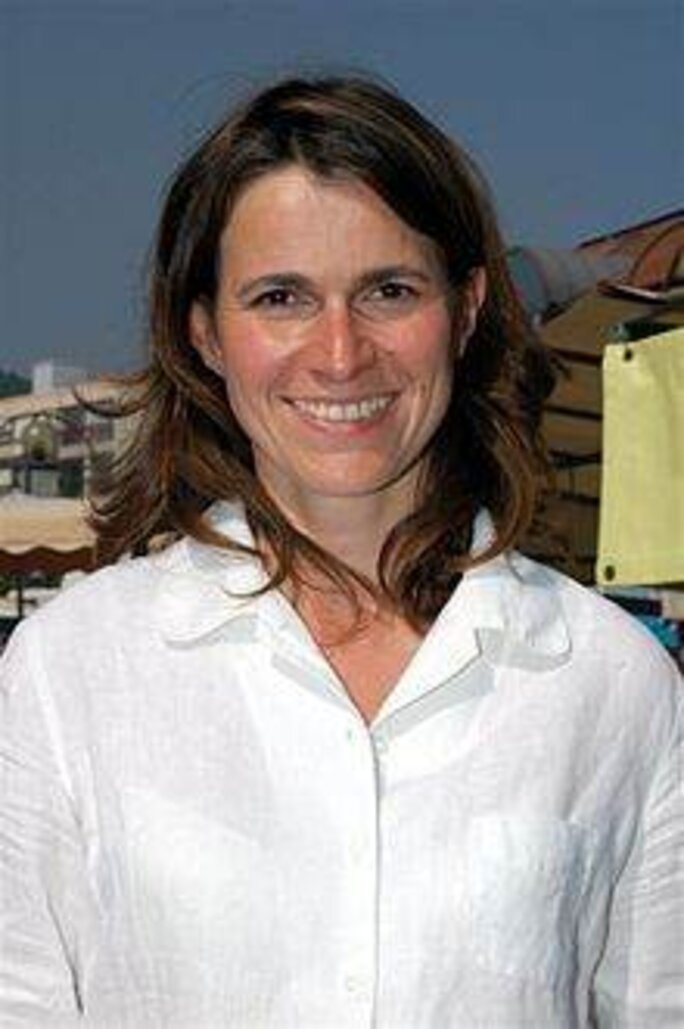
L’affirmation de la ministre de la culture, qui a rendu les « géants de l’e-commerce » responsables du dépôt de bilan des magasins Virgin Megastore est, toutefois, au mieux réductrice, au pire erronée. Aurélie Filippetti a pointé du doigt la « concurrence déloyale » de certaines « grandes entreprises de type Amazon », qui ne « sont pas soumises à la même fiscalité que les entreprises localisées physiquement en France » (voir à ce sujet l’article de Dan Israël).
Patrick Waelbroeck, qui travaille sur l’économie de la propriété intellectuelle et celle d’internet à Telecom ParisTech, juge que cette donnée n’est qu’une partie du problème. « Il est exact que tous les grands groupes internationaux font de l’optimisation fiscale et bénéficient de ce fait d’avantages concurrentiels. Mais, aux États-Unis, où Amazon est soumis à la même fiscalité que les autres entreprises, le groupe est aussi dominant, au point d’être même devenu le premier vendeur de CD depuis quelques années ! »
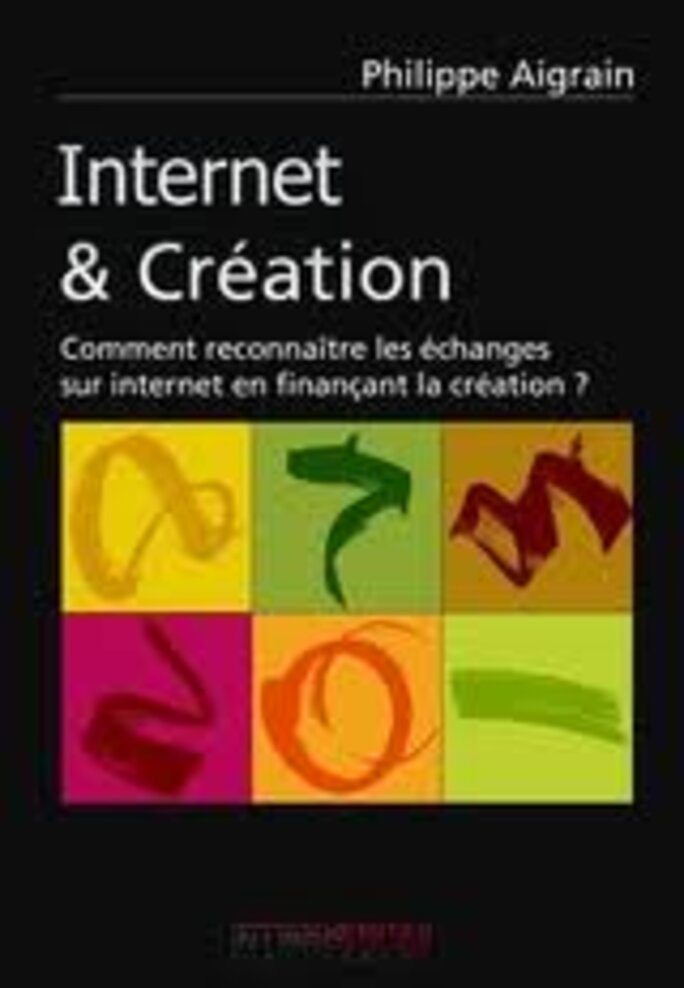
Pour Philippe Aigrain, co-fondateur de la Quadrature du net, « Virgin n’a investi que très tardivement et timidement dans la distribution numérique. Il est donc difficile d’accuser Amazon de lui avoir volé le marché ». En outre, les contradictions du gouvernement sont, en la matière, flagrantes, puisqu’au moment même où certains de ses membres ne cessent du pointer du doigt Amazon, la firme installe à Chalon-sur-Saône un nouveau centre de dépôt, aidé par des subventions publiques.
Fleur Pellerin a donc plus que nuancé les propos de sa collègue du gouvernement en reconnaissant « une concurrence déloyale par les prix, par l’imposition », tout en affirmant : « Il ne faut pas diaboliser l’économie numérique. L’économie numérique peut donner un nouveau souffle aux industries créatives, aux industries culturelles. » Et de pointer du doigt le fait qu’un « actionnaire qui ne transforme pas une entreprise qui vend des biens culturels et qui ne l’adapte pas à l’ère numérique est aussi fautif ».
Le site Numerama rappelle que, dès 2005, Virgin Megastore reconnaissait que son modèle économique en matière de numérique n’était pas réaliste, puisque, sur un morceau vendu 0,99 euro TTC, il ne recevait qu’un centime, tandis que 70 centimes allaient aux majors du disque. Depuis déjà longtemps, la vente de musique en ligne ne lui rapportait donc rien, écrit le site spécialisé dans les questions numériques, « non pas à cause du piratage, mais à cause des majors de l’industrie musicale qui ont imposé des conditions tarifaires que seuls Amazon, Apple ou quelques autres arrivaient à encaisser, parce que la vente de musique n’était qu’un service accessoire à une offre beaucoup plus globale », notamment les appareils de type Ipod.

La FNAC, qui a pris plus rapidement et énergiquement que Virgin le tournant de la vente en ligne, s’en tire d’ailleurs un peu mieux, même si elle reste à la remorque des grandes firmes comme Amazon et Apple, et devrait être bientôt vendue par le groupe Pinault-Printemps-Redoute (voir l’article Fnac : la fin d’une exception culturelle, de Martine Orange).
« On ne peut pas »
L’affaire Virgin témoigne donc aussi d’un changement d’époque qui bat en brèche le modèle du magasin en général et du supermarché en particulier, puisque le téléchargement de la musique, des films ou des livres permet d’éviter de se déplacer. Le paradoxe étant que les mégastores, aujourd’hui fragilisés, avaient eux-mêmes entraîné la disparition de très nombreux petits magasins.
« Si on veut aujourd’hui mener des politiques qui servent les auteurs, les interprètes ou les techniciens, estime Philippe Aigrain, il y a autre chose à faire que de sauver un acteur économique dont il ne faut pas oublier que, dans le passé, il a contribué aux difficultés des disquaires indépendants. Virgin, c’était le symbole de la rareté dans les rayons, avec 100 piles du même disque plutôt qu’une offre vraiment diverse. On parle quand même de quelque chose qui ressemble à Wall Mart ou Carrefour. Il me semble difficile d’en faire un modèle de l’exception culturelle ! »

Outre ses erreurs stratégiques, Virgin constitue en effet un modèle discutable, à la fois culturellement et industriellement. « La disparition des magasins physiques ne peut pas être vue seulement sous un angle négatif, estime Patrick Waelbroeck. D’abord, les coûts de la distribution en ligne sont moins chers, notamment parce que les coûts de stockage sont plus faibles. Ensuite, c’est un modèle qui permet une prescription décentralisée, puisque, sur Amazon, le système de recommandation en ligne est fondamental, alors que la Fnac ou Virgin n’ont pris en compte les possibilités du web 2.0 et contributif que très tardivement. Enfin, cela permet de distribuer des produits qui ne sont pas nécessairement mainstream. En rayon, on vend ce qui se vend bien. Les niches sont éliminées, tandis qu’Amazon génère une grande partie de ses ventes à partir de produits qui se trouvent en bas de catalogue, couplés à une offre de prix attrayante. »
La concentration de la distribution entre les mains de quelques grandes entreprises de vente sur internet n’est pas, pour autant, synonyme d’accroissement de la diversité des produits culturels mis à la disposition des consommateurs. « Je comprends l’émotion suscitée par la menace sur l’emploi, poursuit Philippe Aigrain, mais le monopole de distribution croissant d’Amazon sur les livres numériques, d’Apple sur la musique ou de Netflix sur les films devrait alerter sur autre chose que les effets que cela peut avoir sur les Virgin Megastore. Ces entreprises atteignent des taux de contrôle sur un marché où, normalement, les autorités de concurrence s’émeuvent. Mais les pouvoirs publics ne font rien, même pas réfléchir à des politiques d’interopérabilité, qui permettraient, par exemple, de faire tourner des logiciels libres sur le kindle d’Amazon. »
En réalité, le ratage de Virgin sur la distribution en ligne ou le retard pris par la Fnac dans le même domaine montrent que ces magasins continuent trop souvent à penser la révolution numérique touchant les biens de consommation culturels comme la simple dématérialisation de ce qu’ils faisaient en rayon. « Ces entreprises reproduisent trop sur le web ce qu’elles font dans le monde physique », juge Patrick Waelbroeck.
Alors que, notamment du fait des nouvelles pratiques liées à internet, les biens culturels doivent réinventer entièrement leur modèle de diffusion. C’est ce qu’ont réussi des entreprises de vente de produits culturels, comme Deezer ou Spotify. C’est aussi, sur un mode non marchand, ce pour quoi militent les activistes du net.

Ainsi, pour Philippe Aigrain, « les majors du disque, comme les gros éditeurs, protégés par un droit d’auteur transformé en droit des éditeurs, sont dans une logique de vendre cher les titres phare, avec des moyens de promotion traditionnels. Internet offre pourtant des possibilités différentes, avec un rôle de détection, de recommandation et de distribution du public, y compris par le partage de fichiers entre individus. Au lieu de le reconnaître, on laisse s’installer une intégration verticale entre les grands producteurs de contenus et les grandes structures de distribution. Les objectifs de diversité cultuelle réelle sont donc menacés. Malgré la croissance du nombre de titres créés, il y a toujours plus de concentration de l’accès à ces titres, puisque les majors contrôlent les circuits de distribution et de promotion. »
En somme, le mouvement de standardisation culturelle produit par les mégastores type Virgin il y a quelques années pourrait bien se poursuivre avec les mégastores virtuels que sont les grandes enseignes de la vente en ligne, même si ces dernières ont été plus habiles et rapides pour monétiser les nouvelles pratiques de consommation culturelle engendrées par internet.
Heureusement, pour réconforter les salariés de Virgin, il y aura toujours les pensées de Richard Branson : « Je ne crois pas que ces petits mots, “on ne peut pas” doivent vous arrêter. Si rien dans ce que vous avez déjà vécu ne vous montre comment atteindre votre but, trouvez un moyen inédit. »
Retrouvez aussi le reportage audio réalisé par l'émission Les Pieds sur terre, sur France Culture. Virgin, paroles de gilets rouges.


