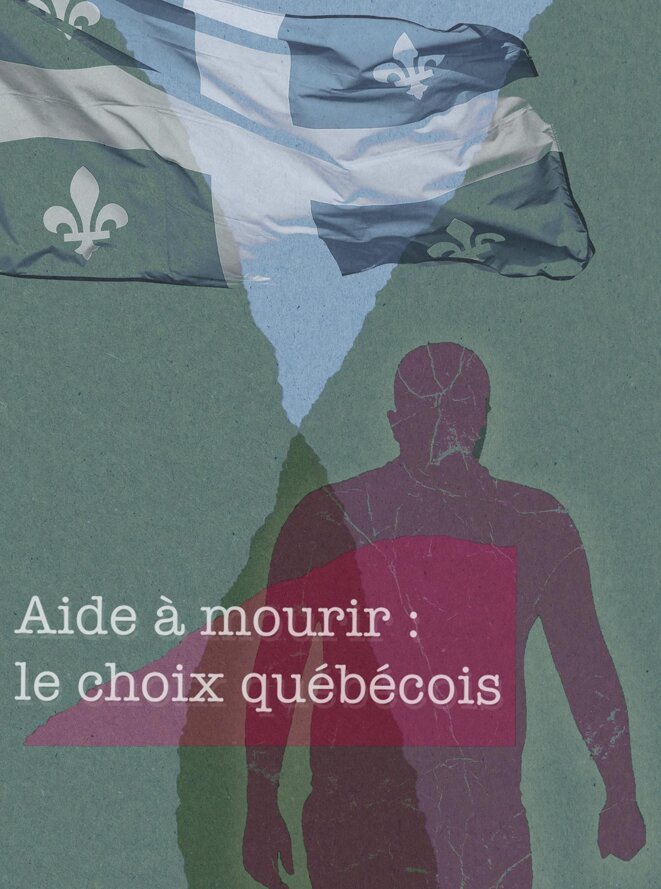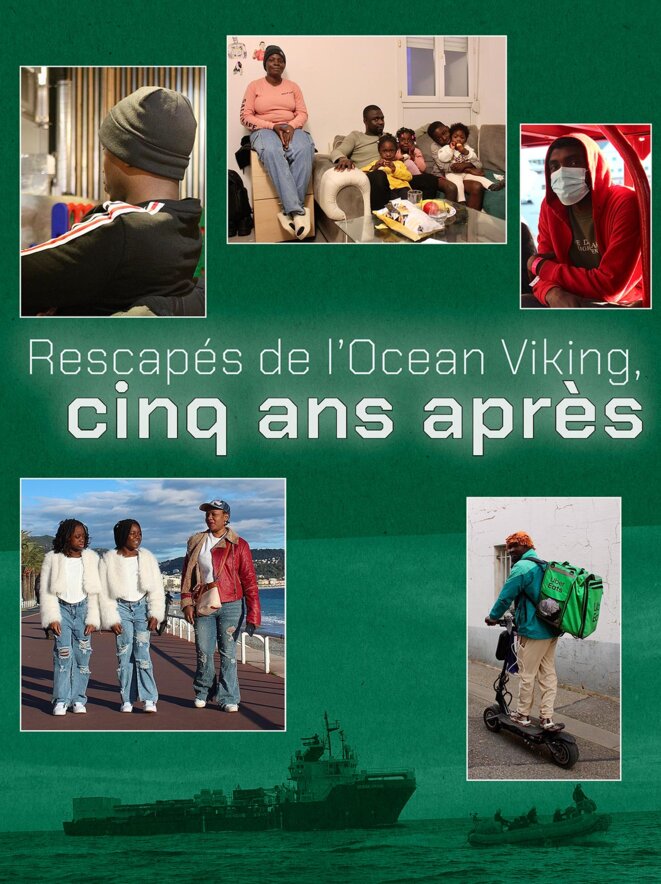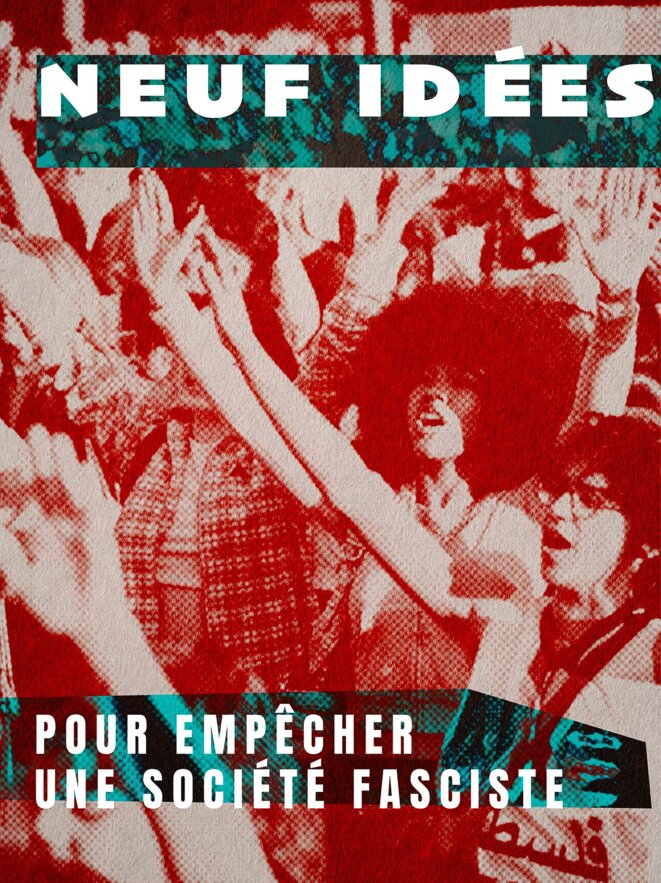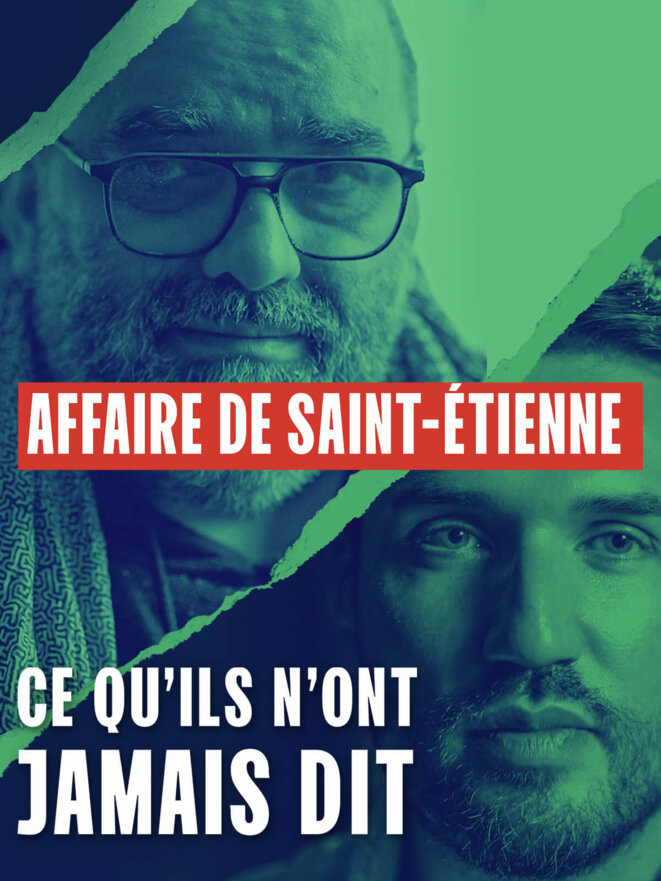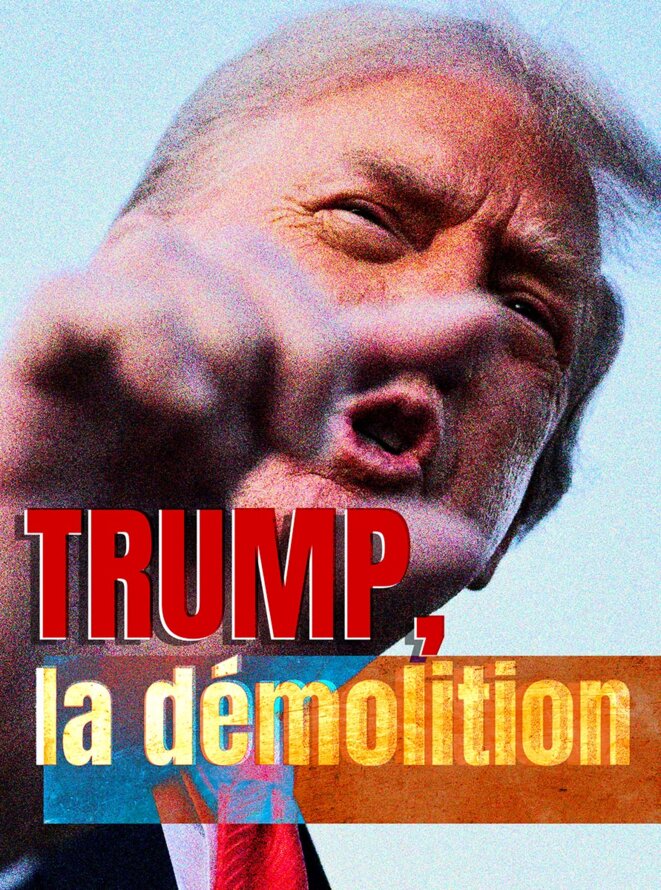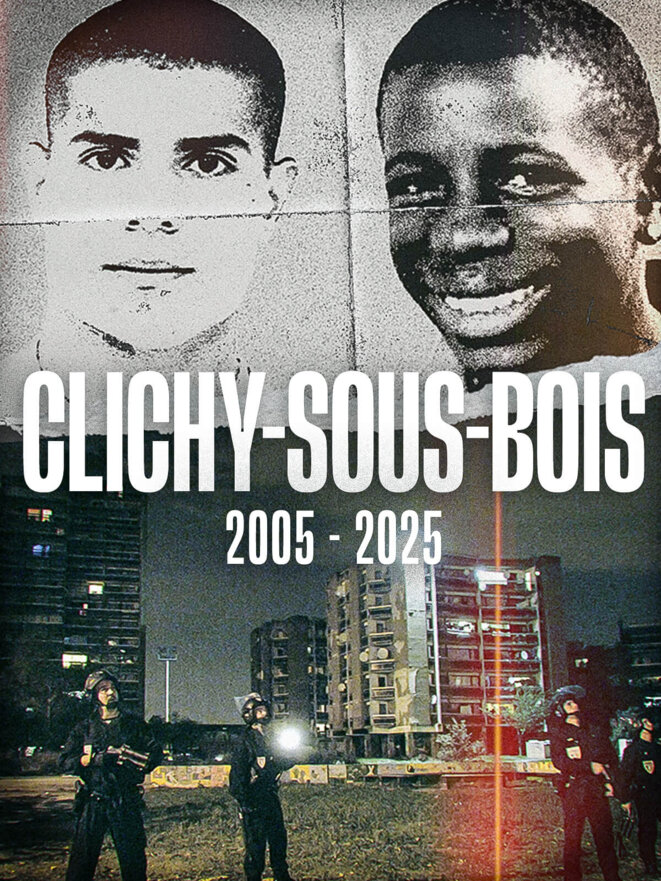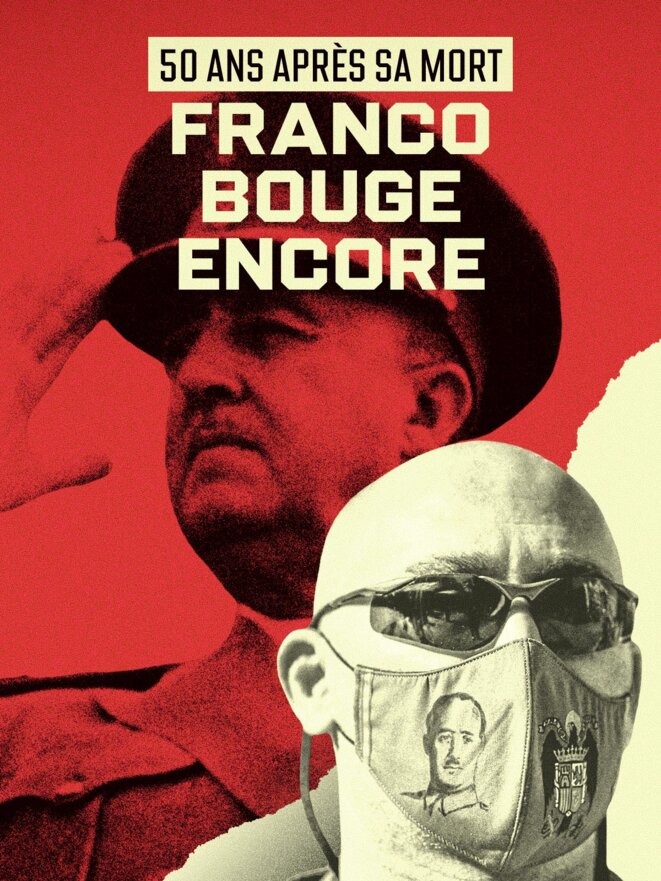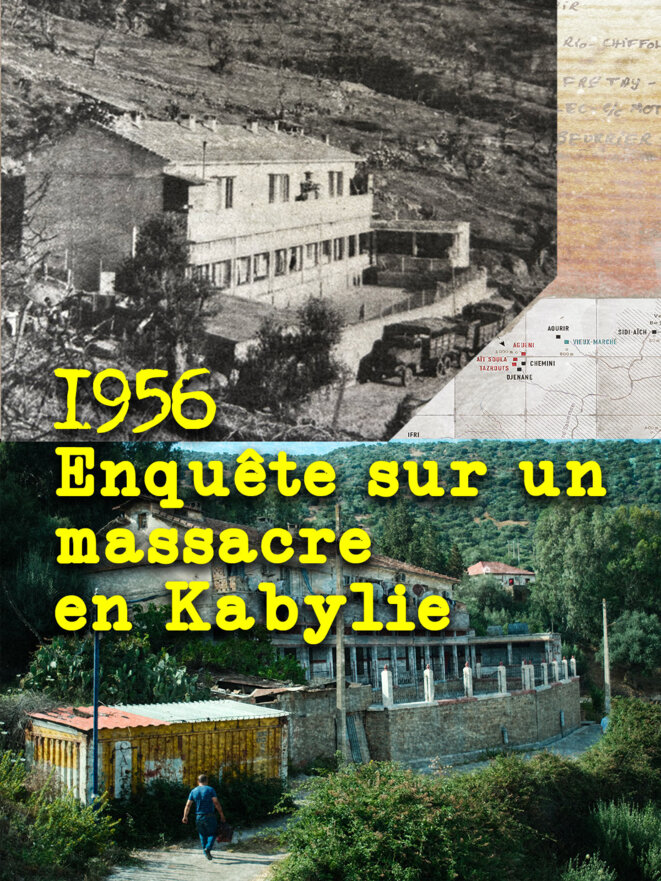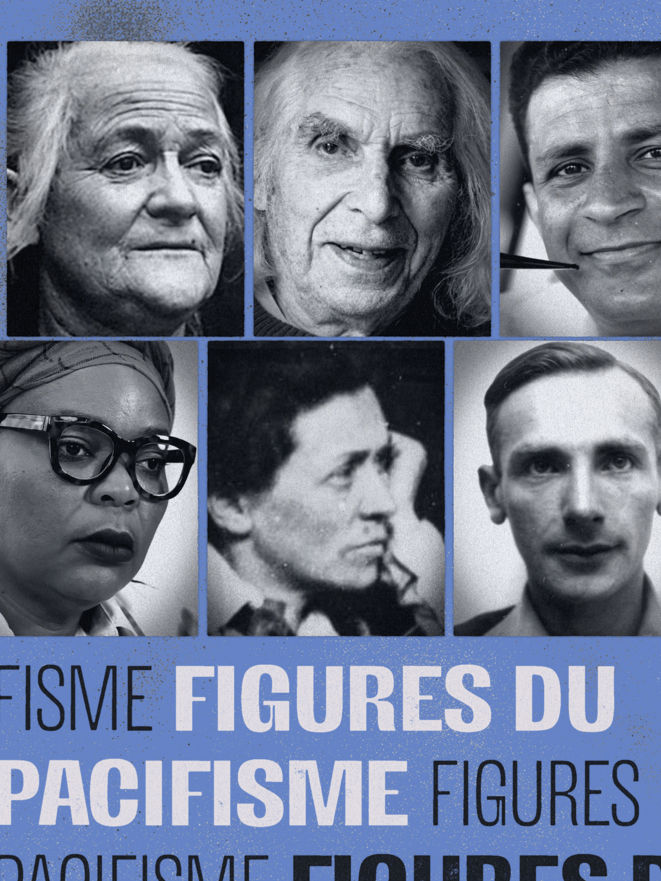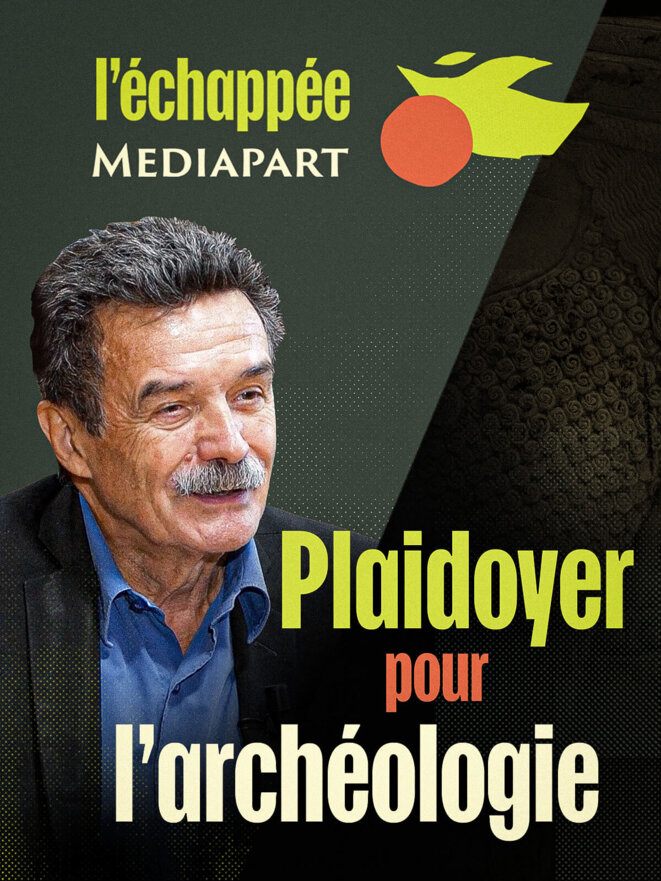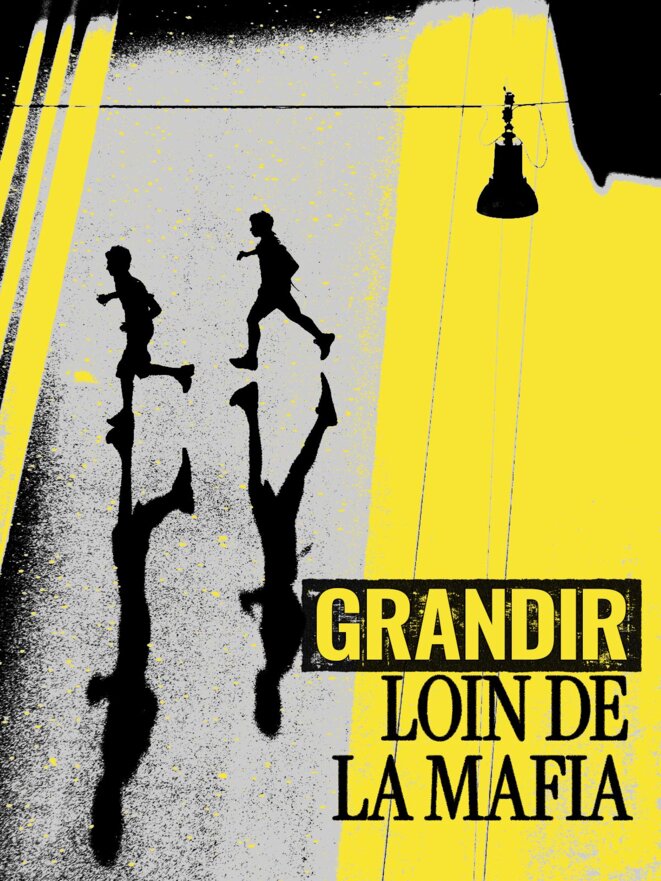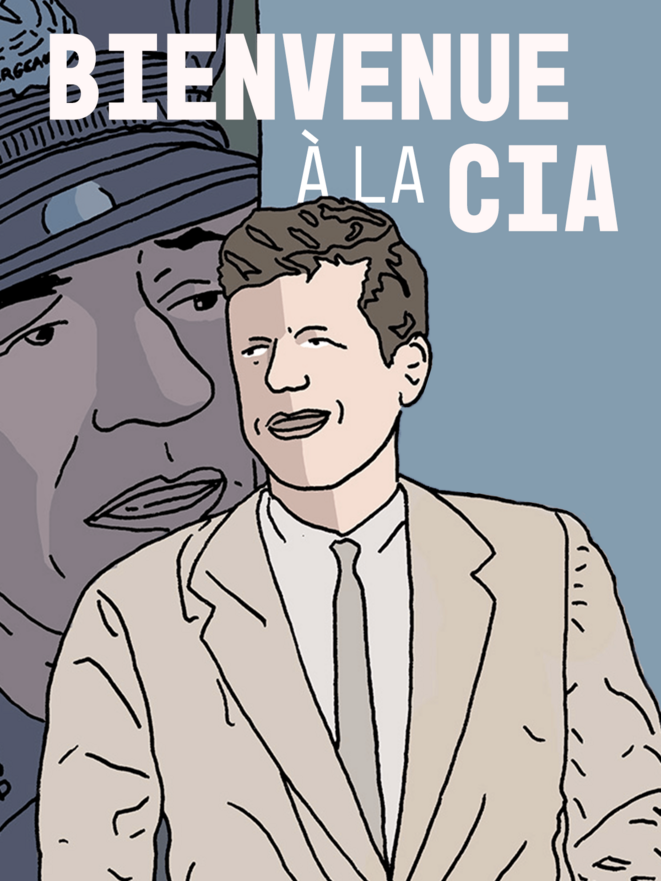Il ne s'est pas trouvé un(e) journaliste pour poser la seule question qui vaille – sinon qui fâche – à François Hollande : peut-il exercer la magistrature suprême sans se frotter à la littérature ? Il porte le prénom qui résume son peuple : François, étymologiquement l'homme du pays des Francs. Jamais cependant il ne lit de roman, terme qui désigne à l'origine un idiome qui n'est déjà plus du latin mais pas encore du français : le langage roman.
Un autre François avait compris, jusqu'à l'intérioriser plus que de raison, qu'on ne gouverne pas la France sans savoir manier un sceptre symbolique entre tous : l'usage des belles lettres. Regardez avec quelle fougue, quasiment lagarde-et-michardienne, François Mitterrand faisait partager, avant d'être élu, en décembre 1977, son admiration passionnée pour l'écrivain Albert Cohen (1895-1981), qu'il aurait voulu voir prix Nobel de littérature.
François Hollande n'est ni rabelaisien, ni stendhalien. Ni hugolien, ni rimbaldien. Ni shakespearien, ni racinien. Parfois timidement moliéresque. Et souvent discrètement giralducien. S'il fallait le résumer à un titre, ce serait celui d'une pièce de Jean Anouilh : Le Voyageur sans bagage. Sa finesse et sa pudeur le rapprocheraient d'un Léon Blum, s'il ne lui manquait ce frémissement littéraire, ce commerce (pas au sens qui prévaut à HEC) avec l'imagination, la fiction et les destinées métaphysiques. Pourquoi se dispense-t-il des passions qui engendrent les grandes aventures et enfantent les grands livres ?
Vous rétorquerez, à juste titre, que jamais la littérature ne fut un antidote aux funestes passions. Charles Maurras écrivait des poèmes en provençal le soir des émeutes du 6 février 1934. Personne n'en est sorti grandi. Le plus foudroyant styliste du XXe siècle, Céline, fut ignoble à souhait sur le plan politique. Et Aragon, après un deuxième voyage en URSS avec Elsa Triolet, de la mi-juin 1932 à la mi-mars 1933, alors que Staline organisait une famine criminelle pour punir les ennemis de classe, Aragon, aède aveugle, publia Hourra l'Oural (1934) :
Ils ont rendu l’homme à la terre
Ils ont dit Vous mangerez tous
Et vous mangerez tous
Ils ont jeté le ciel à terre
Ils ont dit Les dieux périront
Et les dieux périront
Les âmes surchauffées conduisent parfois aux désastres, là où des êtres réservés ne mènent qu'à mi-chemin... Si bien que François Hollande incarne peut-être, avec scrupule et prudence, un rapport au temps qui résulterait de la méditation fructueuse de ce texte essentiel : le fragment 172 des Pensées de Pascal. En voici le début. Il faut lire ces quelques lignes ardues et lumineuses, il faut passer outre les tournures et la ponctuation de 1670, pour saisir la démarche de l'homme qui, en mai 2012, pourrait devenir le septième président de la Ve République :
« Nous ne nous tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l’avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours ; ou nous rappelons le passé pour l’arrêter comme trop prompt : si imprudents, que nous errons dans les temps qui ne sont pas nôtres, et ne pensons point au seul qui nous appartient ; et si vains, que nous songeons à ceux qui ne sont plus rien, et échappons sans réflexion le seul qui subsiste. C’est que le présent, d’ordinaire, nous blesse. Nous le cachons à notre vue, parce qu’il nous afflige ; et s’il nous est agréable, nous regrettons de le voir échapper. Nous tâchons de le soutenir par l’avenir, et pensons à disposer les choses qui ne sont pas en notre puissance, pour un temps où nous n’avons aucune assurance d’arriver. »
En attendant, François Hollande ne devrait pas panser cette blessure narcissique, esthétique, morale et politique infligée par Nicolas Sarkozy à ses concitoyens – traités en sujets – un lustre durant : le président de la République française n'est plus enfant du livre, mais de la télé.
Même Valéry Giscard d'Estaing, qui se fit inviter à l'émission Apostrophes de Bernard Pivot pour y causer de Maupassant – du coup ainsi raillé, dans Le Monde, par le philosophe monarchiste Pierre Boutang : « Néron, qui chantait faux, descendit dans l'arène et ce ne fut pas son pire méfait » ; même Valéry Giscard d'Estaing, qui tint (croque) mordicus à s'incliner devant la dépouille de Jean-Paul Sartre, avait une haute conscience du primat de l'écrit. Au point – c'est ici une primeur, une exclusivité, un scoop, qui se niche dans cette chronique puisque la chose ne fut jamais dévoilée ! – que VGE puisa dans les fonds secrets de l'Élysée pour permettre, en toute opacité patrimoniale, à un laboratoire du CNRS, l'actuel Item, d'acquérir des manuscrits de Flaubert menacés de dispersion.
François Hollande est à mille lieues d'un tel fétichisme. Pas plus que Nicolas Sarkozy, il n'a besoin du roman pour refléter l'azur des cieux ou la fange des bourbiers. Il a toujours fait sans et il continuera. Nous tâcherons de faire avec. En nous persuadant qu'il ne s'agit pas là d'une rupture fatale, générationnelle, sans retour. De plus jeunes socialistes, Vincent Peillon en tête, ne sont pas perdus pour la littérature.
Il n'y a donc peut-être pas de quoi en faire un roman.