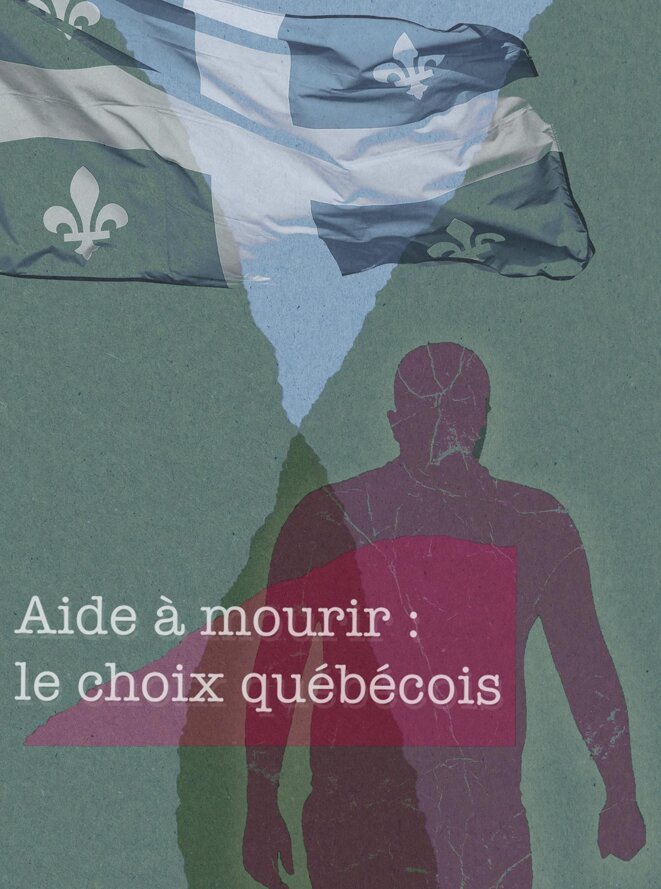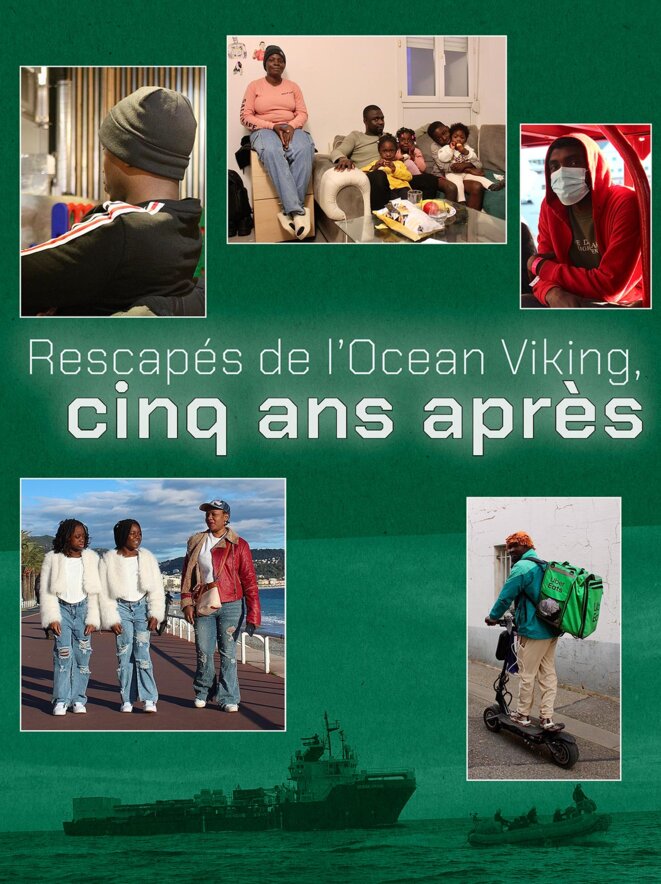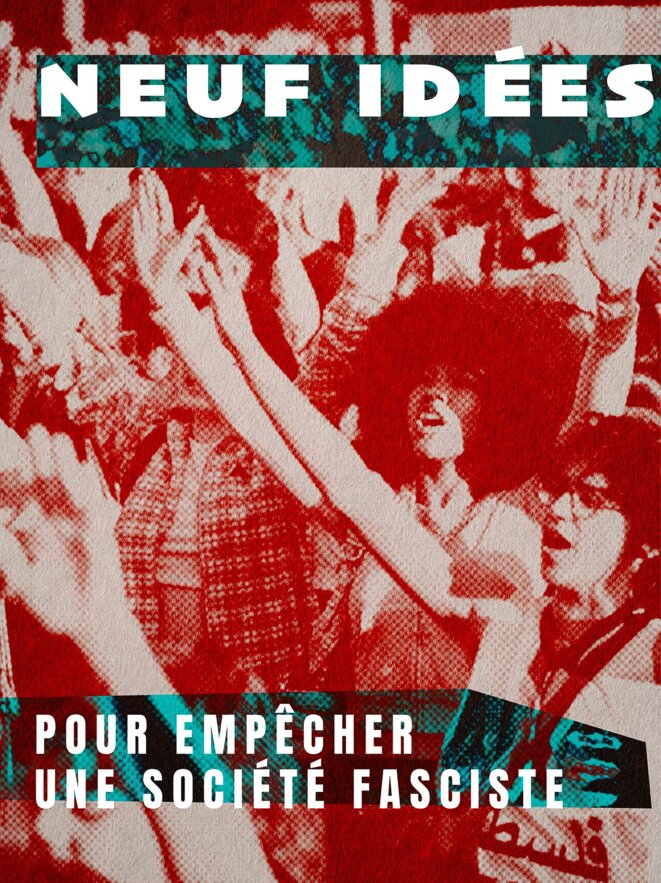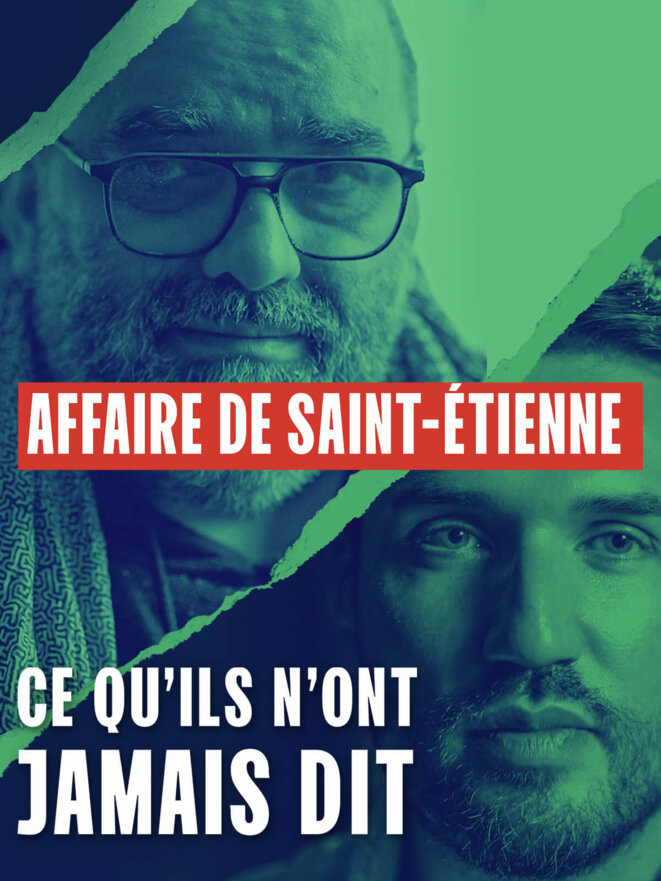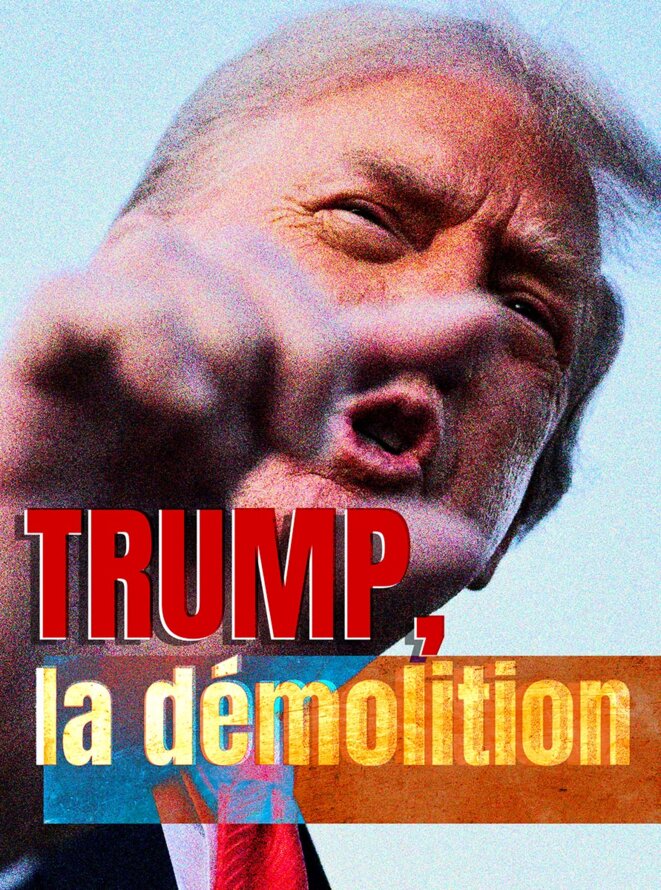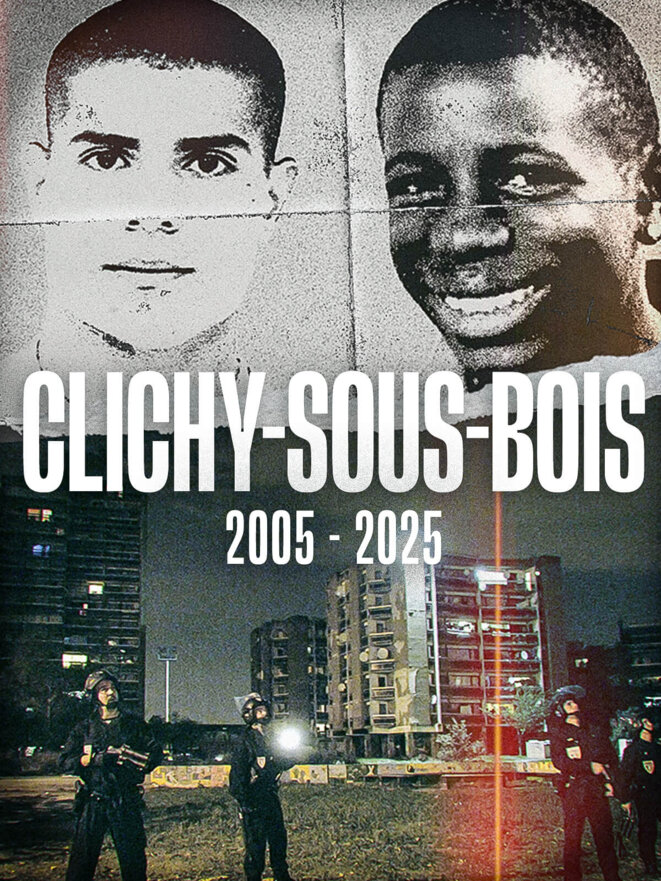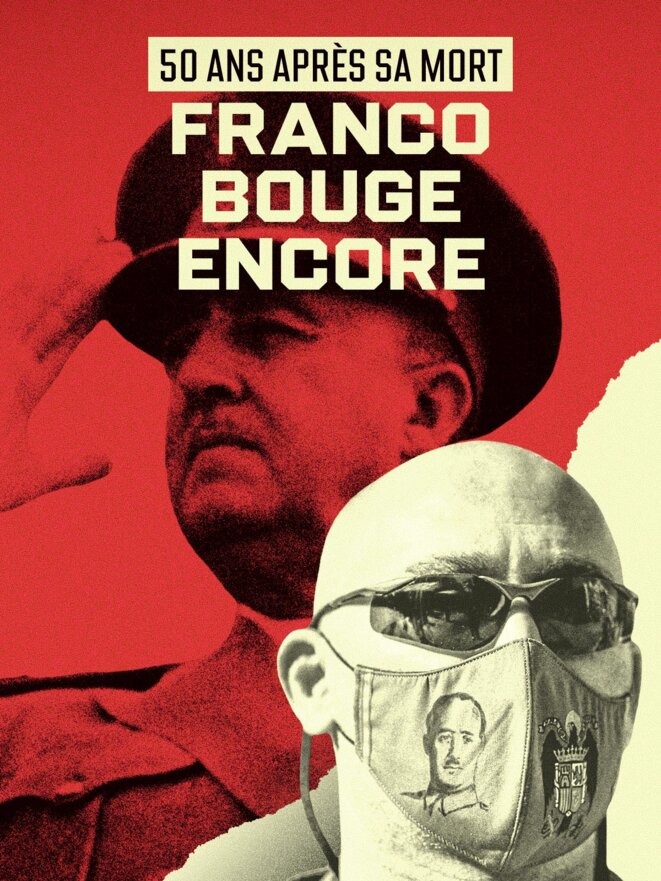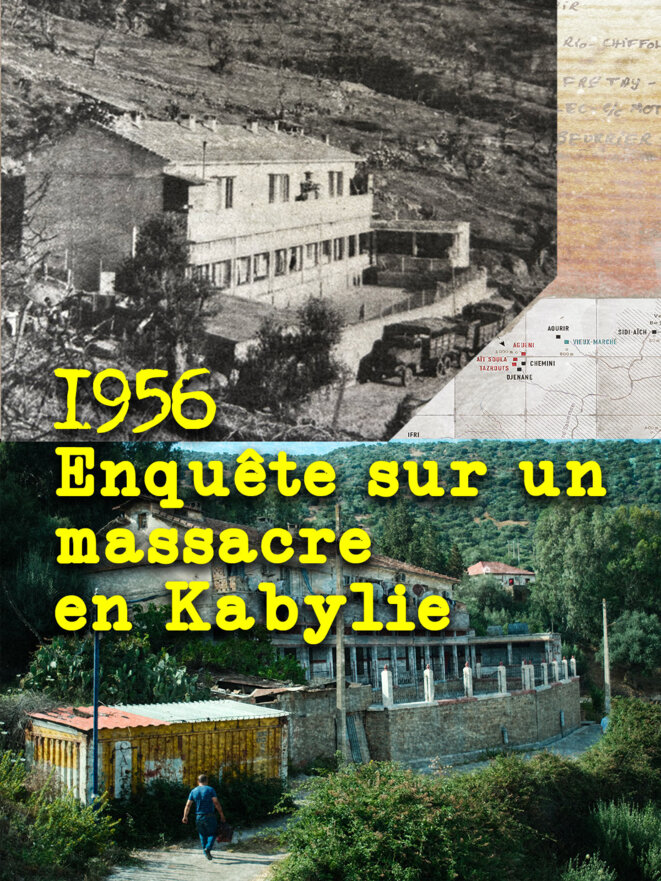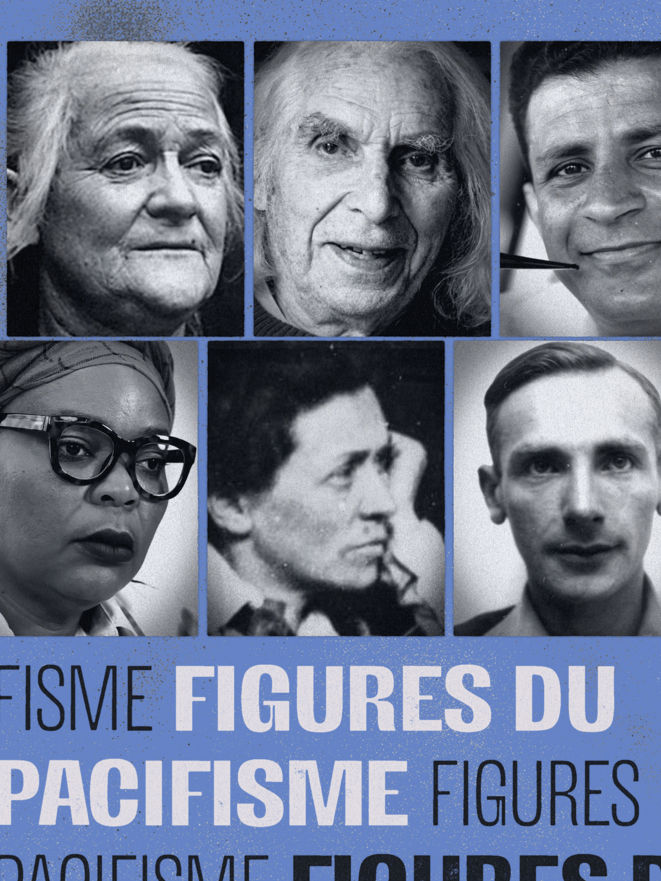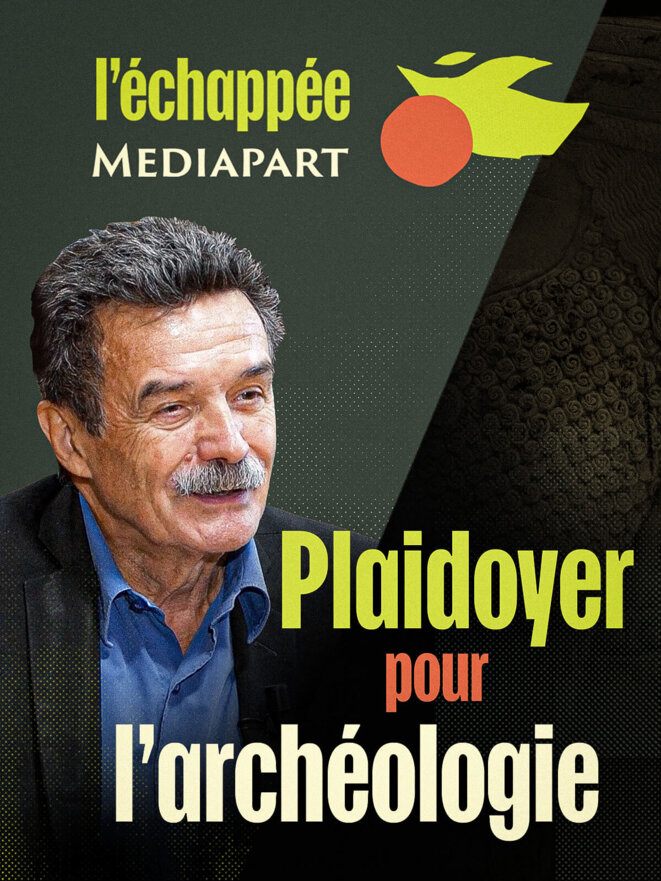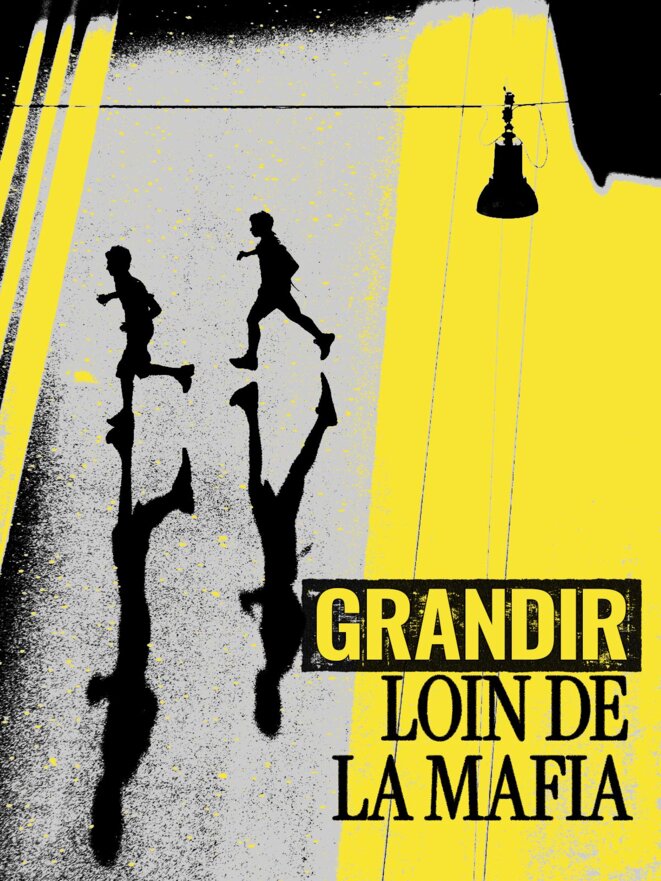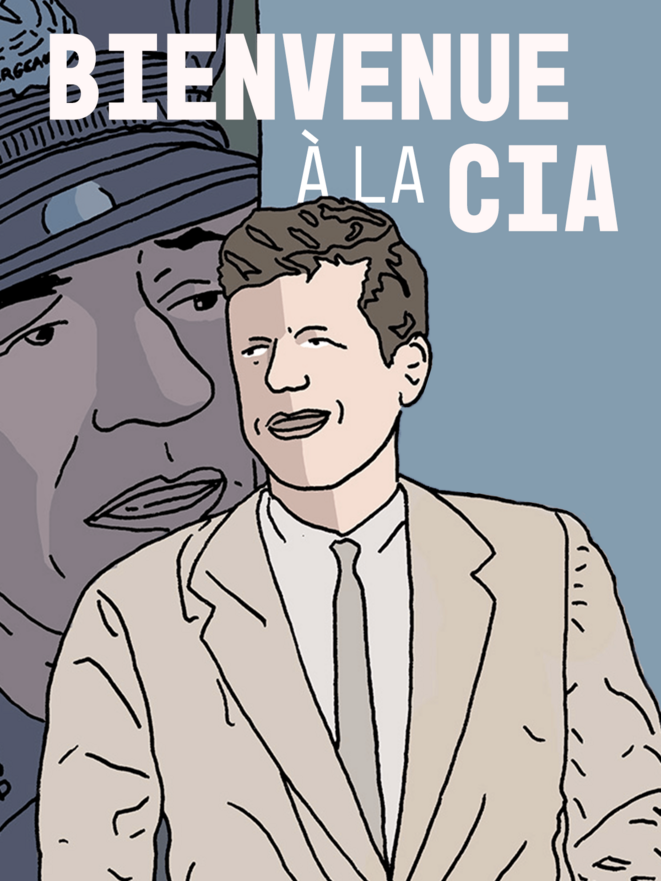Jorgen Jorgensen est un aventurier danois, mort au fin fond de la Tasmanie en 1841, devenu la cible d'éternelles moqueries en Islande. L'un des exploits de ce prolifique écrivain ne manque pourtant pas de panache. En 1809, il débarque sur l'île, alors sous l'autorité du Danemark, pour conclure des affaires. Il finit par emprisonner le gouverneur local et proclamer, en juin, au début de l'été, l'indépendance de l'Islande. Sur la lancée des révolutions française et américaine, Jorgensen promet des élections dans l'été, la formation d'un Parlement, et décrète que «tous les hommes naissent libres et égaux». Il est arrêté deux mois plus tard par les Anglais, venus prêter main forte à leurs alliés danois. Sa tentative de révolution a tourné au fiasco. Aujourd'hui, les Islandais, rieurs, s'en souviennent comme d'un monarque ambitieux et éphémère, le «roi des jours de canicule» (Jörundur Hundadagakonungur).

Deux ans et demi après l'effondrement de son secteur bancaire, il flotte un air de révolution manquée en Islande. Comme si la fenêtre d'opportunité pour tout changer s'était refermée sans prévenir. «Les choses surviennent par vagues. En 2008, la société s'est réveillée, dans un mélange de désespoir et d'euphorie», raconte, dans un entretien à Mediapart, le ministre de l'intérieur Ögmundur Jonasson. «Des nouvelles têtes sont apparues, dans les réunions, en Une des journaux, à la télévision. Pendant plus d'un an, les gens étaient en vie. Et je suis un peu inquiet de voir comment les choses sont en train de se calmer ces temps-ci», poursuit cet élu Vert, l'un des piliers de l'actuel gouvernement social-démocrate, né des élections d'avril 2009.
D'octobre 2008 à janvier 2009, des milliers d'Islandais se sont emparés des rues de Reykjavik, pour dire leur colère. Une «révolution des ustensiles», lointain écho aux cacerolazos argentins, qui fit tomber le chef du gouvernement d'alors, Geir Haarde, une figure du parti conservateur. «Nous exigions à l'époque un gouvernement d'union nationale, ou encore un gouvernement composé de citoyens tirés au sort dans l'annuaire. Mais nous n'avons pas été écoutés. Des élections traditionnelles ont été organisées et les partis classiques ont gagné», regrette Sigurlaug Ragnarsdottir, l'une des meneuses des rassemblements du samedi face au Parlement, qui ponctuèrent toute la fin d'année 2008 dans la capitale.

«Il y a des courants contraires»

Agrandissement : Illustration 3

Plus complexe à appréhender, difficile à situer sur un échiquier classique, «Le meilleur parti» fut la révélation des élections locales de mai 2010. Son président, l'acteur et comique Jon Gnarr s'est emparé de la mairie de Reykjavik, capitalisant sur son nom les votes contestataires dans la foulée de la crise. Depuis, l'effet Jon Gnarr (voir la vidéo ci-dessous) s'est effrité. A l'épreuve du pouvoir, son «anarcho-surréalisme» s'est traduit par un pragmatisme qui ne convainc pas. «Ils sont arrivés il y a un an sans expérience, et ils travaillent aujourd'hui exactement comme les autres. Ils ont par exemple coupé les budgets des crèches sans ciller», déplore Sigridur Gudmunsdottir, une électrice du Meilleur parti l'an dernier, qui n'exclut pourtant pas de voter à nouveau pour cette formation, faute de mieux.