De notre envoyé spécial à Zagreb.
« Ne dites pas aux Croates qu'ils habitent les Balkans, ils vont mal le prendre ! » avertit, charitable, un expatrié français en poste à Zagreb. De fait, sur Trg Jelacica, la place centrale de la capitale croate, on trouve une grande carte stylisée de la ville avec ses principales artères, les montagnes environnantes, les villages adjacents et, dans le coin supérieur gauche, la République slovène (voir la carte de la région sous l'onglet Prolonger).

Sur les bords de l'affiche, figurent également les principales destinations et leur distance : les cités proches, mais aussi Ljubljana (80 km), Budapest (360 km) et Vienne (350 km). Par contre, aucune mention de Belgrade (358 km), ni de Sarajevo (288 km). Les anciennes villes-sœurs de l'ex-Yougoslavie, les deux autres branches du « trident » de la Fédération yougoslave sont ignorées. Plus que cela, méprisées. Comme si leur seule évocation menaçait de tirer Zagreb de son songe européen pour la replonger dans le souvenir d'un demi-siècle d'« unité et fraternité » titiste ou, pire encore, dans le cauchemar d'une des dernières guerres du Vieux Continent, celle de 1991-95. Quatre années – comme 1914-18 – qui ont meurtri la région et secoué l'Europe.
Lorsque la Yougoslavie a entamé son lent processus de désagrégation en 1990 – toujours pas achevé et encore moins digéré aujourd'hui – la Slovénie, l'État le plus prospère de l'ancienne fédération, a rapidement mis les voiles : quelques accrochages armés, l'indépendance en 1991, puis l'accession à l'OTAN et à l'UE en 2004. La Croatie, deuxième État le plus riche, a voulu suivre la même voie. Mais plusieurs conflagrations, entre 1991 à 1995, au cours desquelles le pays fut à la fois agressé et agresseur, victime et "perpétrateur" de crimes de guerre, et la poigne de fer du président nationaliste Franjo Tudjman, ont singulièrement retardé l'objectif croate. Ce n'est qu'à la mort de ce dernier, fin 1999, que le pays s'est définitivement débarrassé de ses oripeaux nationaux-communistes pour se projeter dans sa nouvelle utopie européenne.

Les Croates ont indéniablement investi dans leurs postes frontières. Sous les haubans métalliques de péages (auto)routiers flambant neufs, les douaniers sont zélés et le contrôle des passeports est pointilleux. Pas question de laisser passer un Serbe ou un Bosniaque sans s'assurer de la validité de son titre d'identité et de déplacement. « Il y a vingt ans, les bus étaient moins rapides et on partageait les routes avec les charrettes, mais personne ne me demandait mes papiers », maugrée Vuk, la cinquantaine, un fonctionnaire Serbe qui effectue le trajet de Belgrade à Zagreb pour des raisons familiales. « Ce pays qui était le nôtre ne nous appartient plus », lâche-t-il en allumant sa cigarette. Bien sûr. La Croatie n'est plus son pays.
Tourner le dos aux Balkans
Les Croates l'entendent bien ainsi. Ils ont presque tous collé sur leur voiture un autocollant HR pour Hrvatska Republika, République croate, quand ils n'affichent pas le fanion à damiers sur leur balcon. Plus question de communion fraternelle des Slaves du Sud. Plus question de partager : ni les revenus, ni la côte dalmate, ni Josip Broz, né en Croatie, président en Serbie. La Yougoslavie est morte, dansons sur son cadavre ! Chacun chez soi, chacun sa monnaie, chacun son drapeau. Le serbo-croate langue commune ? Que les Serbes récupèrent leur alphabet cyrillique, et appliquons la définition prêtée au linguiste Max Weinreich : « Un langage, c'est un dialecte appuyé par une armée et une marine ! » Il n'y a plus de langue serbo-croate aujourd'hui, mais du serbe, du croate et du bosniaque. Tant pis s'il n'y a pas plus de cinquante mots de différence.

Les Croates font du zèle aux frontières, se percevant déjà comme les nouveaux gardes-barrières de l'espace Schengen. L'adhésion européenne n'arrivera pas avant 2011 ou 12, mais ils sont convaincus d'être les prochains sur la liste, et personne ne leur grillera la politesse. « Sarkozy l'a dit, votre président l'a dit ! » s'essouffle un porte-parole du ministère de l'intégration européenne, faisant référence à l'interview télévisée de fin avril au cours de laquelle l'occupant de l'Élysée a expliqué qu'intégrer la Turquie, « ce n'est pas la même chose [que] faire entrer en Europe la Croatie ».
Après les Slovènes, les Croates veulent être les bons élèves qui frappent à la porte de l'Europe. « Pour eux, intégrer l'Union européenne représente l'acte final de la dissolution de la Yougoslavie », décrypte un conseiller de la délégation de l'Union européenne à Zagreb. « Dans la population, cette intégration est perçue, pour utiliser le vocabulaire des psychologues, comme une "closure". » « Nous voulons tourner le dos aux Balkans et à tout le passif historique que charrie ce terme, synonyme de guerres, de problèmes insolubles, de conflits ethniques... », confirme Sandja Durevic, une étudiante en dernière année d'Histoire à l'Université de Zagreb. « Nous nous sentons européens, pas balkaniques. »
La nostalgie du futur
La confusion est courante entre sentiment d'appartenance au continent et adhésion au « Club des 27 et plus ». Le sésame européen fait office de brevet de normalité. Pourtant, quand Bruxelles titille la fierté croate, en demandant l'ouverture des chantiers navals à la compétition par exemple, ou quand Madrid capture le général Ante Govina pour l'expédier devant le tribunal international de La Haye afin qu'il réponde de crimes de guerre, les sondages enregistrent une chute de la popularité du sentiment d'adhésion, qui tourne ordinairement autour de 60% d'avis favorables.
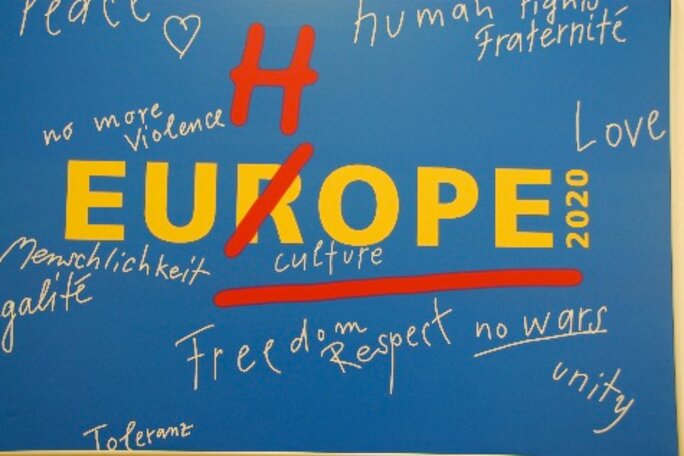
L'aspiration européenne demeure néanmoins « le principal, voire le seul moteur des réformes économiques et démocratiques qui sont entreprises », assure un diplomate européen, sous couvert d'anonymat. « Sans cet objectif, le pays stagnerait. Les Croates veulent assurément être démocrates et performants, mais la mécanique pour y parvenir les dépasse un peu. L'Union européenne agit comme un accélérateur. » Le bon élève fait tout ce qu'on lui dit de faire. Les ministères intègrent progressivement les règles des 27, sans forcément réfléchir, et parfois au détriment d'une introspection qui permettrait d'évaluer cet avenir européen radieux qui autorisera l'évacuation d'un passé que beaucoup veulent oublier.
« Il y a une certaine volonté de ne pas regarder en arrière pour examiner ce qui s'est passé durant la guerre de 1991-95 », commente Mirka Rankovic, une enseignante récemment revenue à Zagreb après plus de dix années passées à l'étranger. « Officiellement, le gouvernement coopère avec les instances internationale, mais l'acceptation publique n'est pas encore là, surtout dans les campagnes. Par exemple, deux généraux doivent bientôt passer en procès dans une région du sud, mais leur dossier d'accusation ne comporte aucune inculpation ! Dans ces cas-là, on retrouve une mentalité un peu turque, très balkanique... »
Il n'empêche, justifie l'étudiante Sandja Durevic, « les nationalistes ont quasiment tous disparu du paysage politique. La dernière élection s'est jouée sur des thèmes classiques de politique sociale et économique et non plus historiques ou ethniques. » Un moment de silence. « Pas comme à côté », ajoute-t-elle dans un murmure. À côté, c'est-à-dire en Serbie où, malgré le succès électoral récent du parti démocrate pro-européen de Boris Tadic, le nationalisme continue de faire recette et où les rêves de Grande Serbie ne se sont pas dissipés.
Les Croates n'ont pas sombré dans la yougonostalgie. Au contraire, leur nostalgie est celle du futur européen. Et comme la Pythie de la mythologie, ils s'y dirigent en aveugles.
Tournez la page pour une carte postale multimédia.
Le 1er mai 2008 à Zagreb
En conclusion, une carte postale multimédia :


