On sait déjà que le déconfinement ne se fera pas d’un coup, de la même façon selon les géographies, ni sans porter les stigmates du moment présent, sous forme de masques ou d’applications de tracking embarquées sur nos téléphones.
La notion de « sortie de guerre » qui, dixit l’historienne Cosima Flateau, permet de « décrire un processus qui n’est nullement homogène ni continu, mais qui peut être fragmenté, compartimenté » peut-elle nous aider à penser ce que sera l’avenir déconfiné ? Un retour à la normale ou une période d’invention ? Une rupture nette ou un maelstrom temporel chaotique ? Une explosion de sève momentanée ou une période de deuil prolongée ? Élaborée dans le champ historiographique depuis une vingtaine d’années, la notion de « sortie de guerre » aide à dépasser une dichotomie artificielle et trompeuse entre la crise et le post-crise, entre le temps de la guerre et le temps de la paix, entre l’avant et l’après.
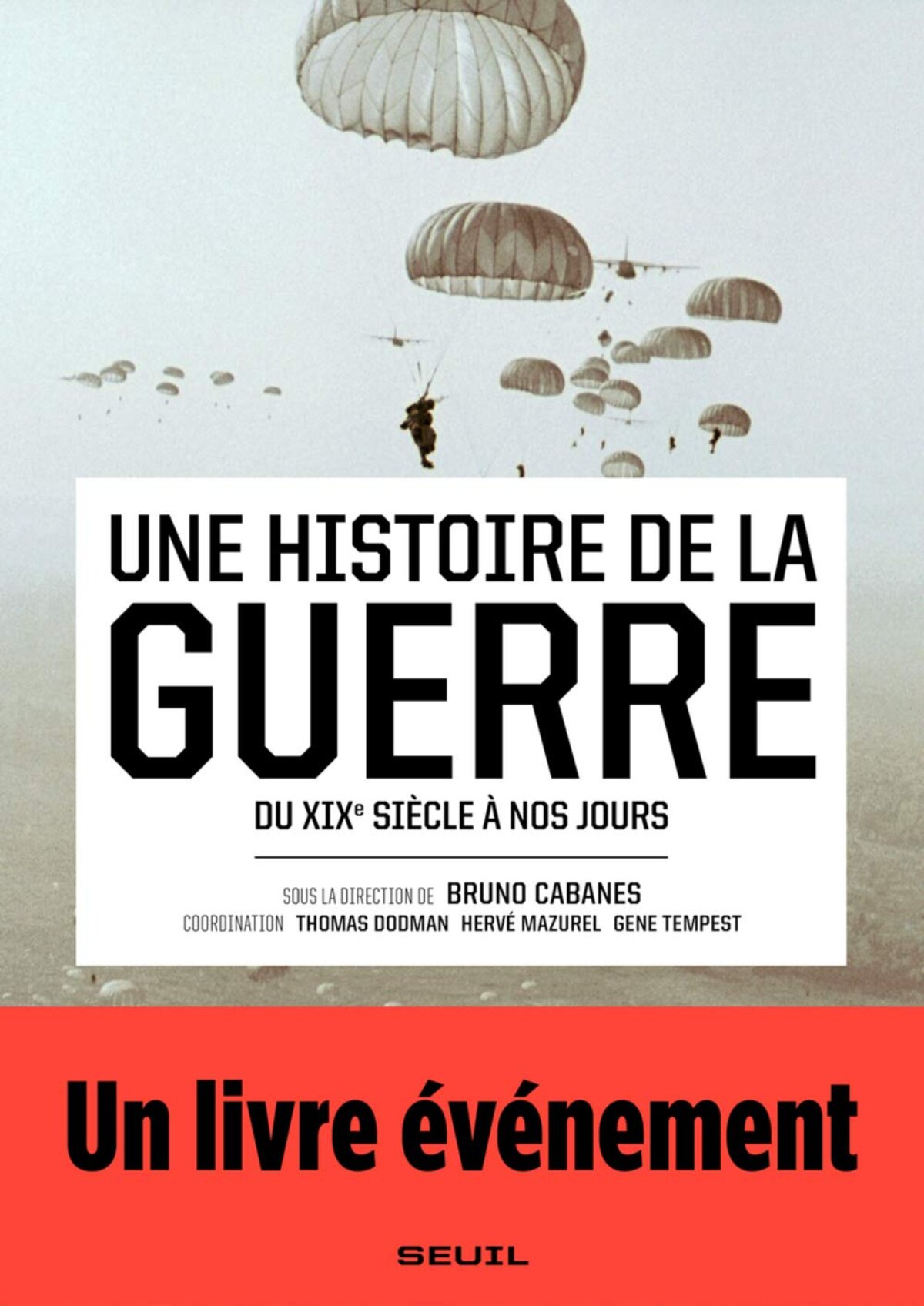
Agrandissement : Illustration 1

Mais utiliser ce concept de « sortie de guerre » pour tenter de comprendre ce qui pourrait nous arriver impose d’éviter les comparaisons injustifiées. « Nous ne sommes pas en guerre », souligne Bruno Cabanes, directeur d’une monumentale et novatrice Histoire de la guerre du XIXe siècle à nos jours (Seuil, 2018). « La rhétorique actuelle me semble dangereuse à plus d’un titre, soit parce qu’elle habille une crise sanitaire globale, durable et complexe sous l’apparence d’une mobilisation militaire, laissant libre cours à toutes les dérives politiques imaginables, comme une extension des pouvoirs de l’exécutif ou un recours aux mythes du sauveur et de l’union sacrée, soit qu’elle vise à préparer l’opinion à la suspension d’un certain nombre de libertés publiques, par exemple le prolongement automatique de deux à six mois de la détention provisoire en France, par simple ordonnance. Est-il vrai aussi que la pandémie soit une “épreuve commune”, comme le laisse croire la métaphore de la nation en guerre, alors qu’elle accroît sensiblement les inégalités, à tous les niveaux, depuis notre accès aux services de santé, à un réseau Internet de bonne qualité, jusqu’au cadre de vie dans lequel nous nous imposons le fameux confinement ? Comme nous le rappellent les sociologues, la « distanciation sociale » est une abstraction, définie et vécue de manière inégale : on s’en rend compte parfaitement aux États-unis, où je vis depuis quinze ans. »
Pour celui qui occupe la chaire Donald et Mary Dunn d’Histoire de la Guerre moderne à l’Ohio State University, les soignants ne sont pas des combattants, même lorsqu’ils pratiquent une médecine de guerre, au sens d’une médecine d’urgence. « Ils ont des droits sur nous, déclarait récemment Emmanuel Macron, utilisant la formule célèbre de Clemenceau. On aurait dû lui rappeler qu’elle avait été déjà dénoncée comme ambiguë par les anciens combattants de la Grande Guerre. Car de quels droits parle-t-on exactement ? Pas plus que les vétérans de 1914-1918, les soignants, qui réclament depuis des années des moyens financiers et matériels, ne peuvent se satisfaire de mesures symboliques. On réfléchit à l’idée, m’a-t-on dit, de donner le statut de “Morts pour la France” aux membres du personnel médical décédés du Covid-19. En dépit du respect qu’on leur doit, il me semble qu’on fait fausse route. L’engagement des médecins ou des infirmières n’est pas du même ordre, évidemment, que celui des forces armées. Il est d’ailleurs intéressant que nos sociétés occidentales, qui n’ont plus l’expérience vécue de la guerre, recourent à cette comparaison lorsqu’elles veulent décrire un engagement absolu, inconditionnel. »
Guillaume Piketty, professeur au Centre d’histoire de Sciences Po, spécialiste de l’histoire du phénomène guerrier et des sorties de guerre, juge qu’il est toutefois d’ores et déjà intéressant de penser à « l’économie morale de la reconnaissance, c’est-à-dire l’ensemble des moyens par lesquels une collectivité exprime sa gratitude envers celles et ceux qui se sont sacrifié.e.s pour elle. Dans l’histoire, cette reconnaissance est notamment passée par des moyens matériels ou monétaires, par exemple les pensions accordées aux anciens combattants, ou le loto national mis en place à l’origine pour aider les “gueules cassées”. Mais l’histoire rappelle que le symbolique est aussi, voire plus, important dans le processus de reconnaissance, parce qu’aux yeux des intéressé.e.s, le matériel ne peut jamais s’élever au niveau du sacrifice consenti. Il sera donc, demain, aussi important de soutenir au plan économique les femmes et les hommes en souffrance que de prévoir des dispositifs de reconnaissance pluriels pour toutes celles et tous ceux – soignants et livreurs par exemple – qui se seront impliqué.e.s, jour après jour, au cœur de la crise et auront permis d’en sortir. On contribuera alors à réparer le tissu social de notre pays. »
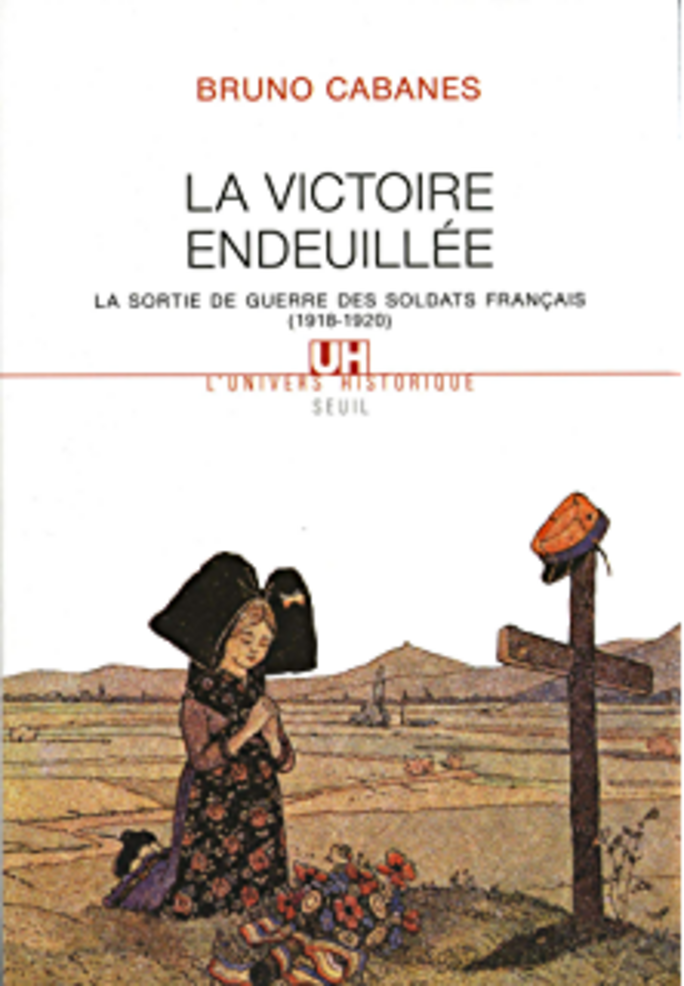
Pour Bruno Cabanes, d’autres éléments invitent à se méfier d’un parallèle trop évident entre la situation actuelle et les conflits du passé. « En 1914-1918 comme en 1939-1945, la mobilisation exigeait la participation de tous à l’effort de guerre économique. À l’inverse, dans la crise sanitaire actuelle, le confinement impose une inaction forcée, une restriction extrême des rapports sociaux. Au sentiment d’impuissance qui en découle s’ajoute l’angoisse de faire face à une menace imperceptible. Un ennemi invisible, nous dit-on, mais on sent bien que la métaphore guerrière atteint ici ses limites. »
Il ajoute une autre distinction importante : « Autrefois, les guerres frappaient des sociétés où de nombreuses personnes avaient connu les guerres précédentes, qu’il s’agisse des civils, des combattants, des réfugiés… Aujourd’hui, nos sociétés occidentales ne savent plus ce que sont une épidémie ou la mort de plusieurs milliers de personnes par semaine. Cela rend l’appréhension de l’événement beaucoup plus déstabilisante et sidérante. »
L’historien déplore donc que « pour mobiliser une nation, on se sente obligé de recourir à ce vocabulaire martial. Ne pourrait-on pas imaginer d’autres formes de mobilisation, fondées sur un projet collectif ? Nul n’invoque plus la belle notion de fraternité ou celle de solidarité qui ne mettrait pas de côté les invisibles de la crise actuelle : les réfugiés, prisonniers, SDF, largement oubliés par les politiques publiques, tout comme d’autres invisibles de la mobilisation, les personnels des EHPAD, les agents d’entretien, les employés dans les grandes surfaces, par exemple, qui ont eux aussi des “droits sur nous”… »
« On assiste à des transgressions multiples »
Ces précautions prises, Bruno Cabanes n’exclut pas des parentés entre la situation contemporaine et ses objets d’études historiques. « L’événement collectif et personnel que nous vivons s’apparente par son ampleur à un conflit mondial, je parle évidemment de son impact psychologique plutôt que démographique. Il y a longtemps que nous n’avions pas été forcés massivement à faire le deuil d’un proche sans pouvoir l’accompagner dans ses derniers instants, sans nous recueillir devant un corps ou rendre hommage au défunt par une cérémonie publique. Les contemporains de la Grande Guerre étaient familiers de cette disparition des corps. Ils en connaissaient la douleur particulière. Nous l’avions oubliée. Et voilà qu’elle s’abat sur notre quotidien, sans prévenir, en deux ou trois semaines. À l’heure actuelle, des malades partent à l’hôpital, et leurs familles ne les revoient plus jamais. C’est aussi le drame des EHPAD qui nourrit un terrible sentiment d’abandon chez les personnes âgées et de culpabilité pour leurs proches. »
Certes, ajoute l'historien, « il est absurde de comparer les pertes de la pandémie actuelle avec celles de la Première Guerre mondiale et de la grippe espagnole, beaucoup plus meurtrières. Mais du point de vue de nos rapports aux morts, la crise que nous traversons est tout aussi violente. Les soignants le confient également : voir repartir dans des housses les cadavres des victimes du Covid-19 est une expérience choquante. Dans des housses, et non plus sur des brancards. À New York, on envisage d’utiliser des parcs publics pour procéder à des inhumations provisoires. En France, une chambre froide de Rungis a été dédiée à l’accueil des cadavres. Est-ce que nous nous rendons bien compte de ce qui se passe en ce moment ? On assiste à des transgressions multiples dans les procédures d’accompagnement des morts et des survivants, et tout cela, répétons-le, en quelques semaines seulement. Il a fallu si peu de temps pour que nous basculions dans cette autre chose, que nous ne savons d’ailleurs toujours pas nommer. »
Que l’interruption des rituels de mort et l’inédit du confinement puissent provoquer des traumatismes importants n’implique pas toutefois que ces derniers soient similaires à ceux de la guerre. « C’est notre rapport au monde qui est en train de changer, poursuit Bruno Cabanes. Autrui est porteur d’une menace invisible. Et le danger s’est glissé dans l’ordinaire des gestes quotidiens, notamment de nos sens du contact et du toucher : par exemple, composer un code d’immeuble ou le distributeur bancaire. Je pense que cela va laisser des traces importantes dans notre rapport aux autres et au monde qui nous entoure. Depuis le 11-Septembre, nous étions entrés dans l’ère du soupçon. Nous basculons désormais dans une “haptophobie”, une peur du contact physique, portée à son apogée. Or, si les travaux des historiens nous permettent de saisir comment les sensibilités collectives, notamment les phobies sociales et les dégoûts, peuvent évoluer au fil des siècles, ils nous laissent plus démunis pour comprendre les processus sensibles de sortie de crise et de normalisation. »
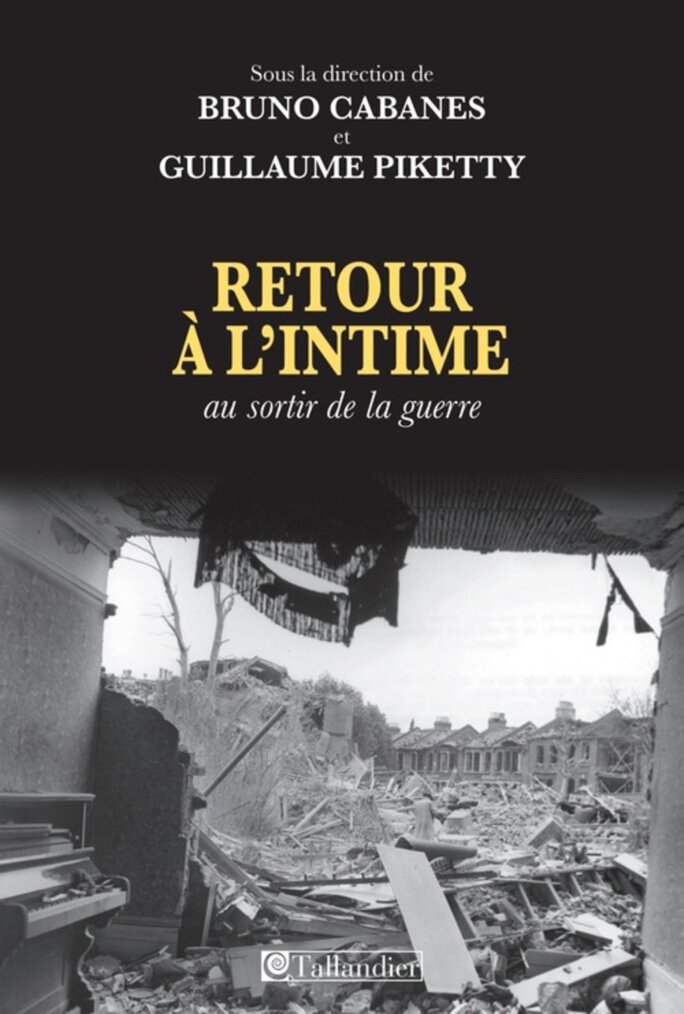
Agrandissement : Illustration 3

Pour Guillaume Piketty, codirecteur avec Bruno Cabanes de l’ouvrage Retour à l’intime au sortir de la guerre (Tallandier, 2009), « les crises et les guerres sont vécues de façon très différente selon les individus, et c’est une chose qu’il faut prendre en compte. Ainsi, dans la crise sanitaire actuelle, celles et ceux qui sortent des services d’urgence ou de réanimation doivent parfois faire face à des complications d’ordre cardiologique ou pulmonaire, ou encore à des pertes d’équilibre. Il faut déjà penser aux réponses qu’on apportera aux personnes qui affronteront de telles séquelles, à celles qui seront en deuil, ou celles qui devront accompagner les soignants traumatisés par le combat livré en première ligne. »
Quels que soient les parallèles qu’on puisse, ou non, dresser entre la crise présente et celles du passé, il existe des choses à apprendre de la façon dont se sont faites les sorties de guerre dans l’histoire. Guillaume Piketty, coauteur avec Bruno Cabanes d’un article pionnier intitulé « Sortir de la guerre, jalons pour une histoire en chantier » juge que le « premier intérêt d’étudier les sorties de guerre est que ces phases de transition disent énormément de la pâte humaine, parce que ce sont des temps durant lesquels beaucoup de choses bougent, au plan individuel comme au niveau collectif. Le concept de sortie de guerre va également à l’encontre de l’idée selon laquelle il y aurait un après-guerre qui, à un moment donné, succéderait à la guerre. Dans la plupart des cas, on ne sort en fait jamais complètement de la crise. On sait ainsi que le syndrome de stress post-traumatique peut concerner non seulement les combattants, mais aussi leurs enfants, voire leurs petits-enfants. En troisième lieu, l’étude des sorties de guerre montre qu’il est essentiel de ne pas s’intéresser seulement au plan macro, par exemple diplomatique, mais de se pencher aussi sur le micro, d’examiner ce qui se passe au niveau individuel. Dans la réflexion en cours sur l’après-Covid, citoyens et gouvernants doivent ainsi penser ensemble les deux étages : les décisions macros et les situations individuelles. »
Pour Bruno Cabanes, les sorties de guerre du passé permettent de prendre la mesure de ce qui nous attend : non pas un retour à l’identique, mais un processus lent, difficile, tortueux. « D’une certaine manière, la notion de “déconfinement” – l’un des mots clés de notre année 2020 – est aussi simplificatrice que celle de “démobilisation”, tant il existe de nuances et de rythmes variés. »
« Qui portera les réformes collectives, qui caractérisent d’habitude les sorties de guerre ? »
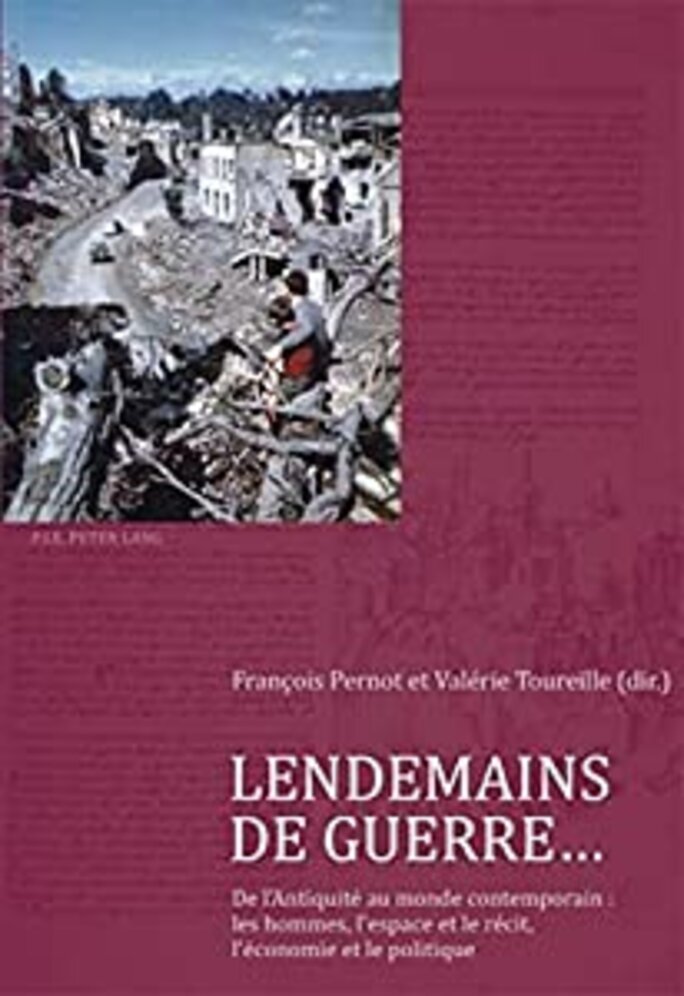
Qu’est-ce qui caractérise alors en général les lendemains de guerre ? Valérie Toureille, médiéviste et professeur à l’université de Cergy-Paris Université, a dirigé un ouvrage publié en 2010 intitulé Lendemains de guerre… De l’Antiquité au monde contemporain : les hommes, l’espace et le récit, l’économie et le politique, où les « lendemains » sont considérés comme une période complexe de transition, durant laquelle la souffrance et les déceptions côtoient l’espoir et l’apaisement, une période dont le trait dominant est l’instabilité, voire la violence.
En ayant fait le choix, dans cet ouvrage, d’une perspective diachronique, elle juge que « les lendemains de guerre se ressemblent à travers les époques car ils sont tous marqués par la difficulté des combattants à quitter la violence propre à la guerre pour retourner à la vie civile. La brutalisation née de la guerre ne s’interrompt pas quand la crise est formellement terminée, pour migrer parfois dans la société civile. »
Peut-on affirmer que les lendemains de mobilisation sont des lendemains qui chantent, et ainsi imaginer un après-confinement joyeux ? Pour Valérie Toureille, « il existe des poussées de liesse, où l’on chante et où l’on danse, quand on proclame des trêves ou qu’on signe des traités censés apporter la paix, mais cela reste très éphémère. Au cours de la guerre de Cent Ans, il y a de nombreuses trêves mais elles correspondent paradoxalement à des moments de tension, lorsque les soldats sont privés de soldes et vivent de pillages sur les populations civiles. »
Guillaume Piketty note que « la sortie de crise va le plus souvent de pair avec un soulagement ressenti au plan individuel et sur lequel les pouvoirs publics peuvent faire fond », mais que « ce soulagement peut néanmoins être mitigé. Ainsi, à la Libération, nombre de résistantes et de résistants ont vu leur joie assombrie par le deuil ou du fait de l’anxiété générée par l’absence de nouvelles de certains de leurs proches ».
Si l’allégresse des lendemains de guerre fait largement partie des images d’Épinal, dans quelle mesure la crainte que « cela recommence » pèse-t-elle sur les temps d’après-crise ? Et jusqu’à quel point les populations touchées adaptent-elles leur mode de vie à la crainte d’un retour du malheur ? « Pour la période médiévale, répond Valérie Toureille, on voit des communautés rurales tenter de se protéger, en se fortifiant sur des îles, en s’installant dans des souterrains, mais aussi en se déplaçant dans les forêts. En Normandie se crée ainsi toute une résistance populaire, qui alimentera une part de notre conscience collective, et dont l’épopée de Jeanne d’Arc participe. »
Bruno Cabanes rappelle que « par son intensité et sa violence extrême, la “der des ders” avait porté la guerre à son apogée. Ses contemporains aspiraient à une paix universelle. À l’inverse, notre projection vers l’avenir est plus difficile. À l’heure actuelle, qui sait quand et comment la pandémie se terminera ? Nous n’avons pas encore de vaccin, les effets de la crise économique risquent d’être désastreux. Et, comment ne pas craindre que nous soyons véritablement entrés dans une époque nouvelle, où des pandémies récurrentes déstabiliseront nos comportements sociaux, nos relations internationales, notre commerce, et jusque notre vie intime ? »
Quand les grandes crises se terminent, même si c’est de manière discontinue et à des rythmes différents pour les personnes impliquées de manière hétérogène, recherche-t-on alors en général plutôt le statu quo ante ou de nouvelles perspectives ? Valérie Toureille juge qu’on observe souvent « dans les lendemains de crise, un dynamisme démographique, économique, créatif. Il est remarquable de souligner que la Renaissance et l’Humanisme se développent durant la guerre de Cent Ans. Et c’est aussi un moment où les penseurs politiques réfléchissent à la question de la souveraineté et à la nature de l’État et des institutions. »
Pour Guillaume Piketty, « on retrouve les deux sentiments, avec une envie de retour à une vie “normale”, mais aussi le désir de mettre en place de nouvelles formules, à l’instar de celles qui, à la Libération, découlèrent du programme du CNR et des propositions élaborées à Londres puis à Alger sous l’égide du Comité national français et du Comité français de la libération nationale ».
Alors que les après-guerres du XXe siècle manifestaient un espoir de renouveau des relations internationales, illustré par la création de la Société des Nations, de l’Organisation des États-Unis ou de la Communauté économique européenne, nous avons assisté depuis quelques semaines, souligne Bruno Cabanes, « à une accélération de la crise du multilatéralisme sous toutes ses formes. Pour tous ceux qui croyaient dans l’idée européenne, c’est une épreuve supplémentaire. » Et d’ajouter : « Qui portera les réformes collectives, qui caractérisent d’habitude les sorties de guerre ? Il faudra beaucoup d’énergie à nos contemporains affaiblis par la menace sanitaire et la crise économique pour s’inventer un avenir. À moins que ce ne soit l’énergie du désenchantement et de la colère. »
Une autre question qui se pose pour l’après est celle des responsabilités. Les sorties de guerre sont-elles en général des moments de pacification ou de règlements de comptes ? Pour la période médiévale, Valérie Toureille repère effectivement « un temps d’amnistie, au nom de l’apaisement général ». Guillaume Piketty juge, lui, qu’il est « impossible d’établir une règle générale ». Il ajoute faire aujourd’hui partie de « ceux qui pensent que, sans accorder de blanc-seing, il faut d’abord laisser agir ceux qui nous gouvernent, considérer qu’ils font de leur mieux dans une situation très exceptionnelle, et leur savoir gré de nous conduire à travers les rapides. Ensuite, le possible apaisement post-crise dépendra des réponses qui seront alors apportées, car le temps du soulagement est aussi celui où l’on fait les comptes et où l’on mesure l’ampleur des blessures. »


