Une révolution est donc en cours en Tunisie. Son issue reste incertaine: si le dictateur Ben Ali est parti à l'étranger, vendredi 14 janvier, signant son crime par sa fuite, son système est toujours en place. C'est une révolution de palais qui tente d'enrayer la révolte populaire. De fait, la transition est assurée par des fidèles du pouvoir déchu, d'abord son premier ministre, Mohamed Ghannouchi, puis le président du Parlement, Foued Mebazaa, nommé samedi 15 janvier président de la République par intérim.
Rien ne garantit encore ce processus véritablement démocratique qu'ont réclamé les partis d'opposition lors d'une conférence de presse à Paris, avec amnistie générale, abrogation des lois liberticides et organisation d'élections libres. De plus, nombre de leurs dirigeants, dont Moncef Marzouki du Congrès pour la République ou ceux du parti islamiste Ennahda, ne sont pas encore rentrés de leur exil forcé à l'étranger. Quant aux clientèles du régime, elles ne se laisseront pas faire, comme l'ont montré leurs récentes exactions : n'estime-t-on pas à 100.000 les employés du ministère de l'intérieur (soit près d'un Tunisien sur 100) et à un million (soit près d'un Tunisien sur 10) les membres du parti de fait unique au pouvoir, le RCD ?
Mais l'ampleur de la révolution de jasmin est d'ores et déjà incommensurable. Par son courage, le peuple tunisien vient de montrer aux habitants du monde arabo-musulman, du Maghreb au Machrek, qu'il n'y a pas de fatalité à la servitude et que des régimes apparemment inébranlables peuvent s'effondrer sous le poids de leurs injustices et de leurs impostures. Les Egyptiens, par exemple, qui supportent l'indétrônable Hosni Moubarak depuis plus de trente ans – il fut « élu » pour la première fois le 14 octobre 1981, et réélu en 1987, 1993, 1999 et 2005 avec des scores souvent supérieurs à 80% –, ne peuvent que méditer l'audace de la rue tunisienne qui met fin à plus de vingt-trois ans de présidence Ben Ali – il avait déposé pour sénilité son mentor Habib Bourguiba (1903-2000) le 7 novembre 1987.
Or tous ces pouvoirs plus ou moins autoritaires, qui désespèrent les espoirs de la rue arabe et donnent ce visage d'immobilisme politique à la région, sont soutenus par les puissances occidentales, activement ou silencieusement. La menace islamiste est leur caution et leur alibi. Caution de leur existence intouchable : retournant à leur profit l'idéologie du choc des civilisations, ils se posent en rempart contre l'extrémisme musulman. Alibi de leurs crimes impunis : partenaires de la ténébreuse guerre antiterroriste, ils y trouvent des excuses pour leurs violations des droits et leurs vols des richesses. La vérité est pourtant qu'ils ont enfanté cet islam politique, non seulement en trahissant leurs promesses initiales mais, souvent, en étant les premiers à utiliser l'arme religieuse pour mater, par le passé, les contestations sociales et démocratiques qui les ébranlaient.
Telle est la radicale nouveauté introduite par l'insurrection tunisienne : le retour au premier plan de la question démocratique et de la question sociale, indissociables. Qu'il s'agisse de l'Afrique du Nord ou du Proche-Orient, c'est le surgissement d'un message d'espoir après tant de décennies dominées par la régression religieuse, les replis identitaires et les affrontements sectaires. Se battre pour la liberté et l'égalité, pour le droit de s'exprimer et le droit de travailler, pour le droit d'avoir des droits tout simplement, c'est échapper aux identités immuables et aux communautés fermées. C'est chercher et inventer ce qui rapproche et rassemble, au lieu d'exacerber ce qui divise et ce qui éloigne. C'est en somme construire ensemble un avenir politique dont l'exclusion et l'intolérance ne seraient plus les normes. Un avenir où la raison l'emporterait sur la croyance.
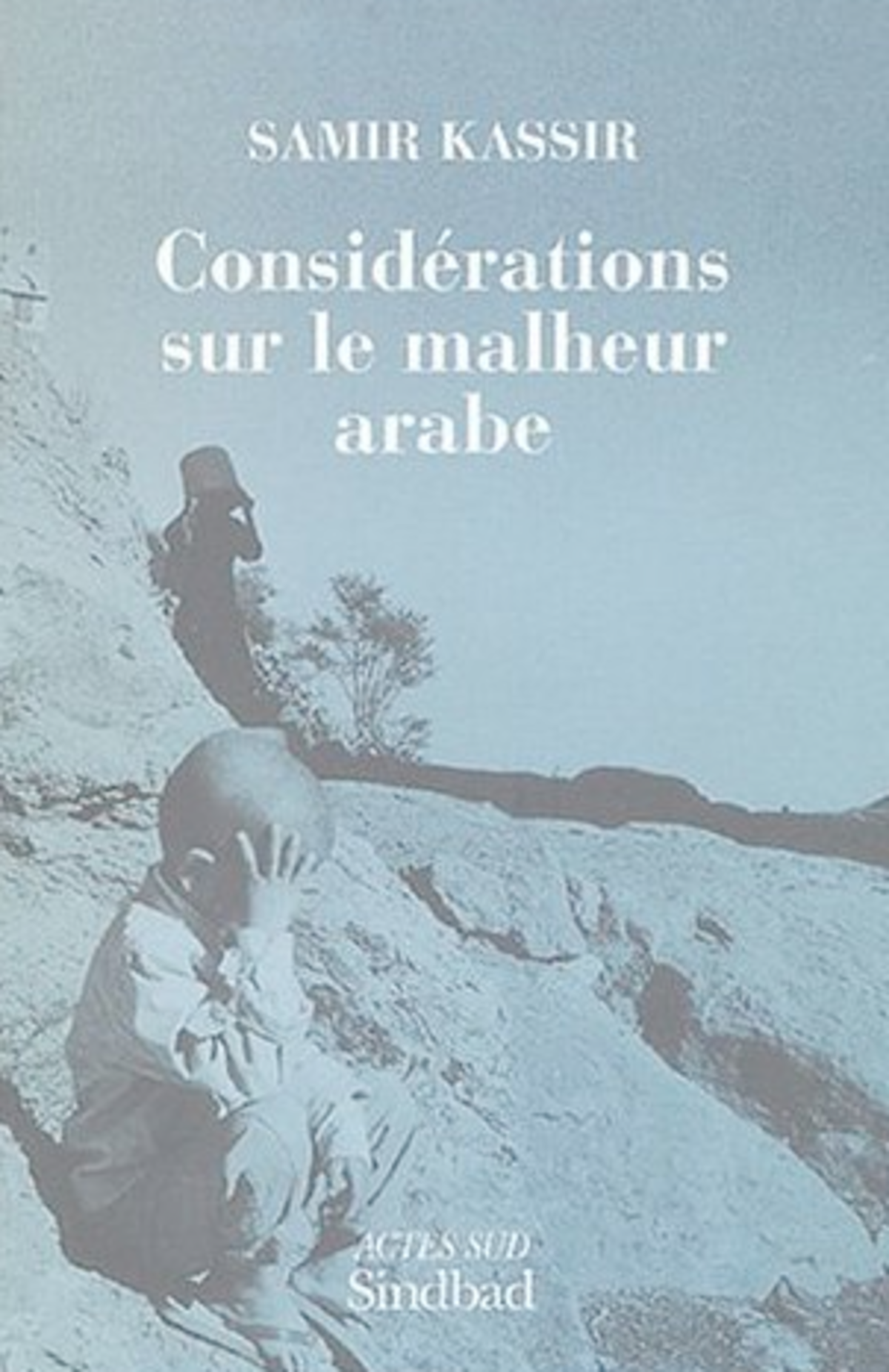
Sous réserve qu'elle ne soit pas défaite ou trahie demain, la révolution tunisienne vient de rompre à la face du monde ce cercle infernal du « malheur arabe », décrit peu avant son assassinat en 2005 à Beyrouth par notre confrère Samir Kassir. En portant haut l'exigence sociale et la revendication démocratique, elle fait tomber les masques des acteurs de l'affrontement binaire entre extrémismes religieux et dictatures laïques, ce jeu de dupes si dramatique et tragique pour les peuples concernés. « Si l'islamisme n'est pas – ou n'est plus – un agent de l'étranger, écrivait Kassir, c'est à l'étranger qu'il donne raison. Justifiant le clash des civilisations, l'assumant même, il est ce qui donne aux partisans de la croisade l'occasion de se croiser et à l'Occident d'employer tous les moyens que lui permet sa capacité technologique pour maintenant sa suprématie sur les Arabes. Et perpétuer leur impuissance. »
En secouant ce fardeau d'impuissance où se terrait la servitude volontaire, le peuple tunisien est sorti de ce piège où l'on enferme les peuples du monde arabe, leur vitalité et leur jeunesse, ne leur laissant le choix qu'entre des libertés perdues contre la religion ou des libertés perdues à cause de la religion, sacrifiées pour s'en protéger ou piétinées pour y succomber. Ce faisant, il en a brusquement révélé l'imposture. En s'effondrant tel un personnage de carton-pâte dans sa fuite peu glorieuse, le président Zine el-Abidine Ben Ali, ce rempart de l'Occident laïc contre un Orient islamique est allé se réfugier en Arabie saoudite, ce foyer de l'intégrisme musulman moderne issu d'une dissidence sectaire, le wahhabisme, promue par la manne pétrolière.
L'aveuglement des élites gouvernementales françaises
La révolution de jasmin est aussi un impitoyable révélateur pour la France qui, jusqu'en 1956 et depuis 1881, fut en Tunisie la puissance coloniale. Le peuple français découvre soudain que ses dirigeants, non contents de mener des politiques socialement injustes et de privatiser à leur seul profit l'exercice du pouvoir, le trompent sur l'état du monde. Il comprend avec étonnement qu'ils mentent, par intérêt ou par aveuglement, en politique étrangère comme en politique intérieure. Leur cécité stupéfiante sur la crise tunisienne, au point de ne pas prendre la juste mesure des événements en cours, montre qu'ils n'entrevoient peuples et nations, cultures et religions, défis géopolitiques et enjeux diplomatiques qu'à travers des lunettes déformantes, voilées par l'idéologie et mensongères sur la réalité. Celles d'un conflit, qu'ils fantasment ou qu'ils alimentent, avec un Orient réduit à sa caricature islamiste.
C'est ainsi qu'en 2009, même les alliés occidentaux de la France avaient été surpris par les déclarations intempestives de Nicolas Sarkozy au lendemain de l'élection présidentielle iranienne. Il avait été le seul à dénoncer d'emblée « l'ampleur de la fraude » alors que les Britanniques se contentaient d'émettre de « sérieux doutes » sur les résultats et les Américains de se dire « très troublés » par la répression. On avait ainsi pu entendre le président français, depuis le Gabon où il enterrait ce contre-exemple de vertu démocratique que fut Omar Bongo, vanter « la rue iranienne, les jeunes, les femmes qui disent “On veut la liberté, on veut s'exprimer” ». Si la rue tunisienne n'a pas eu droit à cet hommage, c'est évidemment parce que sa révolte dérangeait les préjugés idéologiques qui animent cette présidence : l'une, en Iran, bousculait un pouvoir islamique ; l'autre, en Tunisie, conteste une présidence laïque. Et, du coup, les principes sont à géométrie variable...
Tout internaute peut désormais contempler, jusqu'au ridicule, le désastre sinon pour l'intelligence, du moins pour la lucidité que produit cette grille de lecture, aussi étroite pour l'esprit que trompeuse sur la réalité. C'est sur le réseau social Facebook (ainsi que sur le blog d'ereclus à Mediapart), et cela se nomme « Ben Ali Wall of Shame », autrement dit le mur de la honte. Une ironique vidéo y résume, en extraits sonores, ce soutien apporté jusqu'à la dernière heure à la dictature de Ben Ali par la majorité de droite au pouvoir depuis 2002. Pas question, cette fois, de « donner des leçons » ni de « juger de l'extérieur », mais en revanche hommage à ce président « mal jugé », défenseur des vrais droits de l'homme selon Jacques Chirac et bien loin d'incarner « une dictature univoque », selon la curieuse expression de l'actuel ministre de la culture, Frédéric Mitterrand, dont on attend encore la définition d'une « dictature non-univoque ».
Sur ce mur qui nous fait honte, on réécoute aussi la ministre des affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie, proposer, il y a à peine quelques jours, comme seule preuve de solidarité avec le peuple tunisien, « le savoir-faire reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité ». On réentend enfin Nicolas Sarkozy, en 2008, affirmer lors d'un voyage officiel en Tunisie que « l'espace des libertés progresse » et que « ce sont des signes encourageants ». « Certains sont bien sévères avec la Tunisie, qui développe sur bien des points l'ouverture et la tolérance », avait ajouté le président français. Les « bien sévères », en l'occurrence, ne sont autres que toutes les organisations internationales de défense des droits de l'homme, de Human Rights Watch à Amnesty International, en passant par la FIDH.
Mais la droite n'a pas l'exclusivité de cet aveuglement, largement partagé au sein de la gauche socialiste. François Mitterrand eut aussi son compliment pour le régime tunisien, notamment en 1991, tandis que l'actuel maire de Paris, Bertrand Delanoë, tente aujourd'hui de faire oublier ses déclarations inconsidérées, en mars 2010, sur « la bonne voie » tunisienne. Après tout, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), le parti quasi unique créé par Ben Ali, n'est-il pas toujours membre de l'Internationale socialiste, au même titre que le PS français ? Comme l'est d'ailleurs le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo, soutenu dans son actuelle volonté de s'accrocher au pouvoir malgré sa défaite électorale par un ancien ministre socialiste des affaires étrangères, Roland Dumas.
Ce rapprochement entre deux contextes fort différents, le tunisien et l'ivoirien, souligne l'autre dimension de l'aveuglement français, au-delà de l'obsession du rempart laïc face à l'islamisme – utilisée également en Côte d'Ivoire contre le rival de Gbagbo, Alassane Ouattara, qui est de confession musulmane. Qu'il s'agisse de ses débats intérieurs ou de sa politique extérieure, la France, telle que l'expriment la majorité de ses élites gouvernementales, de droite ou de gauche, n'est toujours pas entrée dans une relation véritablement post-coloniale avec les anciens territoires dont la possession lui a fait croire, jusqu'au mitan du siècle passé, qu'elle était une « très grande France » sur laquelle le soleil ne se couchait jamais. Le traumatisme d'une décolonisation si peu maîtrisée qu'elle devint une sorte de guerre civile, enfantant entre 1958 et 1962 des institutions dignes d'un Etat d'exception, pèse toujours sur sa relation au monde, ses impasses, ses imprévoyances et ses impuissances.
Le soutien aveugle à la dictature orwellienne de Ben Ali, aux apparences de civilité et aux réalités de violence, n'est qu'un nouvel épisode de cet entêtement qui produisit aussi bien les longues corruptions de la Françafrique que ce « Notre ami le roi » marocain que fut Hassan II, ce despote criminel, sans oublier la solidarité tacite avec les « éradicateurs » du pouvoir militaire algérien qui surent utiliser la guerre contre l'islamisme pour prolonger leur domination rapace. Dans le même mouvement, cette France officielle ne cesse d'instrumentaliser politiquement la question immigrée à l'intérieur des frontières de l'Hexagone, tout en restant incapable d'envisager un avenir authentiquement démocratique pour les pays dont ils proviennent.
Dans les deux cas, les peuples sont exclus, comme si les populations anciennement colonisées ne devaient toujours pas être bénéficiaires de cette libre invention que l'on nomme, depuis les Lumières européennes, le droit naturel : le droit d'avoir des droits parce que l'on est né homme ou femme. Le droit de les réclamer et de les défendre. Le droit de les créer aussi. Assignés, en France, à une exigence d'assimilation, vieux mythe colonial où l'Autre (l'indigène hier, l'immigré aujourd'hui) est sommé de s'oublier et de s'effacer pour être accepté, ces populations sont ainsi renvoyées au sein de leur pays, par cet aveuglement de nos propres gouvernants, à une exigence de soumission, où la liberté n'est tolérée qu'à la condition du conformisme et du suivisme, donc, là encore, de l'oubli de soi.
C'est l'autre message français de la révolte tunisienne : l'appel à ce que la France se réveille définitivement de cette longue torpeur qui, de bilan positif de la colonisation en débat sur l'identité nationale, l'entraîne en arrière dans une régression pathologique, loin du monde tel qu'il se réinvente et se décentre, mais au plus près des traumatismes de cette histoire non assumée et non dépassée que fut une décolonisation tragique et tardive.
Dominique Strauss-Kahn, le FMI et la Tunisie
Ce n'est certes qu'une victime collatérale, mais, au détour de la crise tunisienne, on tombe inévitablement sur l'une de ces nombreuses embuches qui paveront le chemin présidentiel de Dominique Strauss-Kahn, s'il est d'aventure candidat aux primaires socialistes. En faisant le choix de déserter, au lendemain de l'élection en 2007 de Nicolas Sarkozy, la vie politique nationale pour le Fonds monétaire international (FMI), l'ancien ministre socialiste de l'économie a pris le risque d'un héritage difficilement compatible avec une alternative crédible à l'ordre politique, économique et social dominant tel qu'il est incarné par l'actuelle majorité présidentielle.
Dans son rôle de directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn a fait l'éloge du modèle économique tunisien (voir la vidéo ci-dessous), sans un mot public pour sa dimension politique. Son propos était en cela conforme aux rapports de son institution, dont la vision des ressorts d'une saine croissance économique est très éloignée de l'insistance du Nobel d'économie Amartya Sen sur le développement humain, toutes ces conditions non quantifiables qui tirent une société vers un horizon d'espoir et d'invention.
De cette novlangue économique, sourde aux exigences démocratiques et saturée de notions financières, on trouvera un modèle dans le plus récent rapport du FMI (août 2010) sur la Tunisie, créditée d'avoir « bien surmonté la crise mondiale, qu'elle a abordée avec des fondamentaux solides qui sont en grande partie le résultat des politiques prudentes du passé ». Pourtant, même l'OCDE, peu suspecte de subversion, s'était sentie obligée, en 2007, de souligner que, « malgré quelques signes d'ouverture », « le pays affiche de faibles performances en matière de gouvernance politique et de libertés d'expression ». Il est vrai que cette réserve se concluait sur le constat cynique d'un troc qu'auraient accepté « la majorité des Tunisiens », où « le manque de libertés politiques (serait) le prix à payer pour la stabilité et le développement économique et social ».
Il est toujours risqué de parler à la place des peuples qui, du coup, comme les volcans, se réveillent sans qu'on y prenne gare. Du bon élève tunisien au mauvais garnement grec, le FMI sera donc pour Dominique Strauss-Kahn un handicap durable, tant la culture de cette institution est extérieure aux légitimités démocratiques et populaires. Cette culture de l'expertise, verticale et lointaine, sans assise ni ancrage, rend en effet aveugle aux réalités économiques les plus prosaïques telles qu'elles sont vécues par les populations. Il n'était pas difficile, du moins pour un économiste non soumis aux exigences des marchés, de voir l'économie tunisienne sous un autre jour, celui de la corruption, du clientélisme et de l'endettement.
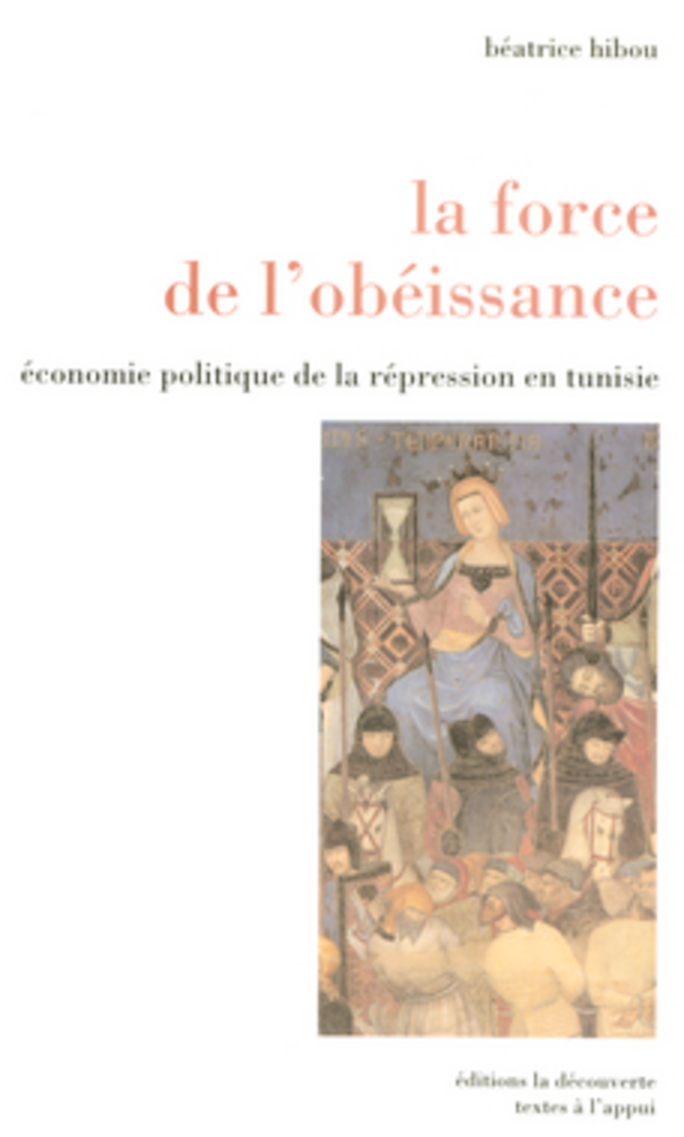
Par exemple, La Force de l'obéissance, livre de Béatrice Hibou sous-titré Economie politique de la répression en Tunisie et fruit d'une longue enquête de terrain, dévoilait en 2006 l'envers du soi-disant miracle économique. La pratique généralisée de la corruption et des illégalismes y produit, écrivait-elle, « un travail subtil de normalisation sous les traits de la participation obligatoire à un système d'échanges, de privilèges, de passe-droits ». Un « économie de l'endettement », aussi bien pour les ménages que pour les entreprises, y crée une fiction économique dont la face cachée est la fraude fiscale et la combine permanente, le clientélisme le plus sommaire régnant en maître sur l'apparente modernisation.
De cette réalité ignorée par les rapports du FMI, les télégrammes secrets américains dévoilés par WikiLeaks témoignent abruptement, avec une franchise peu diplomatique. « La famille élargie du président Ben Ali est fréquemment présentée comme le carrefour de la corruption en Tunisie », lit-on dans celui du 23 juin 2008 intitulé « Corruption en Tunisie : tout ce qui est à vous est à moi ». « Souvent qualifiée de quasi mafia, une vague allusion à “la Famille” suffit à indiquer de laquelle vous voulez parler, poursuit ce câble envoyé au département d'Etat par l'ambassade de Tunis. Il semble que la moitié de la communauté tunisienne des affaires peut se targuer d'être liée aux Ben Ali par un mariage, et nombre de ces relations ont su profiter à plein de leurs connexions familiales. »
En partie traduit par Le Monde, ce long télégramme contient une description détaillée du pillage des richesses tunisiennes par le clan Trabelsi – la belle-famille de Ben Ali. Un second télégramme plus récent, de même provenance et du 16 juin 2009, ajoute d'autres détails dont l'un, s'il était confirmé, serait embarrassant pour la France. Sous l'intertitre « The French Connection ? », il suggère, mais sans apporter de preuves, qu'un ambassadeur de France, récemment en poste à Tunis, aurait été plutôt celui de Ben Ali auprès de Nicolas Sarkozy que l'inverse, en échange de quoi il aurait été bénéficiaire d'une villa enregistrée au nom de sa fille et située non loin de la résidence présidentielle.
Sans doute ces assertions et ces rumeurs trouveront-elles enfin leurs vérifications ou leurs démentis si la révolution de jasmin enfante d'une justice indépendante et d'une presse libre. Peut-être aura-t-on alors le fin mot sur une histoire largement traitée par Mediapart à ses débuts, et d'ailleurs reprise dans les télégrammes américains, du vol d'un yacht de luxe dans le port corse de Bonifacio commandité par deux neveux de l'ex-président tunisien dont l'un, Imed, est mort après avoir été poignardé, dans la journée confuse du vendredi 14 janvier. Les révolutions ont aussi cet intérêt qu'elles ouvrent les boîtes à secrets et mettent à nu les misérables ressorts des oppressions.
Les Tunisiens donnent raison à Stéphane Hessel
Certes l'espoir tunisien est fragile, et la prudence de mise. La solidarité aussi, sinon surtout, tant ce qui se joue en Tunisie nous concerne au premier chef. De la même manière que les divers outre-mers, ces buttes-témoins de notre histoire coloniale, sont une chance pour inventer une relation au monde qui ne soit pas de repli, de crispation et d'uniformisation – de peur, en somme –, l'avenir de la France se joue dans la nouvelle interdépendance qu'elle saura susciter et construire avec les peuples du Maghreb, dont sont issus nombre de nos compatriotes. C'est donc de nous aussi qu'il s'agit, sur l'autre rive de la Méditerranée.
Par son audace, le peuple tunisien nous secoue de notre langueur et nous montre l'exemple. Après tout, n'est-ce pas lui qui vient de traduire en pratique l'appel de Stéphane Hessel, cet Indignez-vous ! qui approche du million d'exemplaires imprimés ? Tandis que blasés et installés, toutes ces « âmes habituées » comme aimait dire Charles Péguy (1873-1914), ironisaient sur ce manifeste, ses supposées naïvetés et ses prétendues généralités, les manifestants tunisiens avec leurs nombreux martyrs en illustraient le message aussi concret que pertinent.
« La pire des attitudes est l'indifférence, dire “Je n'y peux rien, je me débrouille”, écrit Hessel. En vous comportant ainsi, vous perdez l'une des composantes essentielles qui fait l'humain. Une des composantes indispensables : la faculté d'indignation et l'engagement qui en est la conséquence. » En s'appuyant sur sa fidélité aux idéaux de la Résistance pour combattre l'égoïsme des possédants, prisonniers de leurs peurs, ce diplomate, qui fut d'ailleurs en poste en Algérie dans les années 1960, retrouve cette exigence vitale portée, dès le XVIe siècle, par Etienne de la Boétie (1530-1563) avec son Discours de la servitude volontaire.
« Le motif de base de la Résistance était l'indignation », rappelle Hessel, c'est-à-dire ce simple refus de l'insupportable et de l'injustifiable, ce refus immédiat qui vaut programme futur par la dynamique qu'il crée et suscite. «Je désirerais seulement qu'on me fît comprendre, s'interrogeait déjà La Boétie, comment il se peut que tant d'hommes, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois tout d'un Tyran seul, qui n'a de puissance que celle qu'on lui donne, qui n'a pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer. » La réponse apportée par le peuple tunisien montre qu'avant de se refermer sur l'humanité comme une fatalité, l'avenir dépend d'abord de nous, de chacun de nous.
Telle est la clé du succès de Stéphane Hessel : ce message de responsabilité qui nous invite à ne plus subir, dans l'accommodement silencieux ou dans l'isolement solitaire. Se référant à Jean-Paul Sartre (1905-1980), dont il avait suivi les traces à l'Ecole normale supérieure en 1939, il rappelle le cœur de sa philosophie que l'on nomma « existentialisme » : « Vous êtes responsables en tant qu'individus. » « C'était un message libertaire, commente Hessel. La responsabilité de l'homme qui ne peut s'en remettre ni à un pouvoir ni à un dieu. Au contraire, il faut s'engager au nom de sa responsabilité de personne humaine. »
Ceux qui ont reproché à Indignez-vous ! de ne contenir aucun programme clé en mains, alors même que ses idéaux d'une « République démocratique et sociale » sont plus que jamais d'actualité, contournent son message essentiel parce qu'il les dérange et les inquiète. Ils ont senti cette menace qu'ils aimeraient conjurer, celle où l'avenir s'invente sans programme pré-établi par la dynamique autonome d'hommes et de femmes libres, d'individus librement associés et librement révoltés. Celle où la société s'auto-organise par en bas, sans plus attendre qu'on lui dise d'en haut quelle direction suivre.
Mohamed Bouazizi n'avait pas de programme ni de parti. Mais il s'est indigné, jusqu'à y perdre la vie. Et de ce sacrifice est né une révolution. Premier martyr de la révolte tunisienne, ce jeune diplômé chômeur de 26 ans s'est immolé, le 17 décembre 2010, devant la sous-préfecture de Sidi Bouzid parce que les autorités l'empêchaient de vendre ses fruits et légumes faute d'autorisation. Il fallut ce cri de désespoir pour secouer la résignation qui, sous toutes les latitudes, tient trop souvent lieu de réalisme politique.
« Créer, c'est résister. Résister, c'est créer » : ce sont les dernières lignes de Indignez-vous ! et elles valent bien des programmes électoraux : l'avenir dépend de chacun de nous et sera d'abord ce que nous saurons en faire. Qui sait si, d'une rive à l'autre de la Méditerranée, cette révolution de jasmin ne nous donnerait pas le goût, ici même, d'un sursaut démocratique aussi libre que l'est cette autre fleur, printanière et rougeoyante, à l'éclat indocile et sauvage, le coquelicot ?

Agrandissement : Illustration 5



