Depuis qu’elle a éclaté, l’affaire fait grand bruit au Maroc. Elle suscite la sidération dans les milieux militants et dans les rédactions. Elle déchire cœurs et consciences entre deux luttes cruciales : d’un côté, le combat contre les violences sexuelles et sexistes ; de l’autre, l’engagement contre la répression des voix et des plumes libres. Ce mardi 22 septembre comparaît devant la justice marocaine un des journalistes d’investigation les plus en vue, une des rares voix critiques dans les médias, défenseur des droits humains : Omar Radi.
Les dossiers ne sont pas disjoints : le jeune homme doit répondre des accusations d’« atteinte à la sûreté extérieure de l’État [en entretenant avec des agents étrangers] des intelligences ayant pour objet de nuire à la situation diplomatique du Maroc », d’« atteinte à la sûreté intérieure de l’État [en recevant une rémunération étrangère] pour [...] ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l’État et aux institutions du peuple marocain », d’« attentat à la pudeur avec violences », de viol, d’infraction au code général des impôts marocain et d’évasion fiscale.
C’était au cœur de l’été, le 30 juillet puis le 3 août. Dans les colonnes d’AtlasInfo, un site basé en France, dédié à l'actualité du Maroc et du Maghreb, Hafsa Boutahar, une jeune femme, employée en freelance, pour des missions commerciales et administratives au Desk, un site d’information dédié à l’investigation, accuse le journaliste et militant des droits de l’homme Omar Radi, depuis longtemps dans le collimateur du pouvoir, de l’avoir violée lors d’une soirée chez leurs patrons, Ali Amar et Fatima-Zahra Lqadiri, dans la nuit du 12 au 13 juillet 2020.

« J’ai décidé de ne parler qu’une seule fois pour que les gens sachent la vérité. » Si Hafsa Boutahar prend la parole, dit-elle, c’est que sur Facebook, Omar Radi, incarcéré le 29 juillet à la prison d’Oukacha, à Casablanca, six jours après le dépôt de la plainte de la jeune femme, livre selon elle « des mensonges dégoûtants ». Il parle d’une « relation consentie entre deux adultes », d’un « piège », d’une « machination ». Le journaliste se trouve déjà derrière les barreaux ; son message est relayé sur la page de son père, Driss Radi.
« Je ne peux pas rester les bras croisés et le laisser dire ce qu’il veut pour me salir. Mon avocat considère que c’est une violation grave du secret de l’instruction », s’indigne la plaignante qui donne en détail sa version des faits à AtlasInfo et décrit « la boule au ventre ».
Hafsa Boutahar explique avoir hésité dix jours avant de décider de déposer sa plainte le 23 juillet auprès du procureur du roi parce qu’elle ne voulait pas nuire à ses employeurs « qui l’ont toujours bien traitée », qu’elle avait « peur du scandale », de la « hchouma », la honte en arabe dialectal, ce mot qui sert à taire au Maroc les tabous liés au corps, au genre, à la sexualité, aux violences contre les femmes comme le harcèlement sexuel et le viol.
« S’il n’était pas allé parler de moi dans les bars en riant de ce qu’il m’avait fait subir, peut-être que je me serais tue comme la plupart des personnes qui se font violer, explique-t-elle à AtlasInfo. Vous croyez vraiment que c’est facile de s’adresser à la justice pour ce genre de choses dans une société comme la nôtre ? Que c’est facile de prendre le risque qu’on vous réponde que vous l’avez peut-être bien cherché ? Qu’on se demande ce que vous faisiez là ? Je me suis posé mille fois la question : allait-on m’aider ? Omar Radi est très connu et a de nombreux soutiens et moi, je n’ai rien. »
L’homme que Hafsa Boutahar accuse n’est pas n’importe qui. Omar Radi, 34 ans, est dans le viseur de la monarchie depuis des années. En cause : les prises de position critiques de cet électron libre, ses activités politiques, ses enquêtes journalistiques sur l’économie de rente, la corruption, la spoliation des terres, la collusion entre le Palais et les affairistes, la répression des mouvements sociaux dans les régions périphériques abandonnées par l’État, comme le Rif ou l’Oriental.
Emprisonné le 26 décembre 2019 à la suite d’un vieux tweet fustigeant la justice marocaine et les magistrats qui avaient confirmé en appel, le 6 avril 2019, la condamnation des porte-voix du soulèvement populaire dans le Rif à de très lourdes peines, le journaliste avait finalement été libéré quelques jours plus tard, sous la pression d’une mobilisation nationale et internationale inédite. Dans cette affaire, il a finalement écopé en mars dernier d’une peine de quatre mois de prison avec sursis.
Dans la foulée, un rapport d’Amnesty International a révélé que son téléphone avait été espionné via le logiciel Pegasus de la firme israélienne NSO, utilisé selon l’ONG par les autorités marocaines. Reprises dans une quinzaine de médias sous la coordination du collectif Forbidden Stories, ces révélations font scandale.
Prises la main dans le sac, les autorités marocaines ripostent. Le 25 juin, le procureur général près la Cour de Casablanca ouvre une enquête sur « l’implication présumée du journaliste dans une affaire d’obtention de financements étrangers en relation avec des services de renseignements ». Quand survient l’accusation de viol le 23 juillet, Omar Radi, repeint par le pouvoir en espion, a déjà répondu à une vingtaine de convocations de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ).
Depuis son incarcération, c’est la tétanie dans les cercles journalistiques et militants. Ceux qui osent mettre en doute ces accusations deviennent les cibles de menaces, d’intimidation. Ils sont traînés dans la boue. Des voix libres, pourtant rompues aux méthodes du régime, choisissent la retenue. La peur étend chaque jour un peu plus son ombre. « On est nombreux à s’être déconnectés des réseaux sociaux, épuisés par le harcèlement de meutes de trolls. Moi, j’ai supprimé WhatsApp même Signal, changé de téléphone. On en vient à s’écrire des lettres qu’on remet à des gens pour éviter de passer par la Poste, avec le risque d’interception », soupire une activiste.
Plusieurs figures de la lutte pour la défense des droits humains refusent tout simplement de s’exprimer sur cette affaire – « Le climat ne nous permet plus de parler » – ou préfèrent s’exprimer sous le couvert de l’anonymat.
« Omar Radi est devenu une ligne rouge, autant que le Sahara ou le Roi », lâche sous le couvert de l’anonymat une journaliste. « C’est trop risqué, trop éprouvant psychiquement, souffle-t-elle. Le régime fait payer quiconque soutient Omar ou remet en question la version officielle. Ils utilisent la vie privée des gens contre eux. C’est comme la Stasi en Allemagne de l’Est, tout le monde a peur, se voit comme le prochain sur la liste. » « Toute personne associée à Omar Radi est une cible potentielle de diffamation, d’attaques et même de poursuites judiciaires », confirme un avocat.
Dans ce climat oppressant, le doute s’installe, s’instille. Les féministes se divisent : certaines dénoncent l’instrumentalisation de la lutte contre les violences sexuelles, d’autres pointent la culture du viol qui déprécie la parole de la plaignante. Les trolls attaquent, une guerre des pétitions est lancée ; les « médias de diffamation » font leurs gorges chaudes de cette affaire.
Bien des journaux, nés sur la Toile dans le sillage des soulèvements arabes, dans la phase d’expansion de la presse numérique, sont suspectés d’être liés aux services de sécurité marocains. Ils ont relayé tout l’été, sur cette affaire, appels, lettres ouvertes et « révélations chocs ». Pour la première fois, au Maroc, des voix se sont levées pour dénoncer leur profusion et leur impunité judiciaire. Le 16 juillet, 110 journalistes marocains appelaient à des sanctions contre ces médias.
Au milieu du mois d’août, une pétition titrée « L’ombre est là », signée par 400 personnalités parmi lesquelles des artistes et des intellectuels de renommée, comme le poète Abdellatif Laâbi, l’écrivain Abdellah Taïa ou encore la cinéaste Leïla Marrakchi, a condamné « la répression policière », « les emprisonnements politiques », « le lynchage public » des dissidents dans les « médias réactionnaires de diffamation ».
Pour ces « 400 », ces journaux jouent « un rôle important dans les violations flagrantes des droits humains au Maroc ». Ils décrivent un climat répressif plus délétère encore depuis la pandémie de Covid-19 et l’état d’urgence, « les harcèlements et les emprisonnements des journalistes, les arrestations de citoyen.ne.s qui ont exprimé leurs opinions sur les réseaux sociaux, les violentes répressions des manifestations ».
Ils érigent en symbole les cas d’Omar Radi et celui de Hajar Raïssouni, une autre journaliste harcelée par le régime, condamnée en septembre 2019 à deux ans de prison pour avortement illégal et relations sexuelles avant d’être graciée par le roi sous la pression d’une mobilisation internationale.
« Guerre des manifestes »
Quelques jours plus tard, une contre-pétition, rassemblant 670 artistes et créateurs « qui font confiance aux institutions de leur pays », est venue contredire leur manifeste pour se réjouir de l’état des libertés individuelles au Maroc. Parmi les signataires, le peintre Mehdi Qotbi ou encore le poète Mostafa Nissabouri, cofondateur avec Abdellatif Laâbi de la célèbre revue Souffles qui incarnait dans les années 1960 la renaissance culturelle dans le Maghreb postcolonial.
Exilé en France depuis 1985 après avoir été emprisonné de 1972 à 1980, le poète Abdellatif Laâbi, soumis à la torture pendant les années de plomb, a été « surpris de voir de vieilles connaissances qui ont toujours signé les pétitions défendant la liberté d’expression » affirmer que tout va pour le mieux au Maroc.
« Cette guerre des manifestes est très significative. Sous le règne de Hassan II, le clivage était net entre le pôle intellectuel et le régime, se remémore-t-il. Les créateurs, à l’exception de quelques poètes de cour, étaient dans l’opposition, dans les revendications. Aujourd’hui, une partie du régime réussit en peu de temps à mobiliser des artistes pour certains respectables, d’autres totalement inconnus, pour affirmer qu’il n’y a pas d’atteinte aux libertés au Maroc. Le système est parvenu à creuser une fissure dans le monde intellectuel marocain. »
Hicham Daoudi, mécène de renom, patron de la maison de vente aux enchères Comptoir des mines de Marrakech, a brusquement retiré sa signature du manifeste des 400. Il assure n’avoir agi sous aucune pression des autorités. « J’avais fait confiance à un ami réalisateur, et dit oui un dimanche matin aveuglément croyant que c’était une tribune contre les islamistes mais j’ai vu qu’il y avait des relents politiques, justifie-t-il. Je travaille dans l’art au Maroc. On montre des choses très crues, jamais je n’ai affronté de censure, de répression. »
Cette guerre des tribunes a traversé la Méditerranée. En août, un texte publié sur le site Orient XXI et dans L’Humanité dénonçant « une machine répressive », soutenue par plus de 150 personnalités marocaines et françaises, a aussitôt suscité la réponse de 130 associations marocaines s’insurgeant contre « la diffusion d’informations trompeuses sur le Maroc ». Réaction relayée par la MAP, l’agence de presse officielle marocaine.
C’est seulement dans ces médias accusés d’user de la « diffamation » et de fabriquer des « fake news », que Hafsa Boutahar a choisi de raconter cette nuit du 12 au 13 juillet qui a vu sa vie basculer. La jeune femme a décliné toutes les sollicitations de Mediapart et L’Humanité.
« Je ne peux pas vous livrer de détails, car mon dossier est entre les mains du juge d’instruction. Je dois respecter la confidentialité et ne pas perturber l’enquête judiciaire », nous a-t-elle expliqué en anglais via la messagerie Signal, à l’heure d’une « visite chez le psychiatre ».
Hafsa Boutahar, qui refuse nos demandes d’entretien au nom du secret de l’instruction, a livré en exclusivité son témoignage le 30 juillet une semaine après son dépôt de plainte, puis le 3 août, à AtlasInfo, un site dirigé par Hasna Daoudi, une ancienne directrice du bureau parisien de la MAP, l’agence de presse officielle marocaine réputée pour sa porosité avec les renseignements marocains.
C’est elle qui signe ou cosigne les papiers concernant l’affaire Radi/Boutahar. Contactée, Hasna Daoudi ne souhaite pas s’exprimer sur « une affaire qui est entre les mains de la justice » ni sur son média lancé en 2011. Elle n’a « fait que son métier de journaliste en donnant la parole à une victime de violences sexuelles ».
La plaignante a encore répondu aux sollicitations du journal en ligne marocain Le360. Créé en 2013, il est très controversé pour le pseudonymat de ses plumes vindicatives, voire injurieuses envers les voix critiques. Le site est réputé proche du Palais et surtout de Mounir Majidi, le secrétaire particulier du roi Mohammed VI.
Atlas Info comme Le360 sont engagés depuis des mois, bien avant cette affaire de viol présumé, dans le harcèlement médiatique du journaliste Omar Radi et de ses soutiens, personnalités de la société civile ou ONG, Amnesty International en tête. Deux autres journaux liés aux services de sécurité et dirigés par deux hommes dont les trajectoires croisent la route du pouvoir, leur emboîtent le pas : Chouf TV et Barlamane.
Entre le 7 juin et le 15 septembre, l’ONG Human Rights Watch (HWR) a recensé pas moins de 136 articles attaquant Omar Radi, sa famille et ses défenseurs sur les sites d’information marocains Chouf TV, Barlamane et Le360, dans leurs versions arabes et françaises.
« Ces articles contiennent souvent des insultes vulgaires et des informations personnelles », relève l’ONG qui publie ce lundi 21 septembre un rapport dénonçant « des accusations pauvrement étayées » à l’encontre du journaliste. Ces médias liés au pouvoir « divulguent par exemple des documents bancaires ou fonciers, des captures d’écran de messages électroniques privés, des allégations sur des relations sexuelles (ou des menaces à peine voilées de les exposer), l’identité de colocataires et des détails biographiques remontant parfois jusqu’à l’enfance, sans oublier des informations sur les parents des personnes ciblées », résume HRW.
Chouf TV – une centaine de journalistes à travers le pays – est une machine à buzz, un phénomène médiatique. Son fondateur, Driss Chahtane, directeur du journal Al Michaal, a lui-même éprouvé les méthodes répressives du régime en 2009 : il a fini en prison pour avoir franchi l’une des lignes rouges fixées par le Palais en publiant un article sur la santé du roi. Gracié en 2010, Driss Chahtane, qui n’a pas répondu à nos demandes d’entretien, a opéré depuis sa libération un virage à 180 degrés. Pour s’installer dans le giron du pouvoir.
Aujourd’hui, son média arabophone, l’un des plus consultés au Maghreb, bien qu’il soit accusé de faire de la violation de la vie privée son fonds de commerce, a le don de débarquer avec ses caméras avant que l’événement n’ait lieu. Dans une interview au magazine Telquel, le patron de Chouf TV l’admet : « (Rires) Souvent, ce sont les personnes qui sont au cœur de l’événement qui prennent contact avec nous. »
« Ces personnes au cœur de l’événement » sont des citoyens mais aussi, bien souvent… les agents de la police politique.
Le cas de Omar Radi, qui a pris l’habitude de voir les caméras de Chouf TV lui coller aux basques, en témoigne. Le 5 juillet, un cameraman de la webtélé a passé la soirée dans sa voiture, à guetter la sortie du journaliste d’un bar du centre-ville de Casablanca où il se trouvait avec son collègue Imad Stitou. Lorsque les deux journalistes quittent les lieux vers 23 heures, il les filme. Ils le reconnaissent : ce même cameraman harcèle Omar Radi, il l’a filmé à chacune de ses convocations à l’entrée et à la sortie des locaux de la police judiciaire des lieux où il est strictement interdit de prendre des images…
Puisque l’envoyé de Chouf TV les filme, Omar Radi et Imad Stitou se mettent à le filmer eux aussi avec leurs téléphones. L’homme crie à l’agression. Moins d’une minute plus tard, une voiture de police, stationnée dans une rue adjacente, intervient pour embarquer les deux journalistes du Desk. Ils comprennent qu’ils sont tombés dans un guet-apens, sous la caméra de Chouf TV. Ils sont libérés le lendemain dans l’après-midi, après la campagne médiatique consécutive à la diffusion des enregistrements envoyés à leur rédaction.
Le cameraman, qui se rendra au poste de police avec son propre véhicule pour donner sa version de l’altercation, n’est pas mis en garde à vue, lui. Eux sont inculpés d’« ivresse manifeste sur la voie publique », violences et insultes. On leur reproche d’avoir filmé une personne sans son autorisation ; pour cette affaire, Omar Radi et Imad Stitou comparaîtront ce jeudi 24 septembre. Le cameraman n’aura à répondre que des deux derniers chefs d’accusation.
Pendant ce temps, Chouf TV diffuse ses images de l’incident, avec des voix off qualifiant les journalistes de « clochards », d’« ivrognes ». Omar est aussi traité d’« espion ». « Regardez ça, c’est Omar Radi, il est complètement saoul. Et son copain aussi est saoul. Regardez, ils sortent du bar bourrés. Et il vient me traiter de voleur, parce qu’il est saoul ! », crie le cameraman de Chouf TV.
La webtélé s’en donne à cœur joie. Ce n’est pas la première fois qu’elle couvre le journaliste de boue.
«Je ne sais pas comment affronter tout cela»
Fait troublant, dès le 17 juin, soit presque un mois avant les faits dénoncés par Hafsa Boutahar, Chouf TV présentait déjà Omar Radi comme un « violeur ». Dans un article au ton sarcastique, dans lequel il est surnommé « Omar Zatlaoui » (« Omar le fumeur de cannabis »), le site exhume un bref épisode du passé militant du journaliste : une université de printemps d’Attac Maroc aux Tamaris, dans la banlieue de Casablanca, en 2008.
Contacté, le témoin cité dément vigoureusement ces allégations : « C’est faux, jamais de tels faits se sont produits ce soir-là. On se retrouvait dans les chambres pour refaire le monde et ensuite tout le monde allait se coucher. » Secrétaire général d’ATTAC Maroc à l’époque, Youssef Mezzi se souvient qu’un « comité de vigilance faisait, la nuit, le tour du lieu d’hébergement pour rappeler à l’ordre les chambrées trop bruyantes et prévenir tout incident, tout problème », ce que confirment d’autres participants.
Surtout, la jeune femme citée par Chouf TV, qui a quitté le Maroc, tourné la page de ces jeunes années militantes, et qui n’a pas donné suite à nos demandes d’entretien, a réfuté elle-même catégoriquement ces accusations de viols dans un échange de message avec un activiste resté en contact avec elle, que nous avons pu consulter. Elle se montre d’abord incrédule, croyant à une «blague », puis s’indigne d’être ainsi désignée comme une victime de Omar Radi, un procédé « malveillant » et « mauvais », selon ses mots. Jamais de tels faits ne se sont produits, assure-t-elle, elle n’a même jamais eu de relation autre qu’amicale avec le journaliste.
Depuis cette date, la jeune femme a fermé toutes les écoutilles et tient à se tenir loin de ces sordides procédés. Par crainte d’être salie, explique son interlocuteur. La machine à lacérer l’intime, à broyer une réputation est, elle, bel et bien en marche. Et le scénario du viol d’une jeune femme par Omar Radi en présence de l’un de ses amis apathique s’ancre dans les imaginaires des millions de visiteurs du site. « S’il avait dirigé [l’organisation], il aurait violé toutes les femmes d’ATTAC au nom de la virilité internationaliste », ricane Chouf TV.
Mais dans la nuit du 12 au 13 juillet, que s’est-il passé ? Dans un mail daté du 25 juillet, adressé à un cercle d’amis proches aussitôt après avoir appris le dépôt par Hafsa Boutahar d’une plainte pour viol, Omar Radi se dit désarmé : « J’ai appris cela ce soir, je ne ressens plus rien. À quelques heures de l’interrogatoire de demain à la BNPJ, je ne sais plus vraiment quoi penser. Je ne sais pas comment affronter tout cela, ni si ça en vaut encore la peine. Je sais que mes paroles ne vaudront bientôt plus rien au regard de cette actualité, mais je jure sur mon honneur que je n’ai rien fait de mal, ni sans consentement. »
Il livre pourtant aux destinataires de ce mail sa version des faits. Pour décrire, comme il le fera plus tard dans sa déposition, une relation sexuelle consentie avec sa collègue. Les jeunes gens se sont rencontrés la première fois au début du mois de janvier, lors d’un dîner organisé à leur domicile par les fondateurs du Desk Ali Amar et Fatima-Zahra Lqadiri pour fêter la libération du journaliste, après son incarcération pour un tweet.
Alors que les autorités imposent un strict confinement en raison de la pandémie de Covid-19, la petite équipe du Desk a pris l’habitude de se retrouver dans la villa de Bouskoura, où le sous-sol est aménagé en atelier de travail. Hafsa Boutahar, souvent présente, se mêle parfois aux conversations, même lorsqu’elles portent sur des sujets sensibles, comme l’enquête judiciaire ouverte contre Omar Radi pour espionnage.
Certains se méfient d’elle, pointent son « parcours chaotique » : elle a travaillé, entre autres, pour Barlamane. Encore l’une de ces machines médiatiques à salir, qui suscite régulièrement l’indignation, comme à l’occasion de la diffusion par ce site d’une vidéo humiliante de Nasser Zefzafi, figure du Hirak du Rif, filmé nu à l’intérieur de la prison de Oukacha, où il purge une peine de vingt ans de prison.
Le site, officiellement dédié à la couverture de l’actualité parlementaire, a pour éminence grise Mohamed Khabbachi, ancien directeur de la MAP, ex-beau frère de l’un des plus hauts responsables sécuritaires du royaume et ami du roi : Mohamed Yassine Mansouri, patron de la DGED (Direction générale des études et de la documentation), un service de renseignements et de contre-espionnage.
Mohamed Khabbachi, qui fut aussi ancien gouverneur chargé de la communication au ministère de l’intérieur, nous confirme au téléphone, sans nous en dire davantage, que Hafsa Boutahar a bien travaillé pour Barlamane.
Omar Radi balaie d’un revers de main les soupçons de ses amis : la jeune femme montre avec lui, dans cette tourmente politico-judiciaire, une solidarité sans faille ; au Desk, elle se rend indispensable selon plusieurs sources internes, toujours disponible pour une course, un service ; entre eux, le flirt se poursuit, par messagerie instantanée.

Agrandissement : Illustration 2

Le 8 juillet, ils sont pris en photo, dans les bras l’un de l’autre, devant la maison de Bouskoura, par un membre de l’équipe. Tous s’apprêtent à accompagner Omar à la BNPJ, pour une nouvelle audition. Elle n’est pas du voyage, lui envoie la photo avec ce commentaire : « J’attends que tu reviennes. » Ce même jour, dans la soirée, elle prendra des nouvelles du journaliste, demandera à Imad Stitou s’ils comptent, tous les deux, passer la soirée chez Ali Amar et Fatima Zahra Lqadiri. L’intéressé ne répondra pas ; chacun rentrera dormir chez soi.
Quatre jours plus tard, le 12 juillet, la petite équipe doit se retrouver encore, sous le même toit. Après avoir dîné tous ensemble et bouclé dans une ambiance chaleureuse une contre-enquête du Desk sur les accusations d’espionnage portées contre Omar Radi, l’équipe se sépare entre 1 et 2 heures du matin. Omar Radi et Imad Stitou s’installent dans les canapés du grand salon séjour pour la nuit ; Hafsa est allongée dans le coin bibliothèque attenant.
Elle échange des messages avec Omar Radi. Il lui reproche de ne pas l’avoir « réveillé » la veille. Elle répond : « Je n’ai pas eu le cœur à te réveiller alors que tu étais dans un sommeil profond ». Omar Radi lui demande : « Je viens ou tu viens ? » « Viens quand j’aurai fini », écrit-elle. C’est là que les versions divergent.

Agrandissement : Illustration 3

Le 19 août, sous le titre « Omar Radi accusé de viol, les nouvelles révélations chocs de la plaignante », Le 360 lui donne la parole, entre deux liens vers des articles présentant Omar Radi comme un espion du MI6. Oui, admet-elle, elle a bien proposé au jeune homme, qu’elle décrit comme étant depuis le début de la soirée sous l’emprise de l’alcool, de la rejoindre : « Je pensais qu’il voulait discuter, c’est tout », explique-t-elle.
« Il s’est jeté sur moi. […] J’ai essayé de lui parler, de le dissuader. Je me disais que c’était impossible qu’il tente une chose pareille avec tout ce qui lui arrivait, il fallait être fou pour oser faire ça, alors qu’il avait les flics sur le dos. Je me suis dit qu’il n’était pas dans son état normal, qu’il avait trop bu… Il était brutal, il me reniflait comme un animal sauvage qui a attrapé une proie », raconte-elle.
Seul témoin des faits, en dehors de la plaignante et du prévenu, Imad Stitou livre dans sa déposition un tout autre récit selon une source interrogée par Mediapart et L’Humanité. D’après Imad Stitou, Omar Radi a rejoint Hafsa Boutahar dans son canapé vers 2 heures du matin. Aucun des deux ne le pensait encore éveillé. Il n’a entendu, a-t-il assuré aux gendarmes selon cette même source, ni cris, ni appel au secours, seulement deux adultes en train de faire l’amour, une première fois, puis une deuxième fois, et qui se sont promis, avant que Omar ne regagne sa couche, de recommencer dans d’autres circonstances, plus tard.
Parmi les personnes présentes cette nuit-là, à Bouskoura, les gendarmes n’auditionneront que les propriétaires, l’accusé, la plaignante et le témoin direct, Imad Stitou. Et d’après l’une des défenseuses de Omar Radi, Me Souad Brahma, aucun rapport médical établi dans les jours suivant le viol présumé n’a été versé au dossier d’instruction. « D’habitude, même avec de solides preuves et des constatations médicales, nous avons le plus grand mal à faire enregistrer les plaintes pour violences sexuelles », insiste cette avocate, par ailleurs membre de l’Association marocaine des femmes progressistes.
«Le makhzen accapare nos luttes féministes et LGBT pour les retourner contre nous»
Pour celles et ceux qui l’ont côtoyé de près ou de loin, l’emprisonnement de Omar Radi en lien avec cette plainte est un coup de massue. « Il est entouré de nombreuses féministes. Il est en demande, il veut toujours savoir comment se comporter au mieux avec les femmes, soutient une militante qui le connaît depuis de longues années. Même dans les moments où il consomme de l’alcool, il reste toujours très correct. Quand une femme lui plaît, il fait toujours très attention à ne pas la brusquer. Parfois même, ça le bloque. »
Un jeune journaliste qui a arpenté les mêmes sphères militantes et professionnelles que lui depuis le mouvement du 20 février 2011 décrit un homme discret sur sa vie privée, qui jamais, devant une assistance masculine, ne se laisse aller au moindre écart verbal, à la moindre plaisanterie salace ou sexiste.
Dans les rangs de la gauche marocaine, tout le monde ne jouit pas d’une telle réputation. À l’été 2018, dans l’esprit #MeToo, des militantes lancent sur Facebook un groupe secret, au titre évocateur : « Nos camarades sexistes ». La parole se libère. Une centaine de noms sont cités pour des faits de viol, de harcèlement ou d’agression sexuelle, pour des violences physiques, des gestes déplacés ou des propos sexistes.
Dans ce grand déballage qui fait mal, le nom de Omar Radi n’est jamais évoqué, pas une seule fois, selon plusieurs militantes interrogées par Mediapart et L’Humanité.
Ses proches se refusent pourtant à accabler Hafsa Boutahar : « Il ne nous appartient pas de dire qui ment. Une parole d’une femme est là et par principe, je ne peux pas la rejeter, la mettre en doute publiquement, confie l’une d’elles. L’ennemie, ce n’est pas la plaignante. C’est l’instrumentalisation de la parole féminine pour museler des journalistes, des opposants. C’est le makhzen qui accapare nos luttes féministes et LGBT pour les retourner contre nous, casser les militants de gauche. »
Omar Radi n’est pas le premier journaliste indépendant dans le collimateur du pouvoir à être visé par une plainte pour viol. Le 10 novembre 2018, au terme d’un procès jugé « inéquitable » par le Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire, lors duquel sa vie privée a été jetée en pâture dans l’espace public, le directeur du prestigieux quotidien arabophone Akhbar Al-Youm, Taoufik Bouachrine, était condamné à 12 ans de prison ferme pour « traite d’êtres humains », « abus de pouvoir à des fins sexuelles », « viol et tentative de viol ». Un an plus tard, sa peine était alourdie, en appel, à 15 ans de prison ferme.
Le 22 mai dernier, le rédacteur en chef de ce même titre, Souleiman Raissouni, connu pour ses éditoriaux critiques et acérés, était interpellé à son tour, à son domicile de Casablanca, sur la base d’accusations publiées sur Facebook par un militant pour les droits des personnes LGBT. Il est maintenu depuis cette date en détention préventive à l’isolement, dans une cellule de la prison d’Oukacha. Il sera jugé le 30 septembre.
La nièce de ce dernier, Hajar Raissouni, qui travaillait pour Akhbar Al-Youm, est elle aussi passée par la case prison, à l’automne dernier : le 30 septembre 2019, sur la base de rapports médicaux truqués, la justice marocaine l’avait condamnée à un an de prison ferme pour « avortement illégal, relations sexuelles illégales, et débauche ».
Interpellé en même temps qu’elle au sortir d’une consultation de gynécologie, son fiancé soudanais avait écopé de la même peine, tandis que le médecin qui l’avait auscultée écopait de deux ans de prison ferme, assortis d’une interdiction d’exercer son métier pendant deux ans supplémentaires. Les autres membres de l’équipe médicale étaient condamnés, eux, à huit mois et un an de prison avec sursis.
Devant le tollé suscité au Maroc et à l’étranger par l’incarcération de la jeune femme, Hajar Raissouni avait finalement été libérée le 16 octobre, en vertu d’une grâce royale. Sans que prenne fin, pourtant, le harcèlement de sa famille et de ses proches. Cette talentueuse journaliste de 29 ans a fini par rendre les armes : elle a quitté le Maroc.
Comme l’une des « accusatrices » de Taoukik Bouachrine, Afaf Bernani, qui, le 26 août dernier, dans une tribune publiée dans le quotidien américain The Washington Post, exhortait le régime marocain à « cesser d’utiliser les allégations d’agression sexuelle pour réduire au silence les opposants ».
« Cela peut paraître surprenant d’entendre une femme marocaine comme moi, ayant vécu les malheureuses réalités du harcèlement sexuel au Maroc – exprimer son scepticisme face à ces accusations [portées contre Omar Radi – ndlr]. Si les agressions sexuelles et les abus de toute nature sont odieux et méritent toujours une enquête sérieuse, il y a de bonnes raisons de croire que de telles allégations sont exploitées à des fins politiques. Pourquoi ? Parce que j’ai vu cela se produire moi-même », explique l’ancienne employée de Akhbar Al Youm, avant de détailler par le menu les pressions et les menaces dont elle a été l’objet pour la « convaincre » de porter plainte contre son ancien patron.
Dans le dossier Bouachrine, sur les quinze plaignantes initialement recensées par la presse marocaine, huit ont manifesté le refus de témoigner contre lui, ou se sont ouvertement rétractées. Lors du procès à huis clos, qui s’est étiré sur plusieurs mois, des mandats d’amener ont dû être délivrés pour contraindre certaines d’entre elles à se présenter à la barre. Des témoins revenus sur leurs déclarations ont fini derrière les barreaux. Une plaignante refusant de se présenter au tribunal a été retrouvée cachée, terrorisée, dans la voiture d’un témoin. Afaf Bernani a elle-même été jugée au printemps 2018 : elle était accusée d’avoir « falsifié son procès verbal ». Verdict : six mois de prison ferme.
Dans cette affaire, une femme avait exprimé à visage découvert, dans la presse, son intention d’aller « jusqu’au bout », « sa ferme volonté de poursuivre Taoufik Bouachrine ». À l’ouverture du procès, pourtant, son nom avait mystérieusement disparu du dossier. Il s’agit de Kaoutar Fal. Cette ancienne employée du voyagiste Tui Fly devenue « consultante », « journaliste » et lobbyiste, volontiers mondaine et friande de selfies avec des députés européens, organisatrice, dans les palaces de Tanger ou Casablanca, de colloques aux intitulés brumeux (« The Power of One », « Les Nouvelles Configurations du monde actuel »), s’est trouvée contrainte de quitter la Belgique à l’été 2018 en raison du retrait de son visa, au terme d’un séjour en détention dans le centre fermé 127 bis à Steenokkerzeel (Brabant flamand).
Traitement justifié, d’après le rapport de la police belge relatif à son arrestation, par ses activités d’espionne : « La Sûreté d’État […] considère que l’intéressée constitue une menace pour la sécurité nationale, car elle a constaté que Madame Fal et ses organisations sont activement impliquées dans des activités de renseignement au profit du Maroc. Par ailleurs, Madame Fal est également en contact avec des personnes qui sont connues de la Sûreté d’État pour leurs activités en faveur de services de renseignements étrangers offensifs ou pour des liens avec ceux-ci. La Sûreté d’état estime également qu’il faut empêcher l’intéressée d’accéder au territoire et de circuler dans l’espace Schengen afin de mettre fin à ses activités et au danger qu’elle représente. »
Avant de louer dans le centre de Bruxelles pour un loyer de 1 500 euros un appartement cossu qu’elle n’occupait que quelques jours par mois – train de vie dont s’étonnent les enquêteurs belges –, Kaoutar Fal avait bien tenté, mais sans succès, de harponner Taoufik Bouachrine.
Le 18 octobre 2017, à 14 h 14, elle lui adresse un SMS que nous avons pu consulter : « Taoufik rappels moi urgent [sic]. » Son message reste sans réponse. Faute de réaction, elle le relance, un mois plus tard, sur le ton de la menace badine : « Wakha 3lik », « Tu vas voir ce qui va t’arriver. » Toujours pas de réponse du journaliste.
À la même période, deux jours avant le premier message de Kaoutar Fal, un autre message adressé au directeur d’Akhbar Al Youm est resté sans réponse. Le 16 octobre 2017, à 10 h 56, Taoufik Bouachrine reçoit ce message : « Bonjour M.TAOUFIK Chui Hafsa Boutahar journaliste. » La jeune femme ne précise pas le motif de son message. Professionnel ? Personnel ? Ignorée par le destinataire, elle s’en tiendra à cette lapidaire tentative de prise de contact. Interrogée sur ce SMS, Hafsa Boutahar n’a pas souhaité nous donner d’explications.
«Depuis quelques années, de nouvelles méthodes sont apparues»
L’instrumentalisation de la vie privée, les accusations de viol ou d’agression sexuelle portées contre des journalistes ou des opposants jugés trop frondeurs ne sont pas une nouveauté dans l’arsenal répressif du régime, de sa police, de ses services de renseignement. Le journaliste Ali Lmrabet, aujourd’hui exilé en Espagne, en garde un amer souvenir. En 2000, une plainte avait été déposée contre lui pour un viol qu’il était censé avoir commis à Casablanca au moment même où il se trouvait à Marrakech, à 200 kilomètres de là. Menacée de poursuites pour dénonciation calomnieuse, la plaignante, une ex-journaliste de sa revue Demain, avoua qu’on lui avait promis monts et merveilles.
Méthodes anciennes, donc, mais autrefois utilisées à doses homéopathiques. « Les journalistes indépendants et la presse libre subissent une répression continue par le pouvoir marocain. Les méthodes utilisées pour cette fin changent selon les contextes politiques, analyse Khadija Ryadi, de l’Association marocaine de défense des droits humains (AMDH). Au cours des années de plomb, les journalistes étaient arrêtés et poursuivis par des accusations en relation directe avec leurs opinions et leur travail en tant que journalistes. Suite à l’ouverture politique qu’a connue le Maroc depuis le début des années 1990, les autorités ont utilisé, en plus des arrestations et des procès montés de toutes pièces, des méthodes d’asphyxie financière des journaux et magazines qui ne plaisent pas au pouvoir. Depuis quelques années, de nouvelles méthodes sont apparues. Il s’agit d’accusations ayant relation avec les mœurs. » Des accusations de viol, de traite des êtres humains, d’adultère, d’avortement illégal ou de relations sexuelles hors du mariage, interdites par la loi marocaine.

Agrandissement : Illustration 4

Ahmed Benchemsi fut longtemps l’un des visages de la presse libre au Maroc. Ce cofondateur du magazine Telquel et de sa version arabophone Nichane a fini par s’exiler aux États-Unis en 2010, épuisé par les coups de boutoir incessants du pouvoir. Il travaille aujourd’hui pour Human Rights Watch : « À mon époque, c’était moins tordu, j’ai été poursuivi pour manque de respect au roi, le terrain était clair, il était politique. On en parlait devant un tribunal. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Là, ils ne disent pas : Omar Radi manque de respect au roi, aux institutions. Ils disent : il a fait de l’espionnage, il a violé. »
Ces méthodes ne visent pas seulement des journalistes. Des opposants sont aussi les cibles de ces pratiques visant à démolir une image, une réputation, un parcours politique par des campagnes de diffamation, d’insultes et de dénigrement sur les médias proches du pouvoir et sur les réseaux sociaux. De nombreuses figures du mouvement islamiste se sont ainsi vues, du jour au lendemain, éliminées de la scène politique.
« Les procès politiques d’autrefois donnaient prestige aux opposants, faisaient d’eux des héros, mobilisaient l’opinion autour d’eux. Avec les printemps arabes et l’essor des réseaux sociaux, de jeunes opposants ont acquis une légitimité, une crédibilité. Les désigner comme des traîtres, des voleurs, des violeurs est la meilleure façon de les réduire au silence », insiste l’historien Maati Monjib, l’un des fondateurs de l’Association pour le journalisme d’investigation qui attend depuis 2015 d’être jugé pour « atteinte à la sécurité intérieure de l’État ».
Depuis cinq ans, le procès est sans cesse repoussé : les accusés doivent comparaître, ce 1er octobre, pour la vingtième fois depuis 2015. Parmi eux, Hicham Mansouri, qui était directeur des programmes de l’AMJI, a eu d’autres démêlés encore : il a fait dix mois de prison pour « complicité d’adultère », a échappé de peu à des poursuites pour proxénétisme. « Il y a un climat d’inquisition. Ils savent toutes nos failles, toutes nos fragilités. Ils nous connaissent mieux que nous-même. L’objectif, c’est que tout le monde finisse par se considérer comme une cible potentielle. Sexe, drogue, alcool… s’ils ne trouvent rien, ils fabriquent des accusations », tranche-t-il.
Stratégie impitoyable : dans une société travaillée par les conservatismes traditionnels ou religieux, une réputation se brise comme du verre. Autour des cibles salies, le vide se fait, les solidarités s’effilochent. Sur fond de balkanisation des pôles de pouvoir, avec des services de sécurité concurrents, aux marges de manœuvre démesurées, la méthode tend à s’imposer comme la plus efficace de l’arsenal répressif déployé contre les dernières voix libres.
Et le régime sait parfaitement s’adapter aux élans politiques, comme le renouveau féministe qui a pris corps avec la vague #MeToo. Aussitôt après l’arrestation d’Omar Radi pour viol, des féministes marocaines interrogeaient la temporalité de cette nouvelle accusation. Mais sous le couvert de l’anonymat, par peur des représailles.
« Nous militons pour que la parole des femmes soit entendue, et pour que les sanctions les plus sévères soient infligées aux prédateurs sexuels. En revanche, nous dénonçons fermement toute instrumentalisation des violences faites aux femmes à des fins politiques et sécuritaires. Dénoncer le viol, les violences sexuelles et l’instrumentalisation des corps des femmes passe aussi par le refus de les voir utilisées et instrumentalisées dans des affaires politiques. Les accusations de viol ne doivent pas être des coups de sifflet finaux », écrivaient-elles dans un texte publié sur les réseaux sociaux.
L’une des féministes derrière ce texte est Laila Slassi, une cofondatrice du mouvement Masaktach, « Je ne me tairai pas », le MeToo marocain né en 2018 après l’affaire Khadija, du prénom de cette jeune fille de 17 ans kidnappée, torturée, séquestrée, violée et tatouée de force par une dizaine d’hommes dans la commune rurale d’Oulad Ayach, dans le Moyen Atlas. Elle a payé cher ses prises de position dans l’affaire Omar Radi : Le360 la traite d’« usurpatrice du titre d’avocat qui conspire contre l’État tout en s’en gavant ».
Ibtissame Betty Lachgar, cofondatrice du Mouvement alternatif pour les libertés individuelles (MALI) connu pour être à l’avant-garde des luttes pour des LGBT au Maroc, fustige cette démarche et se dit « sans voix », « choquée par cette campagne qui a fait un flop ». « Je suis l’une des seules féministes marocaines à soutenir franchement Hafsa Boutahar. » Elle a choisi de répéter « On te croit », en arabe, en français, en anglais, sur les réseaux sociaux, dans les rues. Elle l’a même écrit sur son corps, son crâne, sa main. « Je n’en peux plus de cette gauche et de ces féministes qui entretiennent la culture du viol avec Amnesty International, une organisation patriarcale. Aucun communiqué ne parle de la victime qui subit ainsi un second viol », se désole-t-elle.
Ibtissame Betty Lachgar ne connaît pas Hafsa Boutahar, ni les détails de son histoire. Celle-ci l’a contactée via les réseaux sociaux « pour la remercier de son soutien ». Elle connaît Omar Radi. « Certes, l’affaire de ce journaliste est politique, mais pourquoi mettre l’oppression des femmes au second plan chaque fois que l’affaire est politique ? Le Maroc est un régime autoritaire, dictatorial. Je suis la première à le dire, à dénoncer les méthodes fascistes de ce pouvoir pour Radi et tous les autres avant lui, je continuerai à le faire mais pas en mettant dans le placard les histoires de violences sexuelles et en qualifiant systématiquement les plaignantes de menteuses. »
Dans un post publié le 31 juillet sur Facebook, Hafsa Boutahar s’élève contre ceux qui crient à la machination. « Mon affaire est loin du sujet de la liberté d’opinion et d’expression, et de la théorie du complot, insiste-t-elle. Mon affaire est une question de dignité et d’orgueil, c’est celle d’une femme qui défend son droit légitime et inconditionnel par la loi. » « Je suis la victime d’un collègue qui a trahi ma confiance, mon affection et mon soutien envers lui et sa cause, c’est la vérité », conclut-elle.
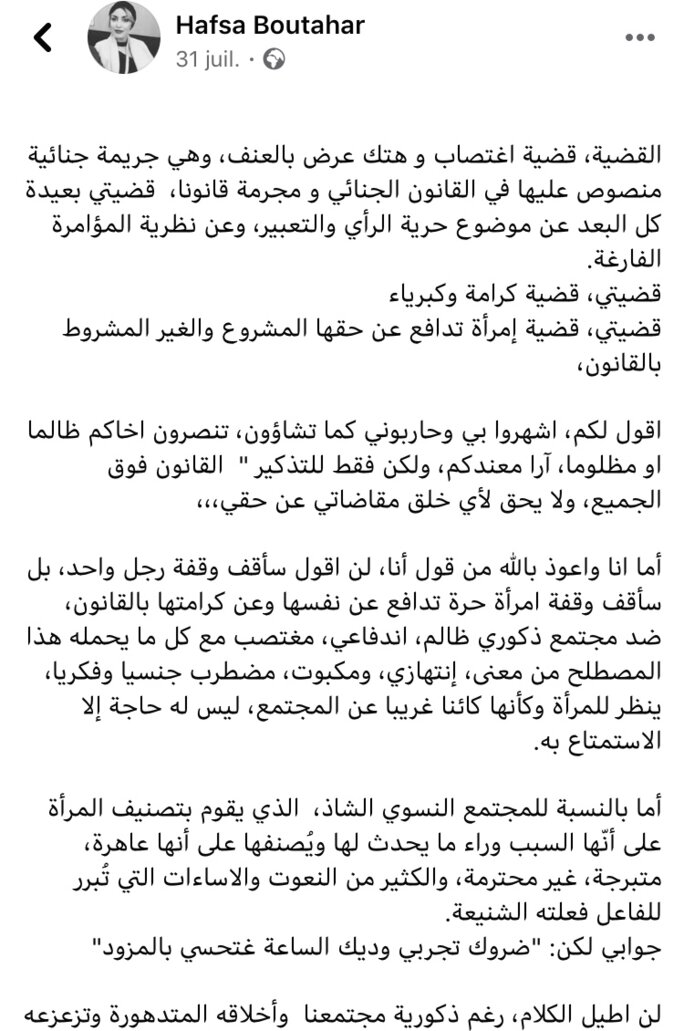
Agrandissement : Illustration 5
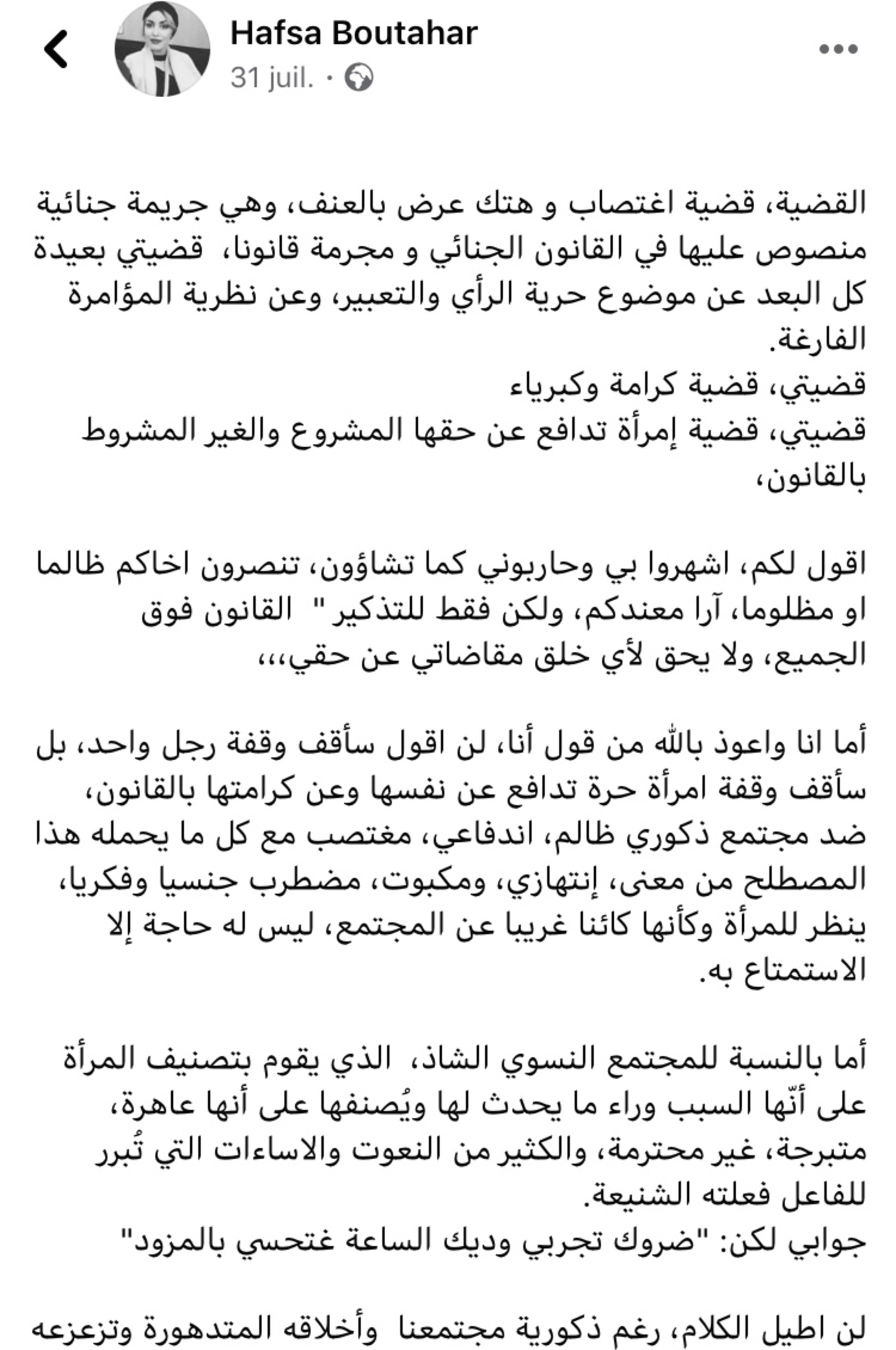
Sur la messagerie Signal, elle ferme le seul échange auquel elle consent avec Mediapart et L’Humanité d’un smiley arborant un sourire : « Tout ce qui compte pour moi en tant que femme, c’est que la justice fasse son travail. Mon cas concerne la dignité de toutes les femmes. D’abord la loi, et ensuite j’irai défendre ma cause à travers le monde. »
Dans une vidéo enregistrée avant son incarcération, Omar Radi parle, à propos de l’enquête judiciaire ouverte contre lui pour espionnage, d’une « vengeance d’État » : « Les journalistes les plus critiques à l’égard de l’autorité, de son mode de fonctionnement et de son approche sécuritaire au Maroc sont les plus exposés aux condamnations judiciaires, aux arrestations et aux intimidations. Le pouvoir ne se contente pas seulement de les emprisonner et de les diffamer, il fait également en sorte de diviser les personnes qui les soutiennent pour qu’il n’y ait pas de mouvement de solidarité avec eux. » Le journaliste se dit sûr que « l’État cherche n’importe quel dossier, n’importe quelle raison » pour l’inculper.


