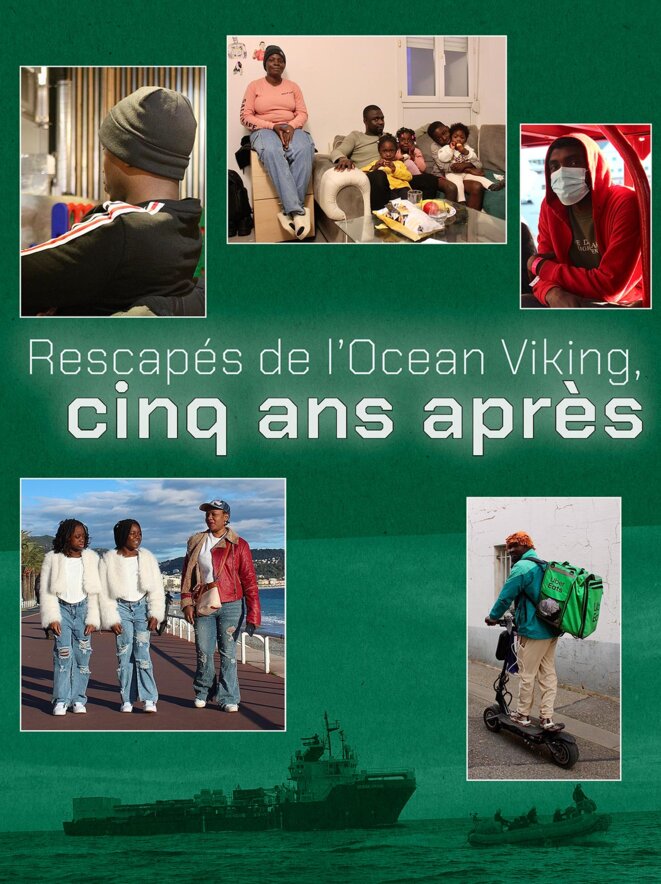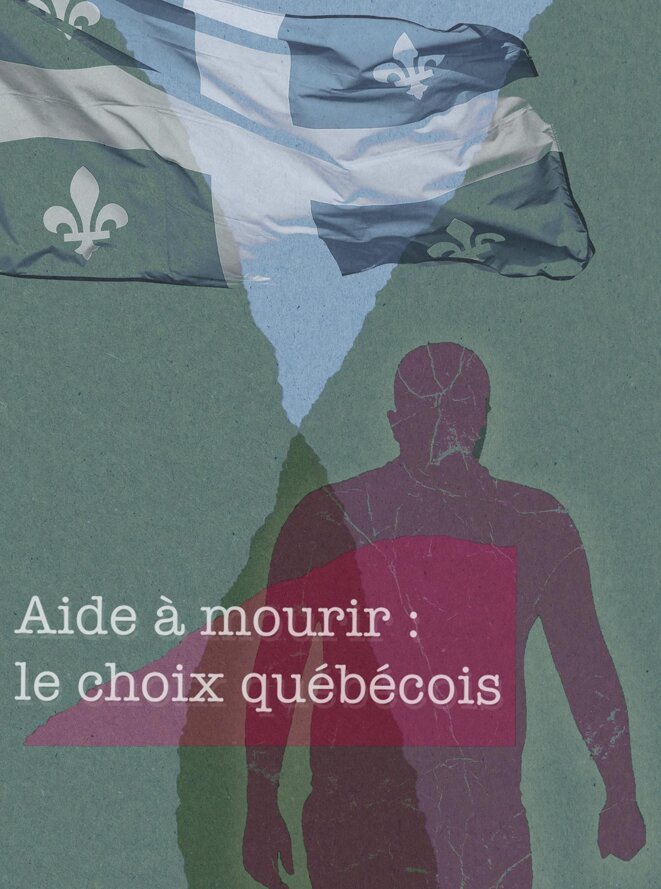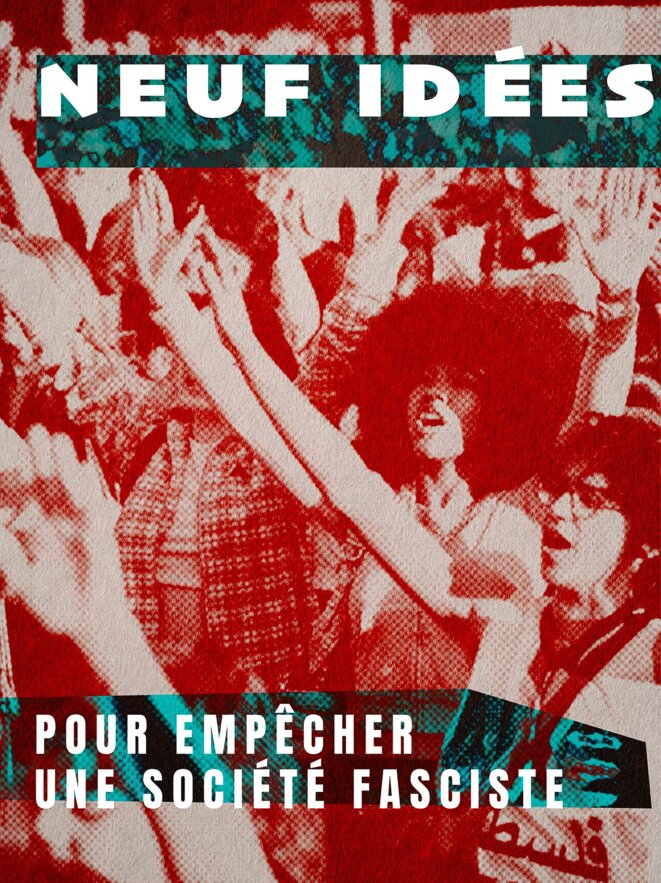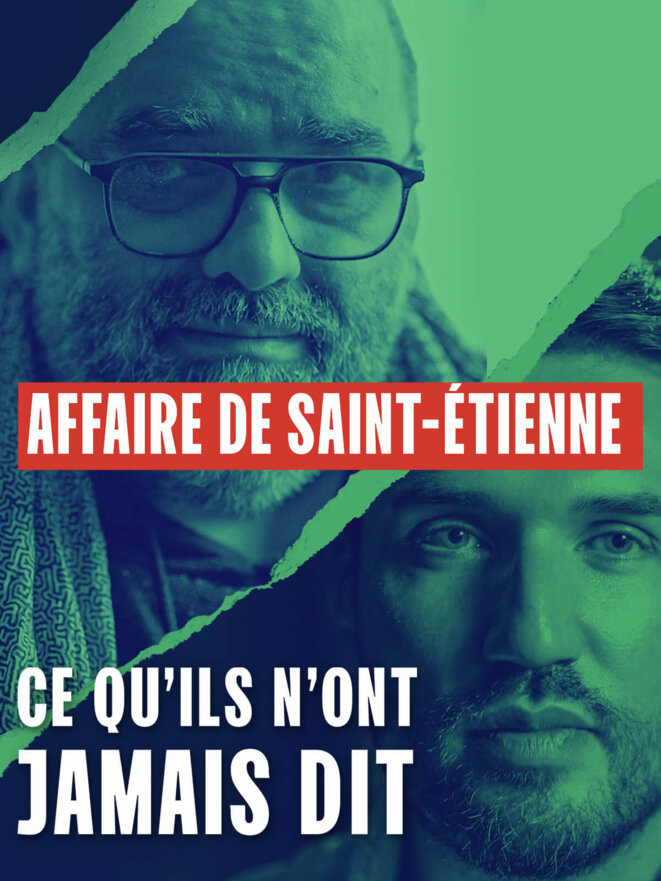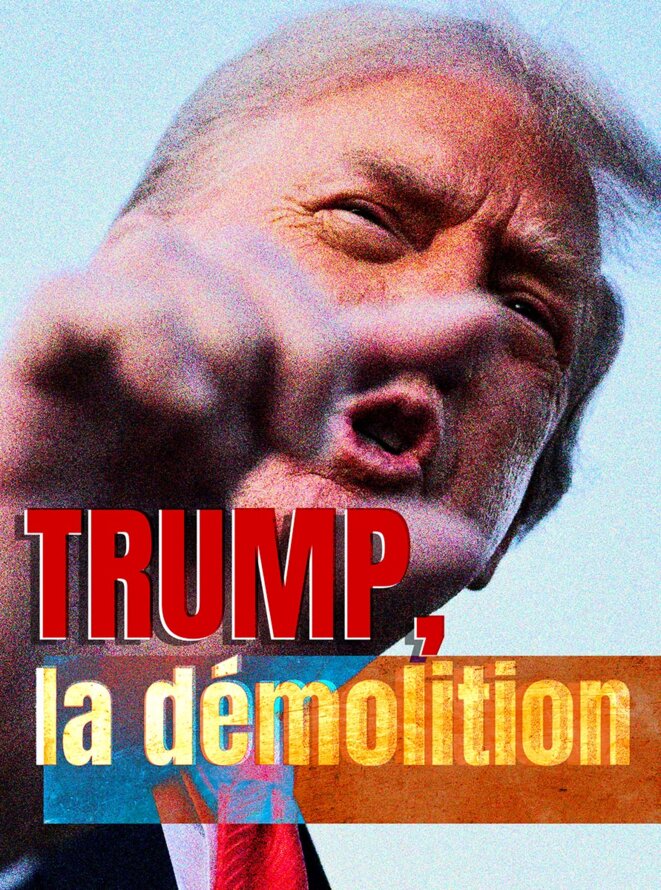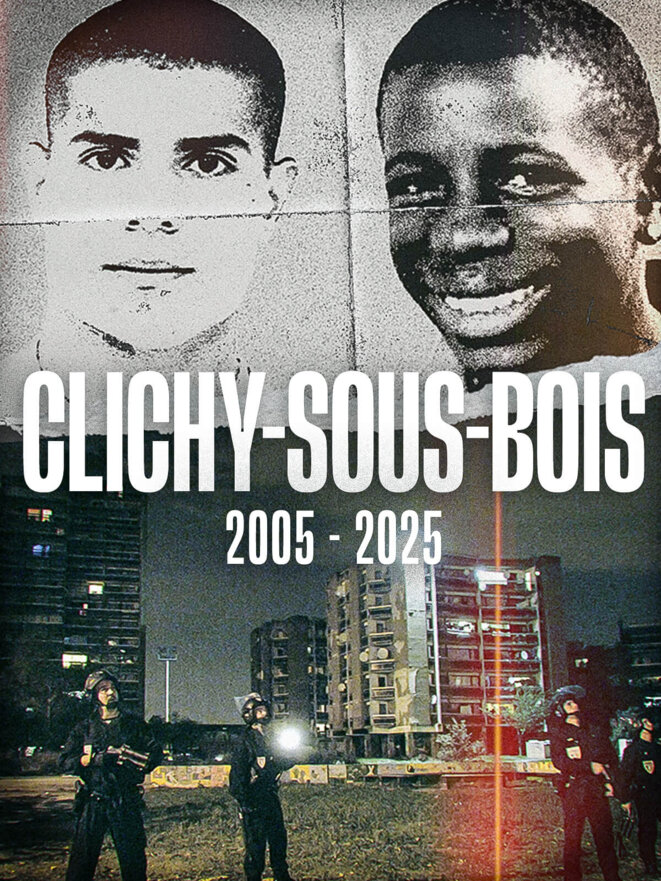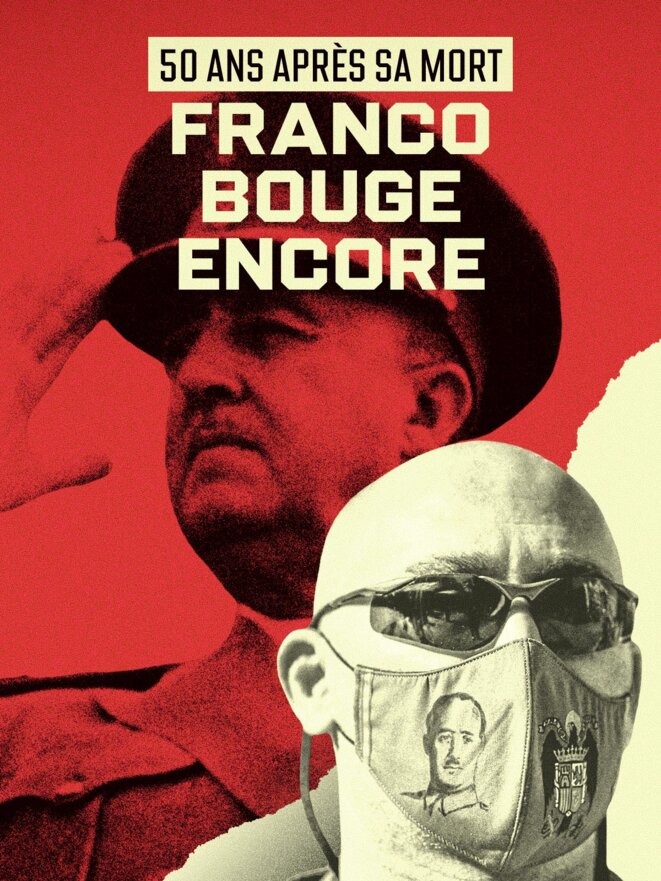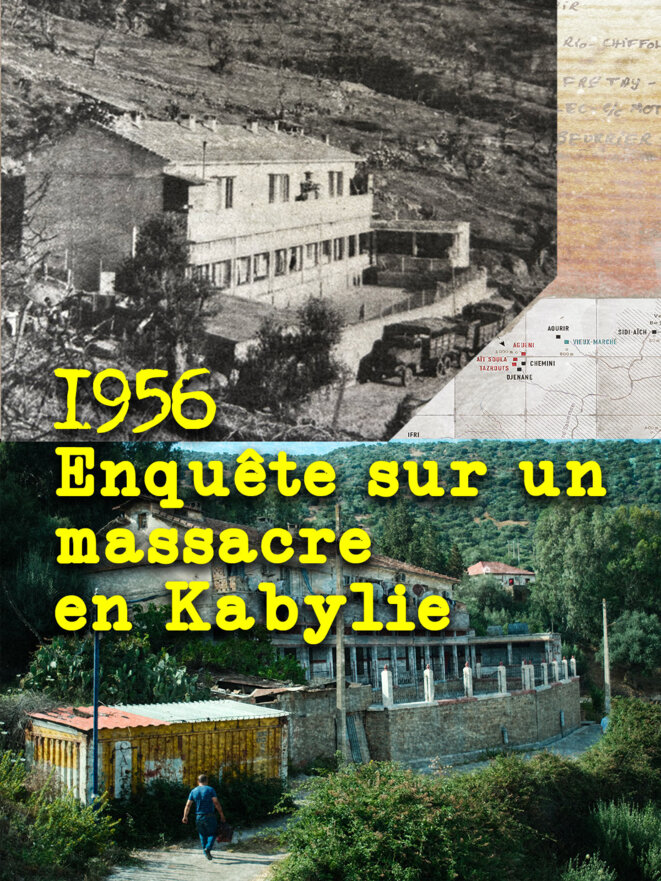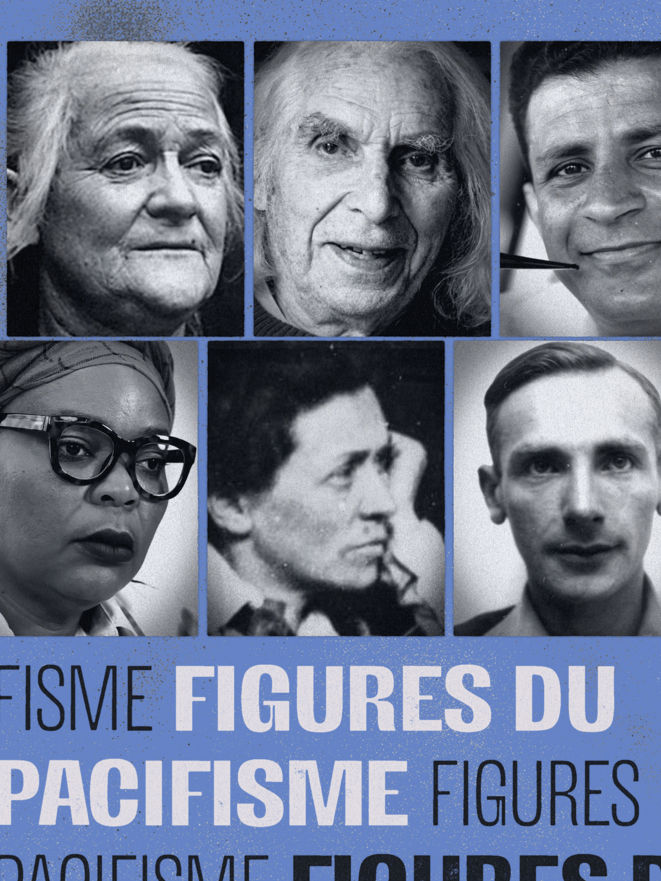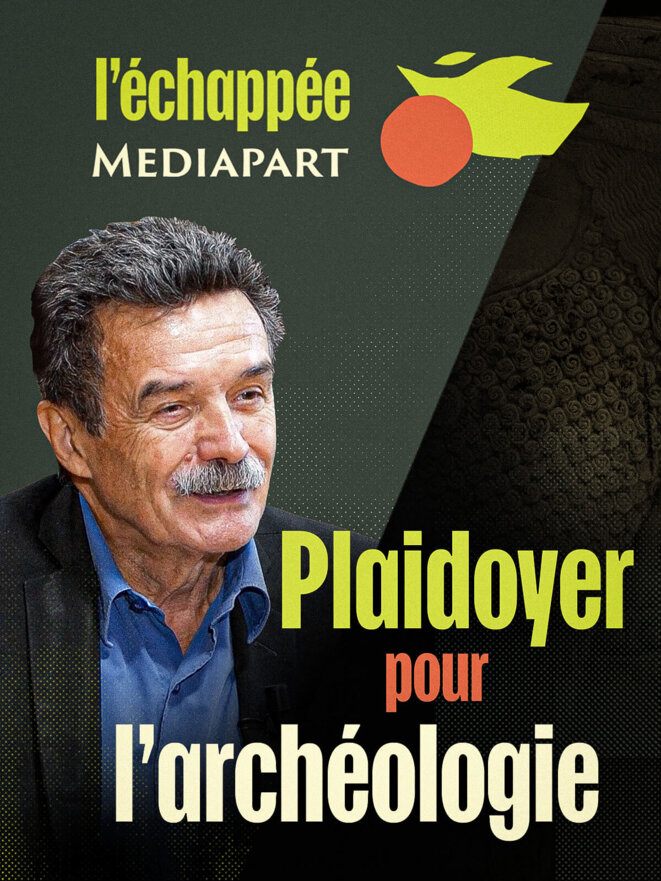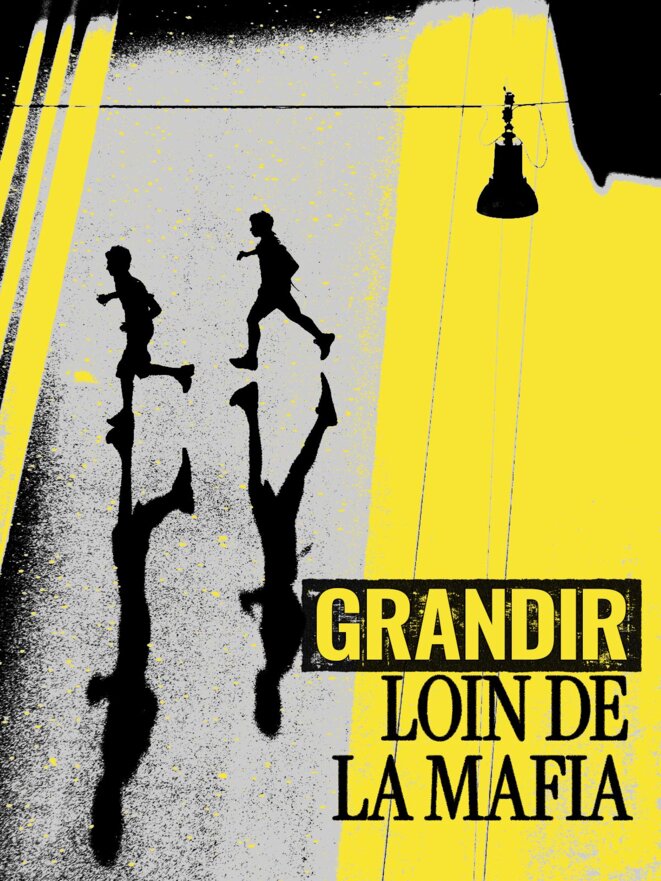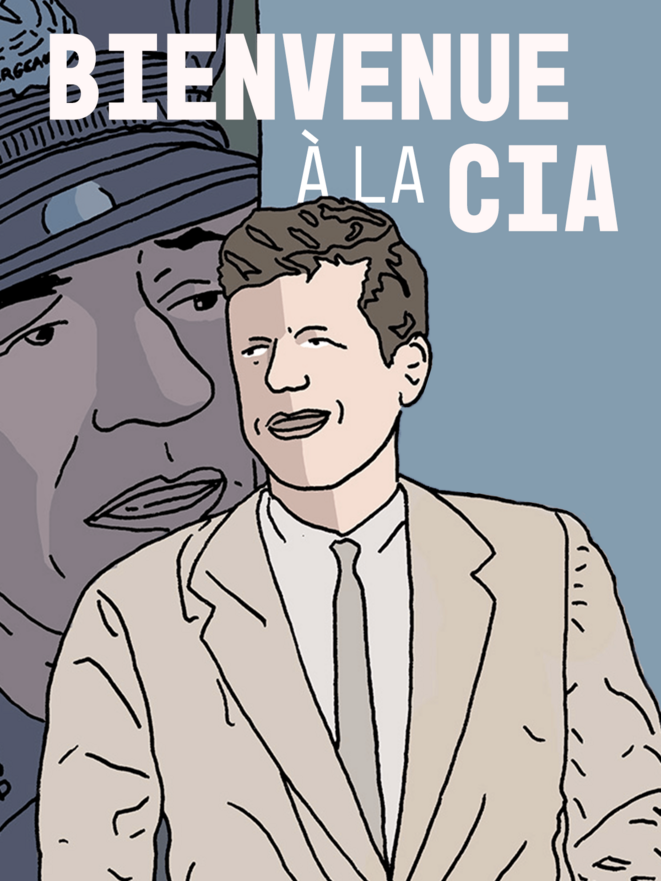La justice, l'une des priorités budgétaires annoncées par Marine Le Pen : 8,5 milliards d'euros sur cinq ans.
- Rétablissement de la peine de mort par référendum, notamment pour les assassins d’enfants et les trafiquants de drogue
Un hypothétique retour à la peine de mort en France supposerait, outre une réforme de la Constitution très incertaine, la dénonciation de plusieurs traités internationaux. Parmi les textes les plus récents, la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) interdit la peine de mort en toutes circonstances, même en temps de guerre (protocole 13, signé par la France en 2002 et ratifié en 2007). Aujourd’hui, parmi les 47 pays membres du Conseil européen, seule la Biélorussie applique encore la peine capitale.
- Création de 40.000 places de prison «dans les plus brefs délais»
Il existe aujourd’hui 56.000 places de prison pour 65.000 détenus. Là où l’UMP propose de construire 30.000 places supplémentaires en cinq ans, le FN va encore plus loin dans la surenchère sécuritaire, en proposant 40.000 places nouvelles. Outre que la prison échoue déjà, faute de moyens, à réinsérer les personnes détenues après la fin de leur peine, et que de telles créations de places ne sont justifiées par aucun besoin, la mesure coûterait une fortune, non seulement en termes d’équipements mais aussi en moyens humains. Les économistes du FN évaluent la mesure à 5,7 milliards. Un chiffre sous-évalué d'environ 2 milliards d'euros, estime l'Institut de l'entreprise, "think tank" proche du patronat.
- Assurer l’application des peines de prison en supprimant les remises automatiques de peine
Les remises automatiques de peines sont en quelque sorte la « carotte » qui incite les détenus à observer une bonne conduite afin d'avoir le droit d'en bénéficier. Les supprimer, vieille marotte de ceux qui prétendent revenir au « vrai sens de la peine », reviendrait à flatter les instincts les plus sécuritaires de l’électorat, mais risquerait surtout, et à coup sûr, d'augmenter le désespoir et les tensions qui règnent déjà au quotidien dans des prisons vétustes et surpeuplées.
- Revalorisation du budget de la justice de 25 % en cinq ans
La justice française est aujourd’hui bien pauvre en regard de ses voisines : selon une enquête de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice publiée fin 2010, la France ne consacre en effet que 0,19 % de son PIB à la justice, ce qui la place au 37e rang européen en la matière. Nos voisins investissent environ le double : 0,38 % pour l'Allemagne, 0,36 % pour l'Espagne, 0,43 % pour le Royaume-Uni et 0,52 % pour la Pologne. Mais le tout est de savoir où iraient ces moyens supplémentaires. Le FN parle de recruter des magistrats, mais ne dit pas combien. Quant au programme de construction de prisons, il n’est pas chiffré.
- Pour garantir l’indépendance et la neutralité de la magistrature, suppression pour les magistrats du droit d’être syndiqué, de la possibilité de s’engager politiquement ou d’être candidat, d’écrire ou de témoigner au sujet d’une quelconque affaire ayant trait à leur fonction.
Actuellement, les magistrats ne peuvent s‘engager en politique que s’ils se mettent en disponibilité (ou après leur départ à la retraite). Quant à la nécessaire discrétion sur les dossiers judiciaires dont ils ont à connaître, elle existe déjà dans les textes, qu’il s’agisse des obligations de confidentialité figurant dans le serment du magistrat, ou du secret de l’instruction prévu par le Code de procédure pénale.
Pour ce qui est d’une éventuelle interdiction de se syndiquer, elle se heurterait à plusieurs textes existants. Reconnu comme un droit fondamental, inscrit dans la Constitution, le droit de se syndiquer s’applique dans la magistrature (même si le statut de la magistrature n’y fait pas référence). En l’absence de dispositions spécifiques, c’est le statut général de la fonction publique qui s’applique : il dispose que « les fonctionnaires peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ».
Cet article est repris et adapté aux magistrats en introduction de la circulaire de 1992 du ministère de la justice qui établit que « le droit syndical est garanti (…) aux magistrats ». De même, le recueil des obligations déontologiques rendu public en juin 2010 note, dans une rubrique visant les obligations de prudence et de réserve, que « le magistrat bénéficie du droit de se syndiquer », et « s’exprime librement dans ce cadre syndical ». Ces principes sont également reconnus au niveau international. La charte européenne sur le statut des juges, édictée en septembre 1998 par le Conseil de l’Europe, prévoit que « les organisations professionnelles constituées par les juges et auxquelles ils peuvent tous librement adhérer contribuent notamment à la défense des droits qui sont conférés à ceux-ci par leur statut, en particulier auprès des autorités et instances qui interviennent dans les décisions les concernant ».
- Redresser le taux d’élucidation des affaires en réformant la garde à vue
Le FN croit (ou feint de croire) que le fait de limiter ou d’interdire la présence de l’avocat pendant la garde à vue (ce que les textes européens rendent de toute façon très improbable, voire impossible) pourrait améliorer le taux d’élucidation des affaires. Or rien ne permet de démontrer ce postulat. En outre, le taux d’élucidation des affaires est un critère très critiqué par les chercheurs en criminologie, car la fameuse « politique du chiffre » de ces dernières années a provoqué une multiplication des petites affaires faciles à résoudre (type arrestation de consommateurs de cannabis) au détriment des enquêtes au long cours sur de véritables organisations criminelles et des faits plus graves.