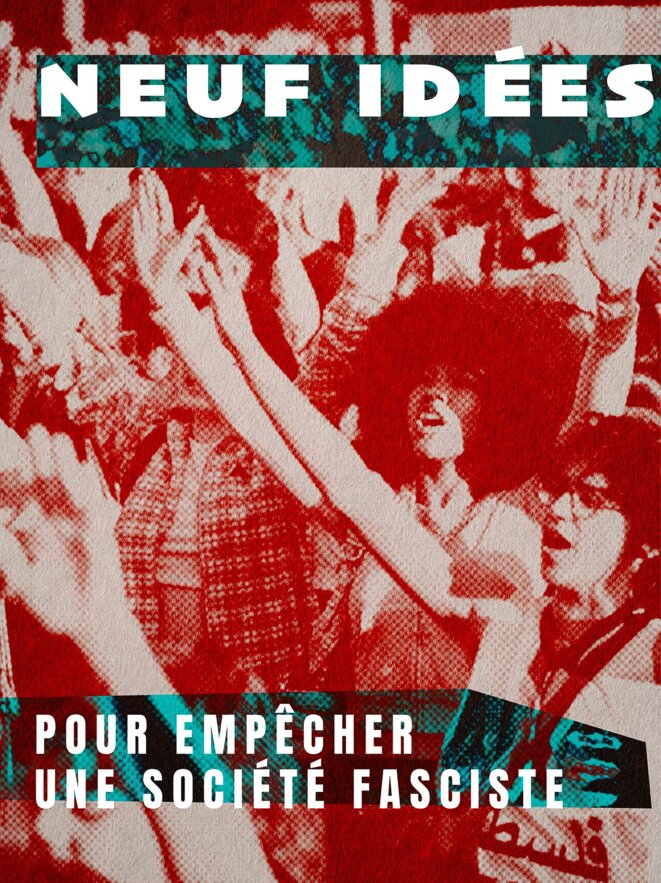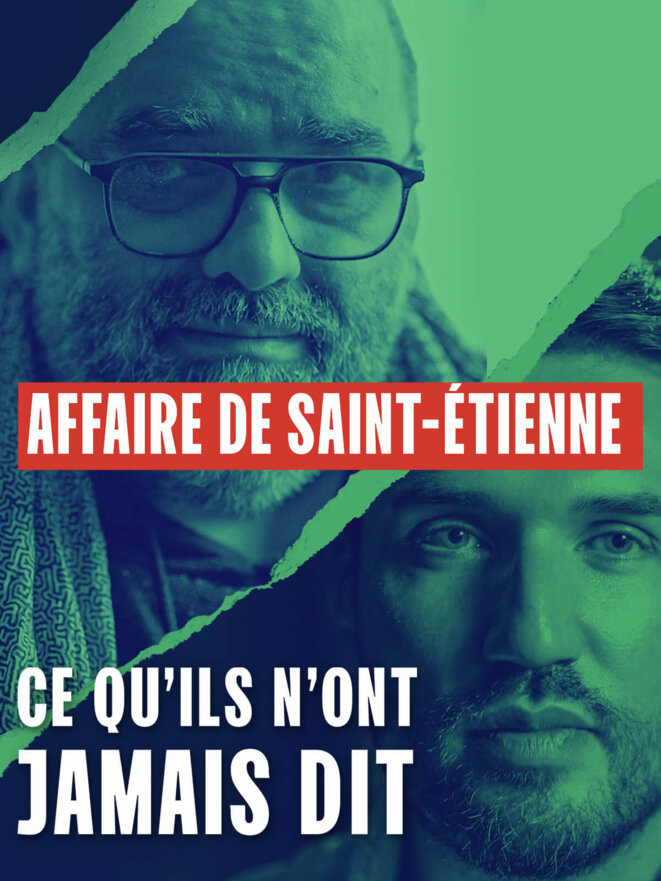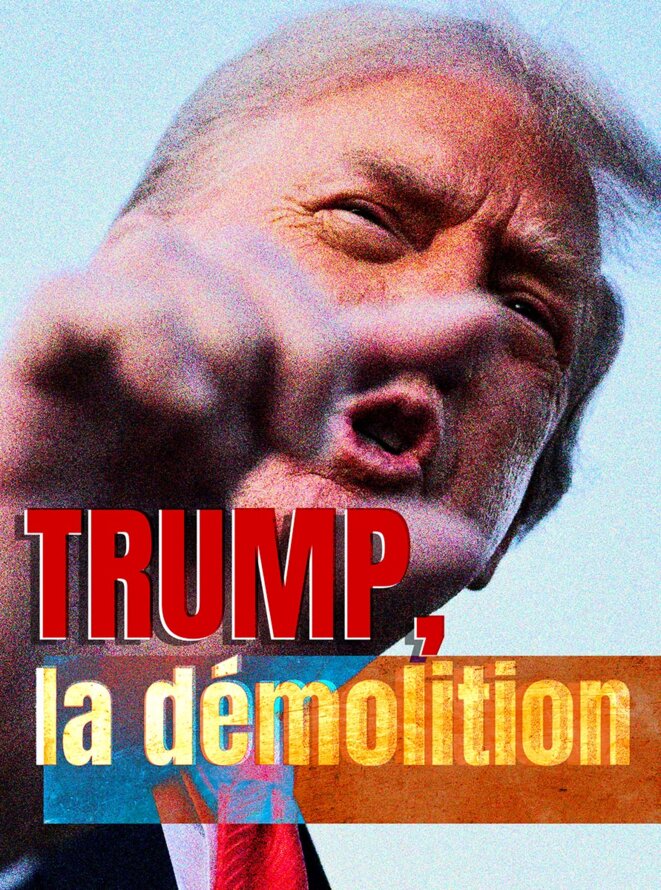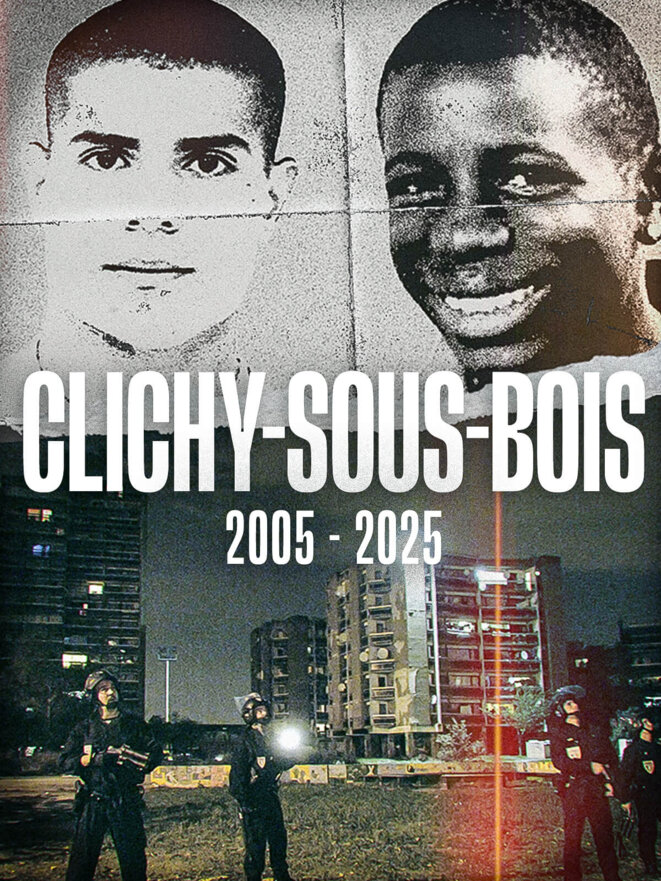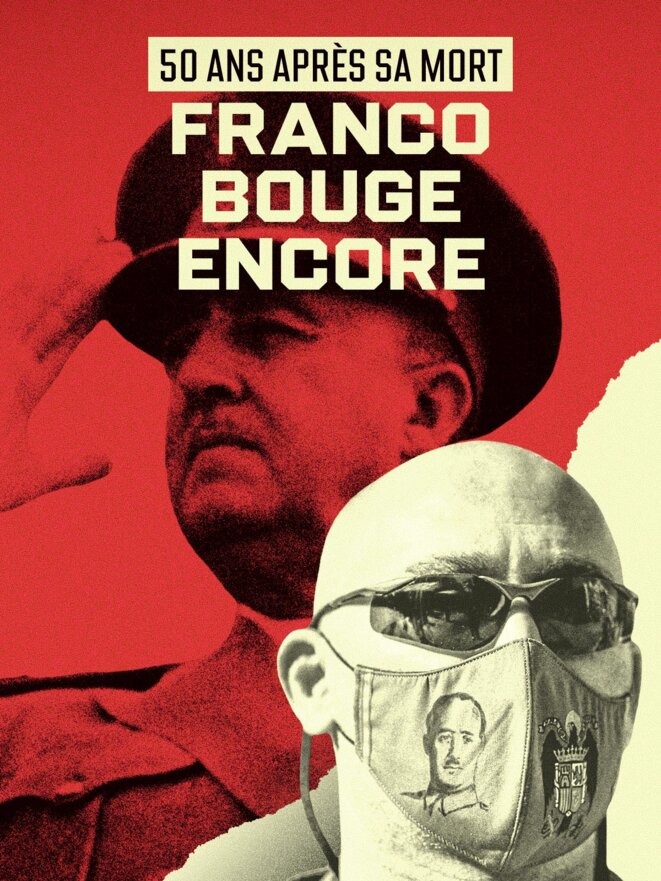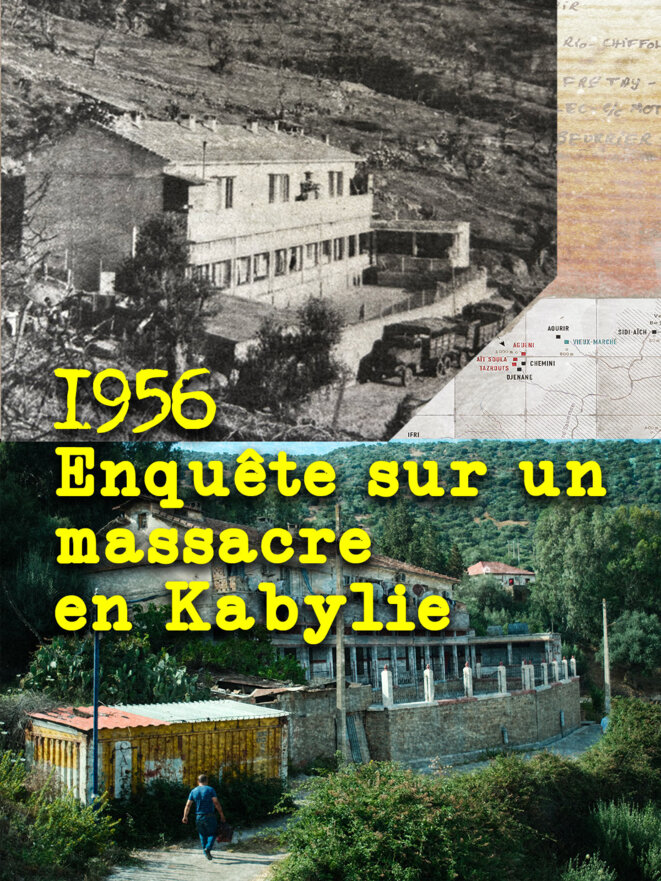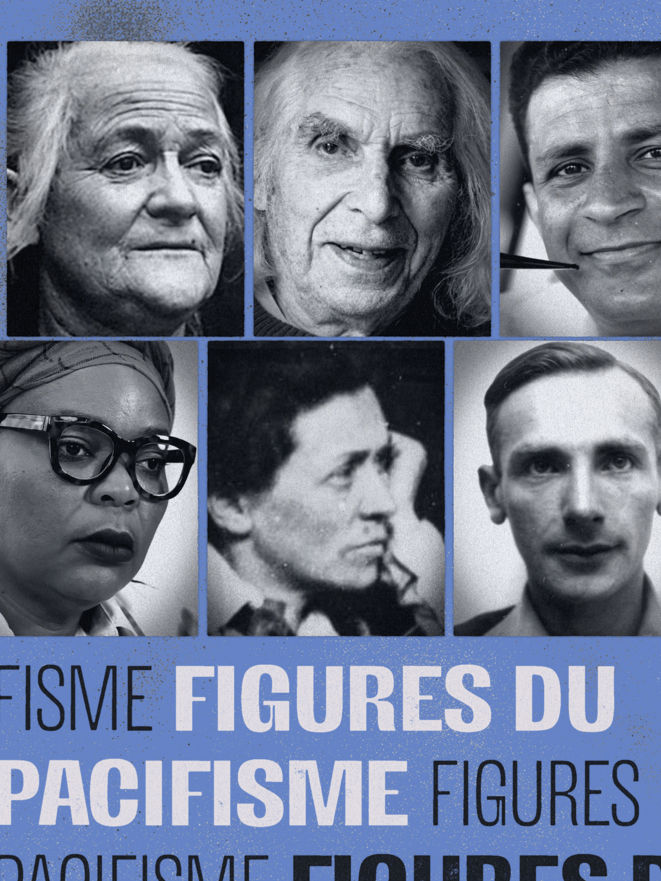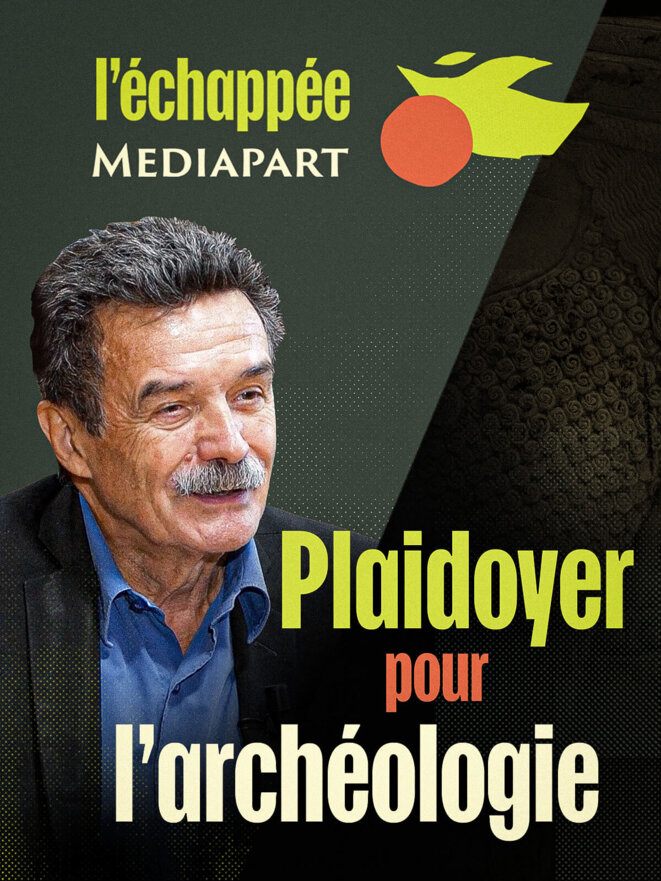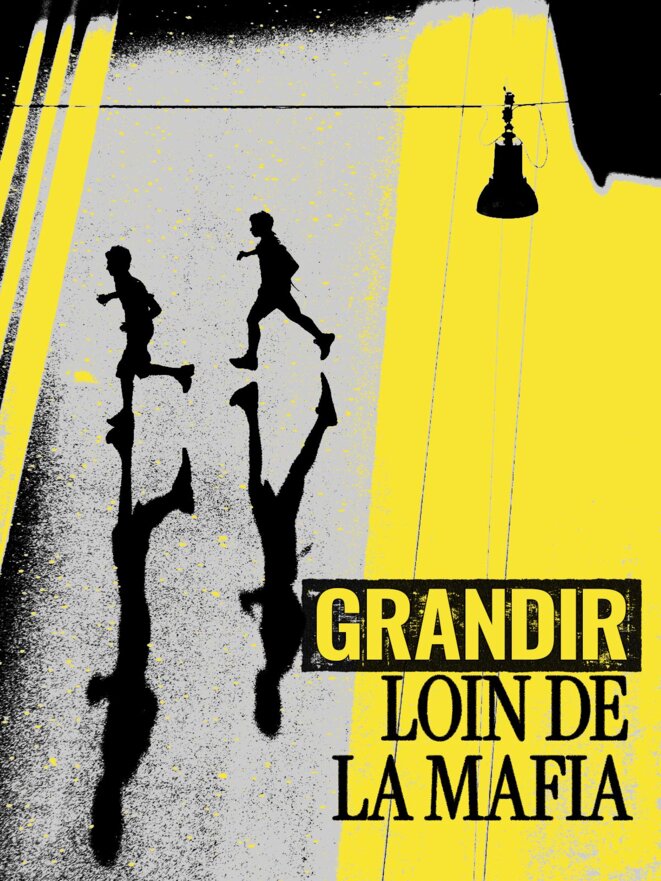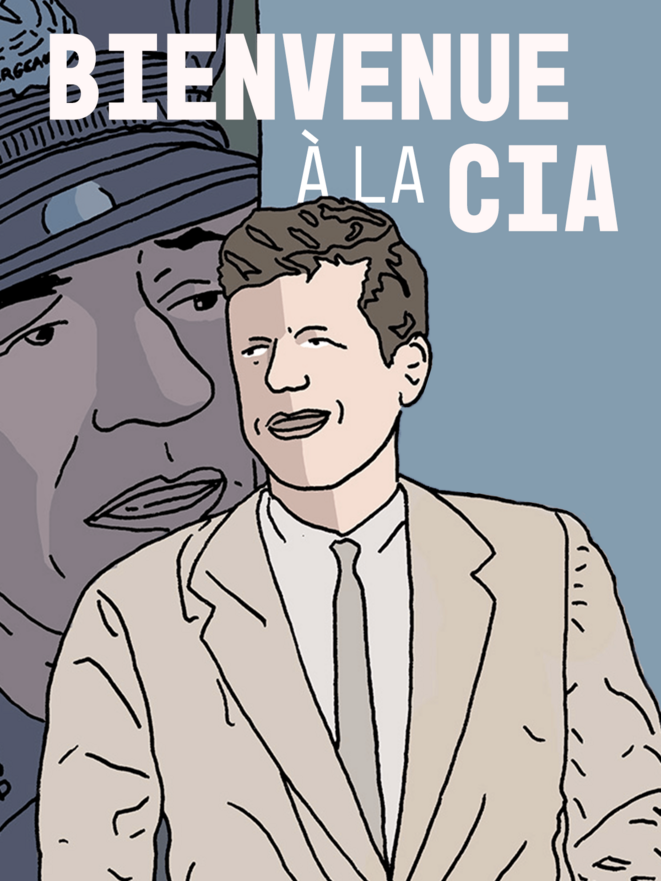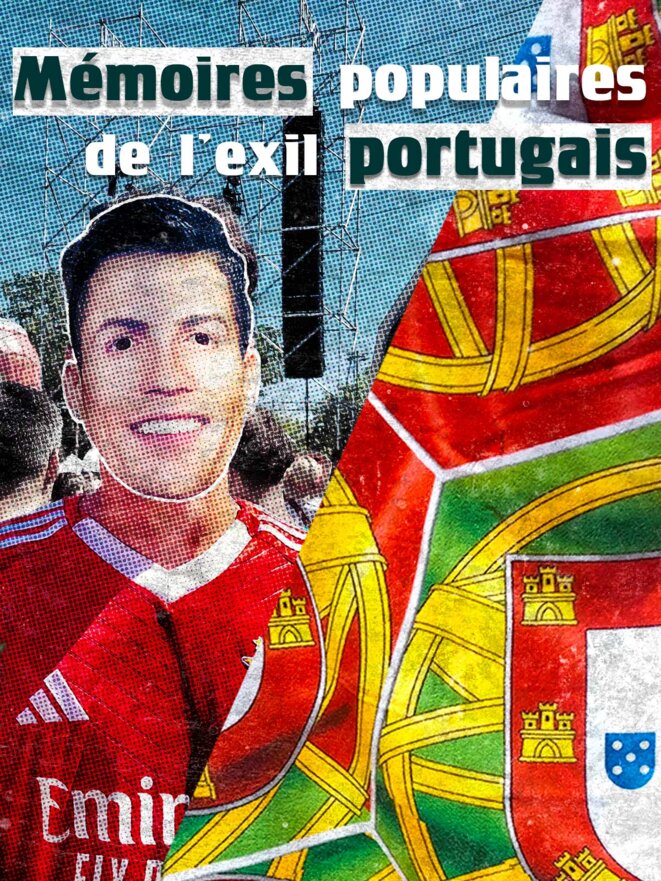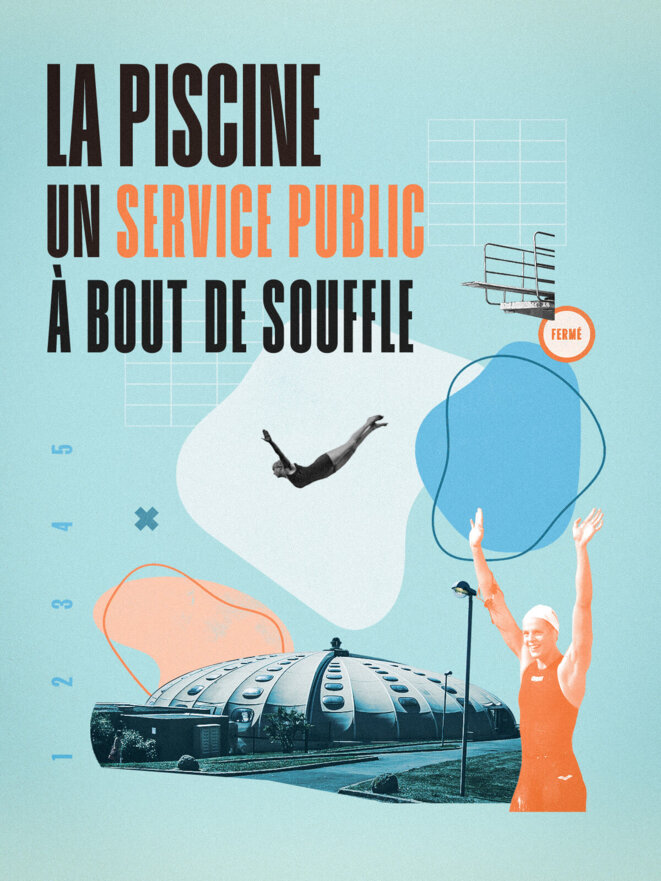Leucémie, lymphome, cancer de la thyroïde, du poumon, du sein, de l’estomac… En Polynésie, l’héritage des essais nucléaires français est inscrit dans la chair et dans le sang des habitants. Le strontium a grignoté les os, le césium s’est concentré dans les muscles et les organes génitaux, l’iode s’est infiltré dans la thyroïde.
L’histoire de cette catastrophe sanitaire et environnementale largement méconnue a débuté le 2 juillet 1966. Ce jour-là, l’armée française procède au tir Aldébaran, le premier des 193 essais tirés pendant 30 ans depuis les atolls nucléaires de Mururoa et Fangataufa, à 15 000 km de la métropole.
Le premier, aussi, d’une série de tests parmi les plus contaminants du programme nucléaire français : les essais à l’air libre. Entre 1966 et 1974, l’armée a procédé à 46 explosions de ce type.
Disclose et Interprt, en collaboration avec le programme Science & Global Security de l’université de Princeton, aux États-Unis, ont enquêté pendant deux ans sur les conséquences des essais atmosphériques en Polynésie française. À l’aide de milliers de documents militaires déclassifiés, de centaines d’heures de calculs par ordinateur et de plusieurs dizaines de témoignages inédits, cette enquête démontre pour la première fois l’ampleur des retombées radioactives qui ont frappé ce territoire vaste comme l’Europe. Elle dévoile également comment les autorités françaises ont tenté de dissimuler l’impact réel de cette campagne dévastatrice pour la santé des populations civiles et militaires.

Agrandissement : Illustration 1

D’après nos calculs, fondés sur une réévaluation scientifique de la contamination en Polynésie française, environ 110 000 personnes ont été exposées à la radioactivité, soit la quasi-totalité de la population des archipels à l’époque.
Le 18 février 2020, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a publié un rapport très attendu sur « les conséquences sanitaires des essais nucléaires » en Polynésie française. Au terme de cette étude, les auteurs concluent que les « liens entre les retombées des essais atmosphériques et la survenue de pathologies radio-induites » sont difficiles à établir, faute de données fiables. Et les auteurs du rapport de souligner l’absolue nécessité d’« affiner les estimations de doses reçues par la population locale et par les personnels civils et militaires ». Cette demande, formulée par les associations de victimes depuis près de dix ans, fait précisément l’objet de notre travail sur les essais nucléaires français dans le Pacifique. Bien loin de l’opacité et des mensonges que l’État s’efforce d’entretenir depuis un demi-siècle.
Pour réaliser cette enquête, nous nous sommes appuyés sur une masse de documents issus du ministère de la défense. Classées « secret défense » jusqu’en 2013, ces quelque 2 000 pages d’archives ont été déclassifiées après une longue bataille juridique entre l’État français et les organisations de défense des victimes des essais nucléaires. Ces documents historiques n’avaient encore jamais été examinés dans leur totalité. Nous les avons organisés et classés par dates et par thématiques dans une base désormais accessible aux victimes, aux chercheurs et aux citoyens. À l’examen détaillé de ces documents s’ajoutent des entretiens avec plus de 50 personnes, dont 18 habitants des atolls, 16 vétérans de l’armée ainsi que des magistrats, des scientifiques et des organisations de la société civile, en Polynésie française et en métropole.
Pour rendre l’ensemble de ces informations accessible au plus grand nombre, Disclose et Interprt ont développé une plateforme interactive unique en son genre associant la modélisation 3D et la visualisation de données complexes. Cet outil permet pour la première fois de reconstituer l’histoire cachée de trois des tests atmosphériques parmi les plus contaminants de l’expérience nucléaire française en Polynésie. Les essais Aldébaran (1966), Encelade (1971) et Centaure (1974).