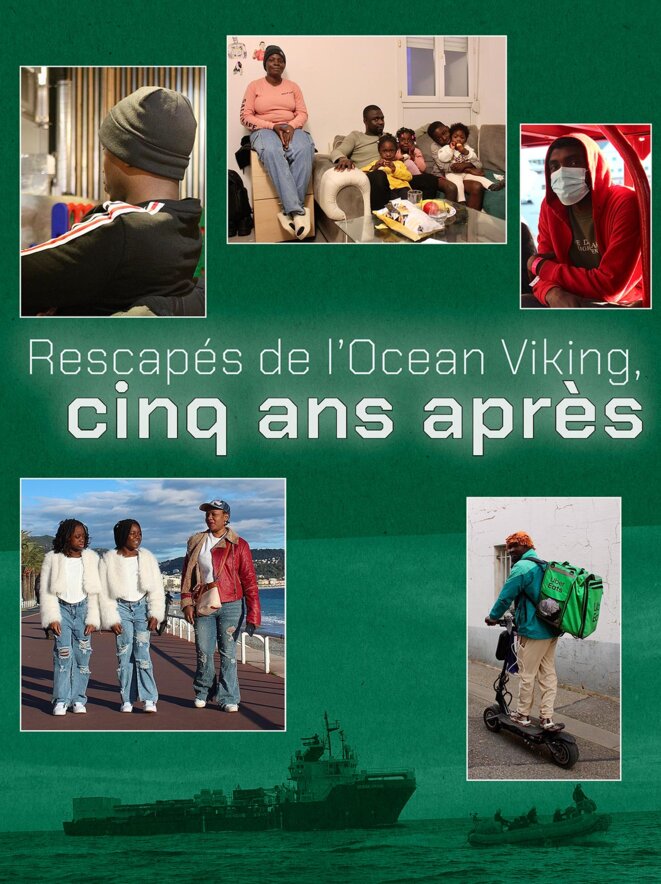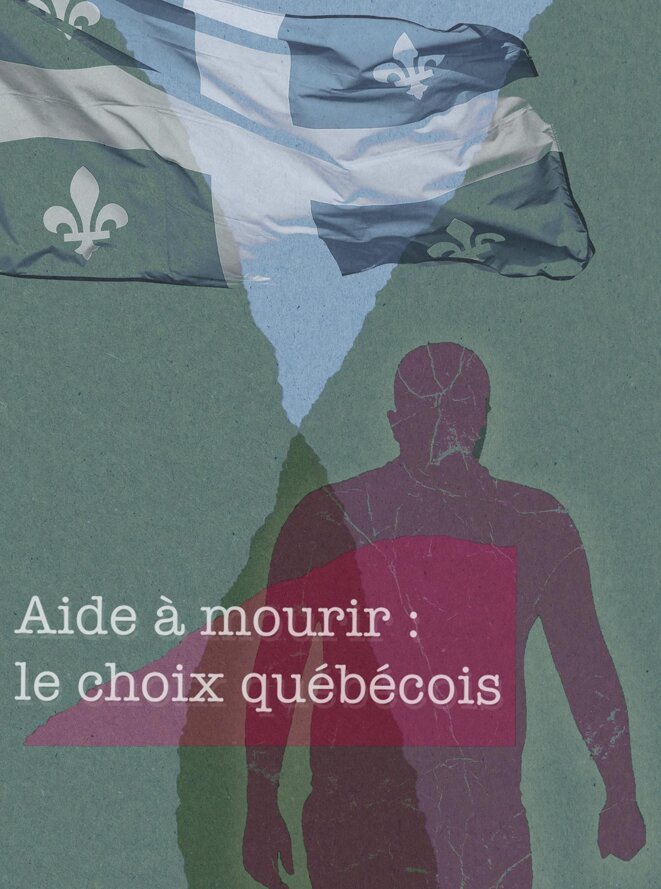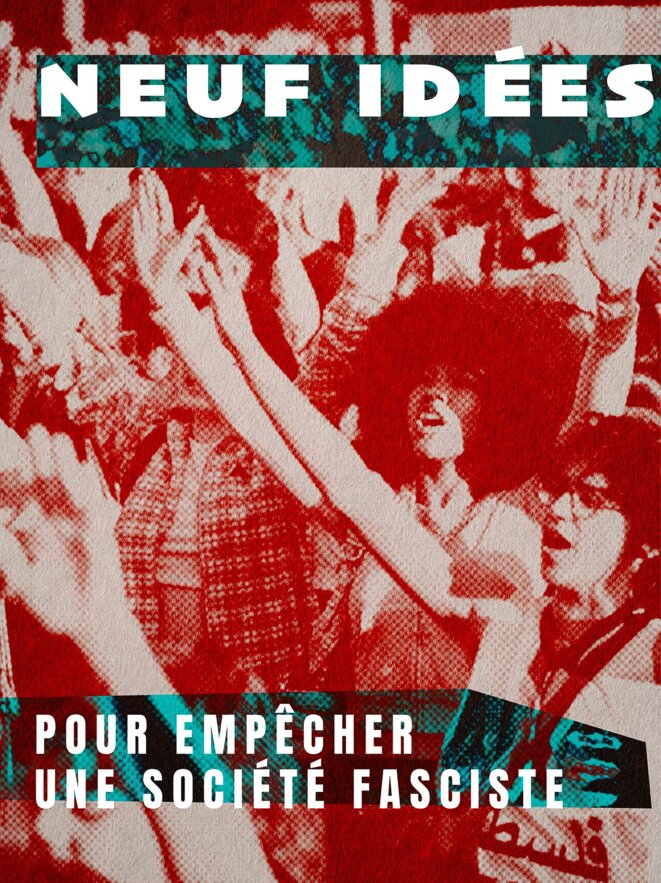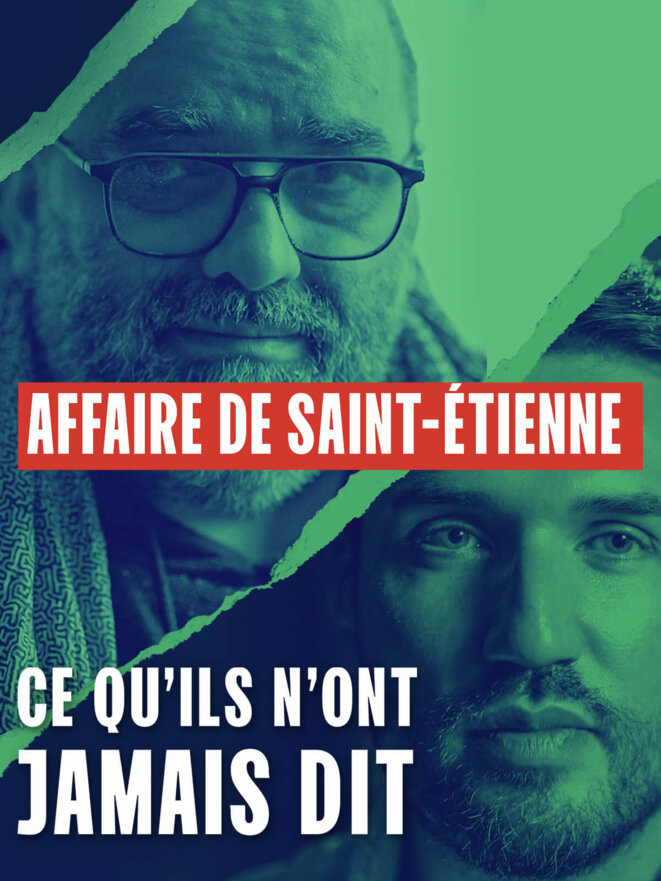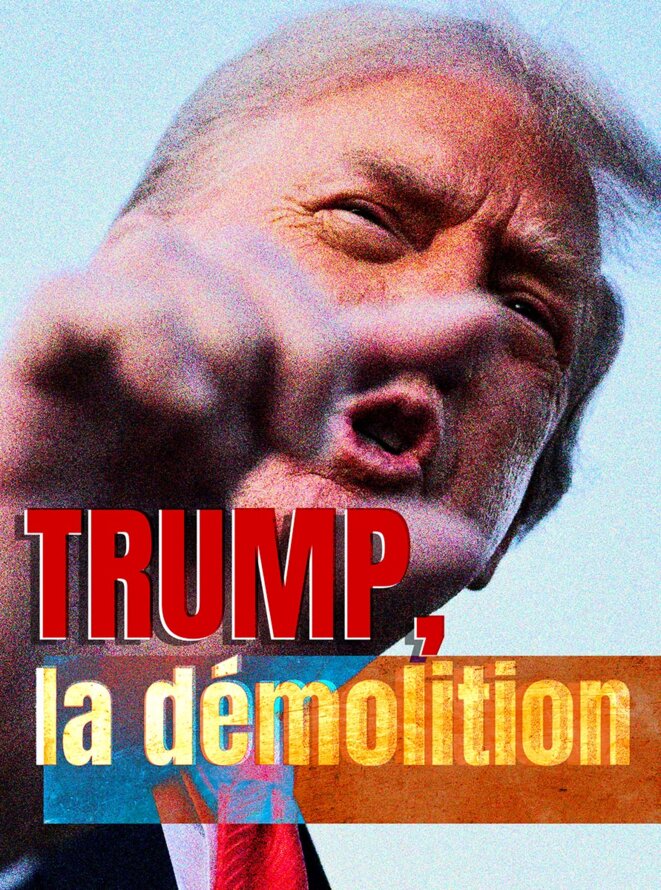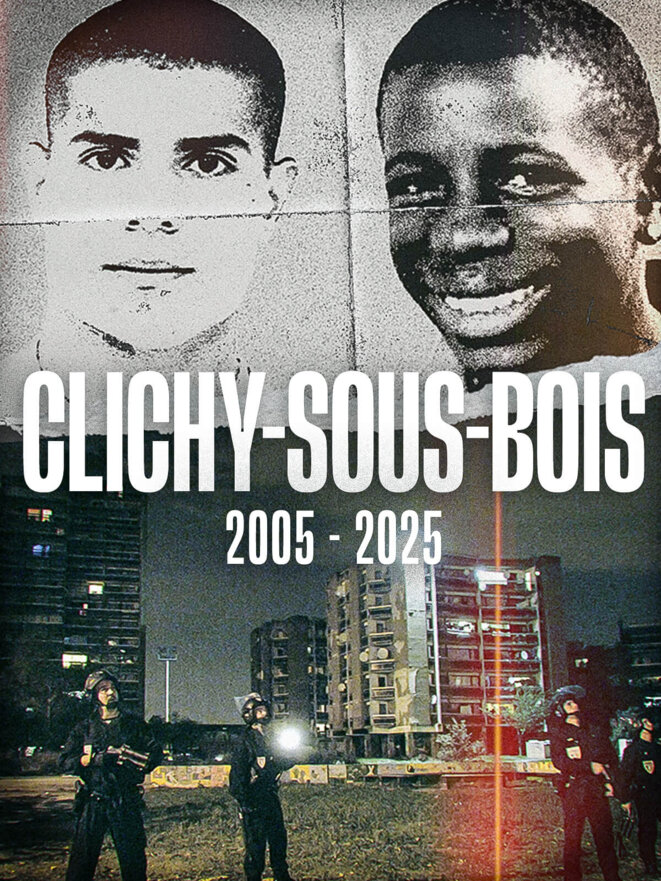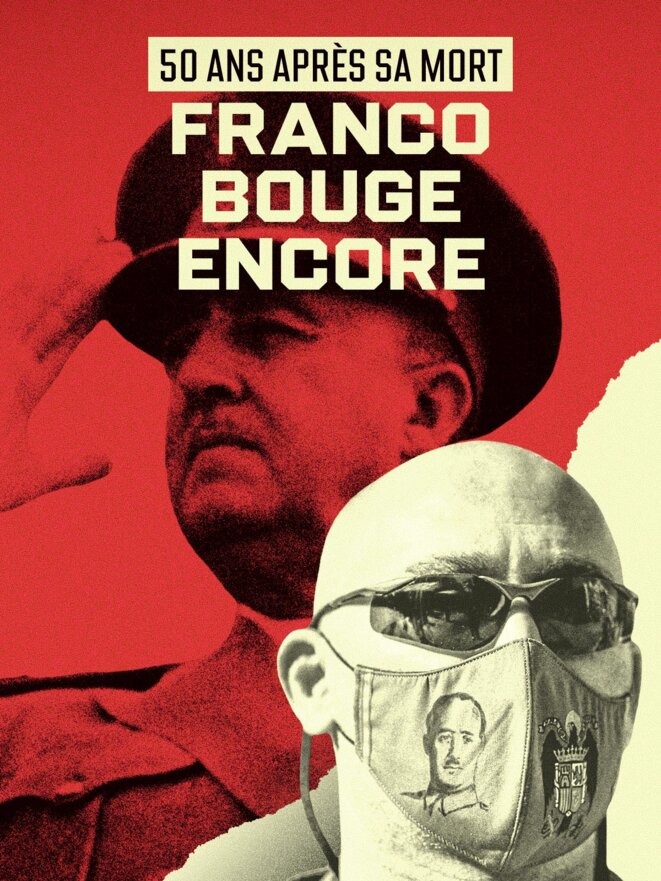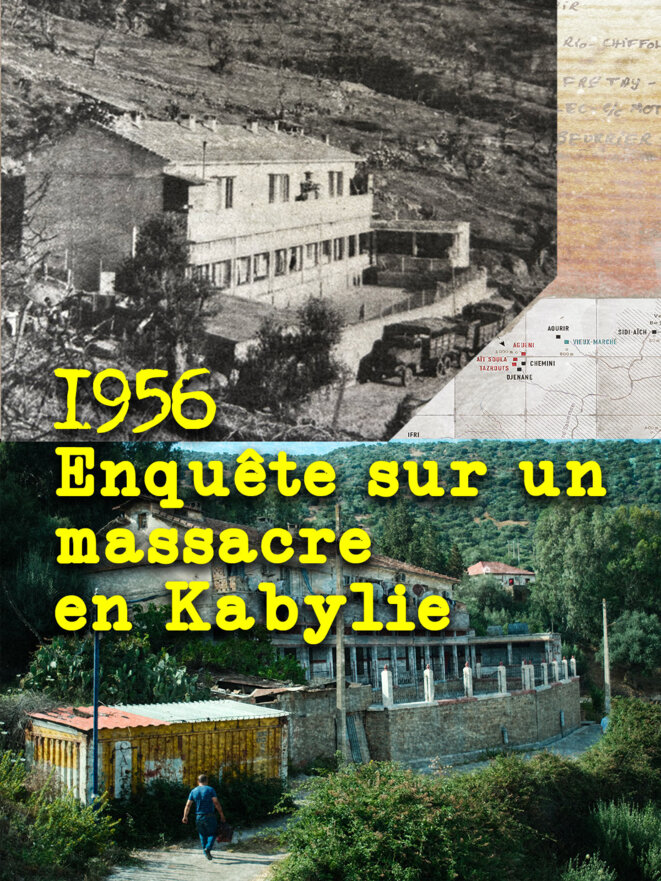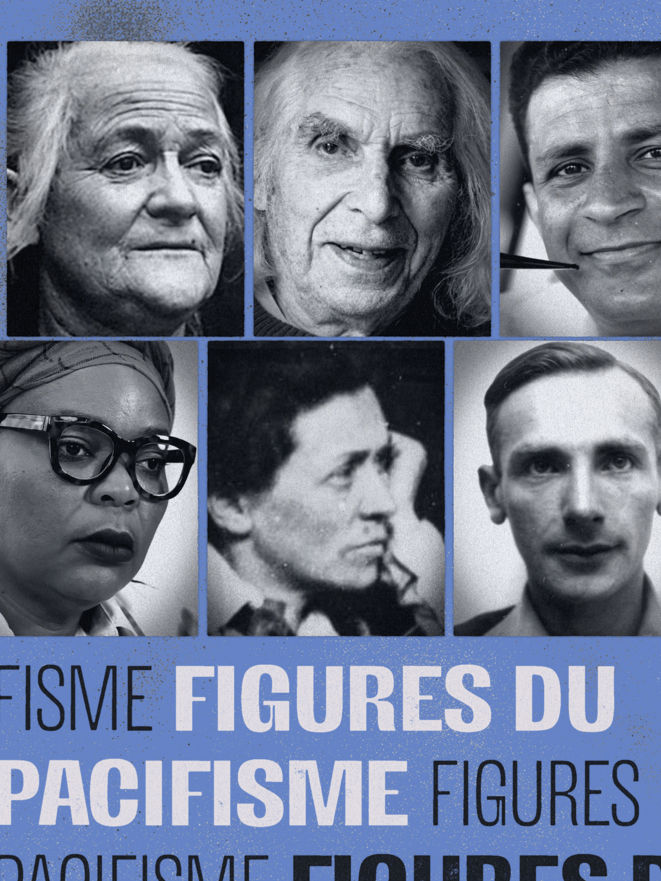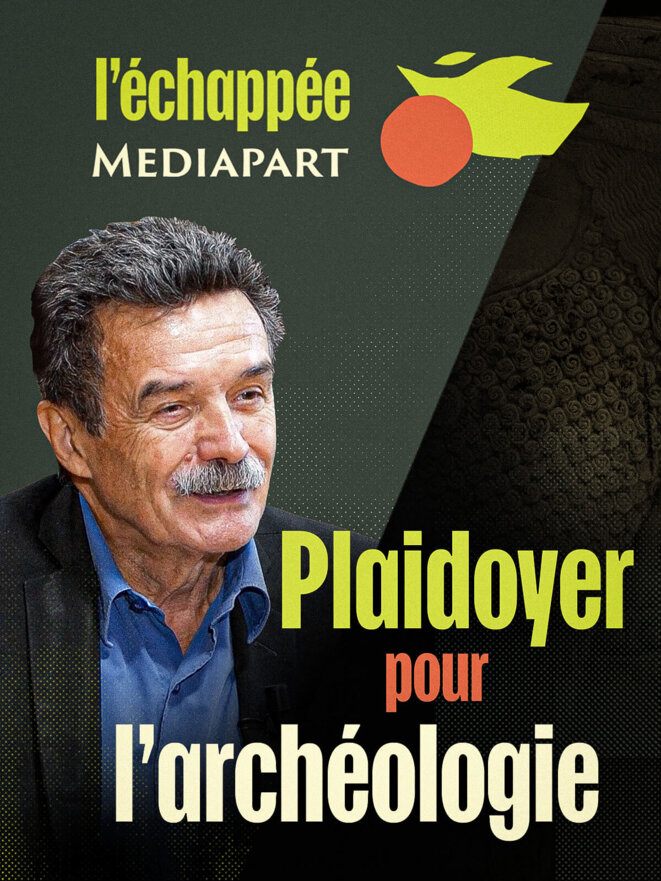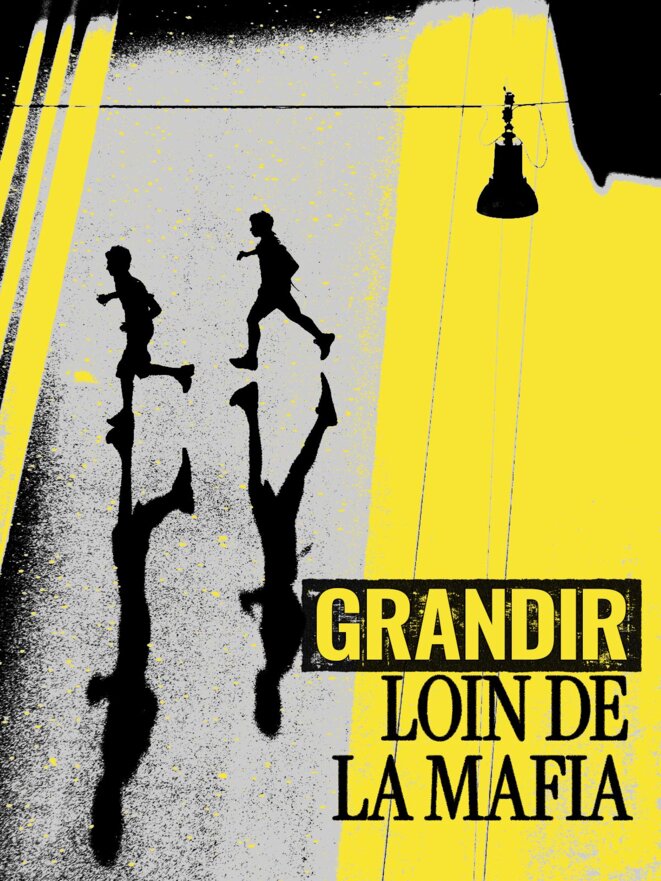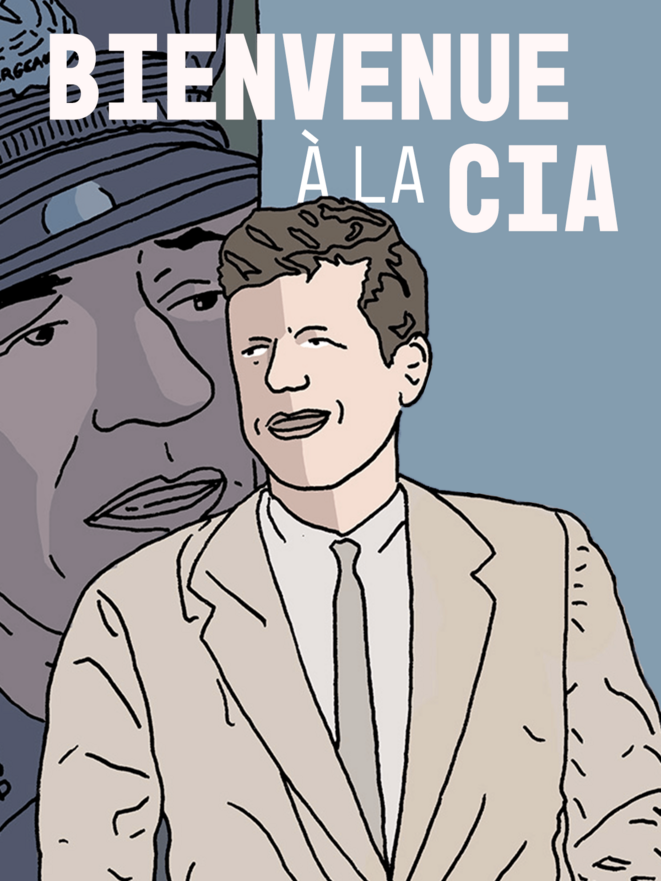Il a sa fiche Wikipedia depuis une petite année mais il n’a pas encore fait son entrée dans le Larousse et le Robert. Il le faudrait, tant en quelques mois, il s’est imposé partout, finissant par être dévoyé, galvaudé. Depuis qu’Uber, la start-up californienne, spécialiste du VTC, a rendu fous les taxis du monde entier, le néologisme « ubérisation » (ou à l’anglaise « uberization ») fait fureur. C’est LE mot de l’année 2015 (et des suivantes) qui fait trembler entreprises et salariés. « Ubérisation » de l’immobilier, de la pharmacie, de la banque, de la plomberie, de l’éducation, du droit, du marketing, du sexe… Tapez le terme dans n’importe quel moteur de recherche et vous découvrirez l’étendue de sa portée et les sueurs froides qu’il provoque dans tous les secteurs d’activité de l’économie traditionnelle. Le mot s'invite aussi à la une de l'actualité, de la grève des taxis qui accusent Uber de les saigner à blanc, aux guerres internes au gouvernement, pour savoir si les travailleurs de ce secteur émergent auront droit à un statut à part, ou à une protection sociale spécifique.
Série Épisode 2 EP. 2 Les leurres de l’«ubérisation»
«Ubérisation»: ce que cache le mot qui fait fureur
Quoi de commun entre Uber, Airbnb ou Blablacar ? Ces trois plateformes sont les fleurons de l'« économie du partage », la nouvelle tarte à la crème d'un monde économique qui se vit comme « ubérisé » à grande vitesse. Mais derrière les mots, quelle réalité ?
Réservé aux abonné·es
Se connecterLa lecture des articles est réservée aux abonné·es
Se connecter