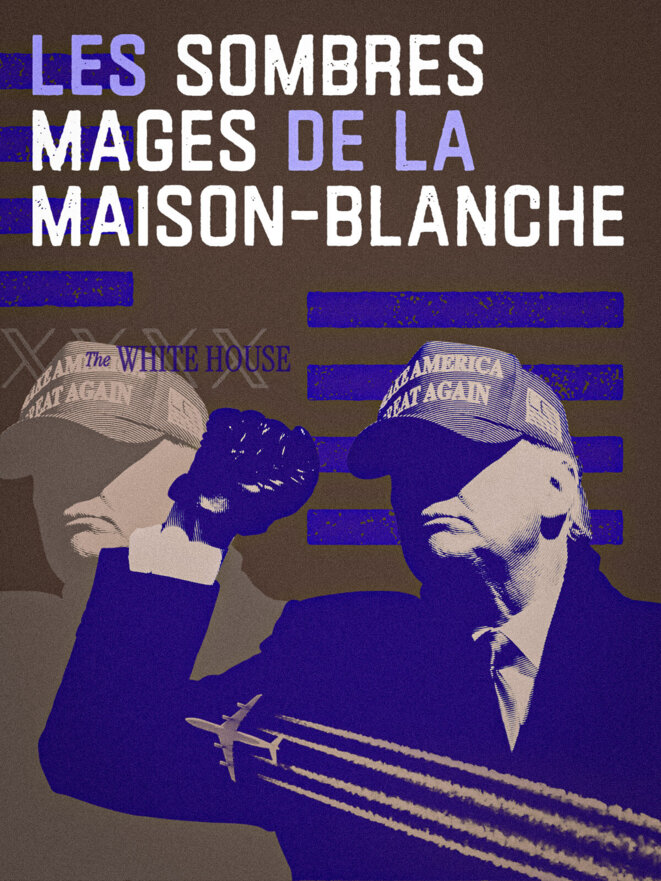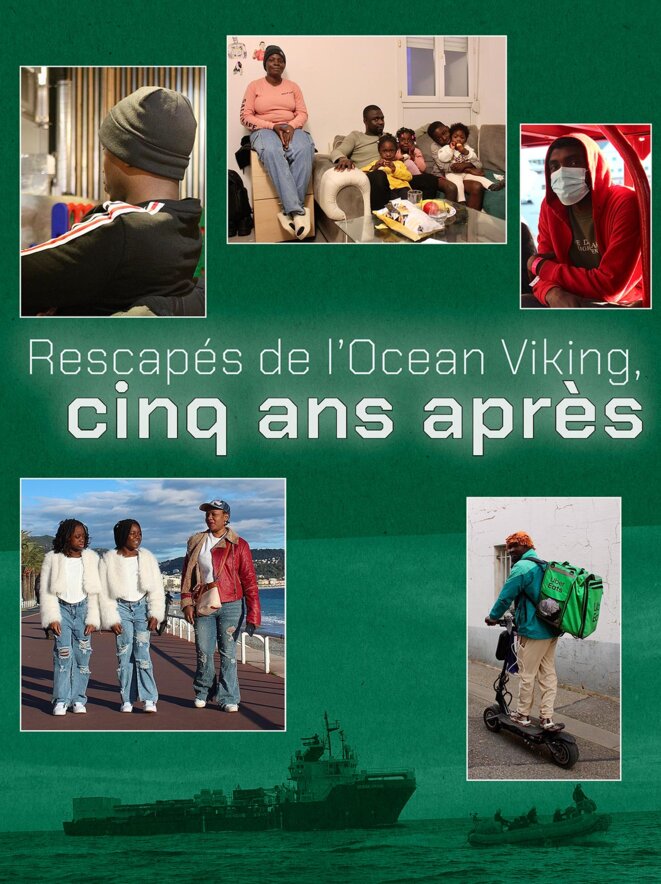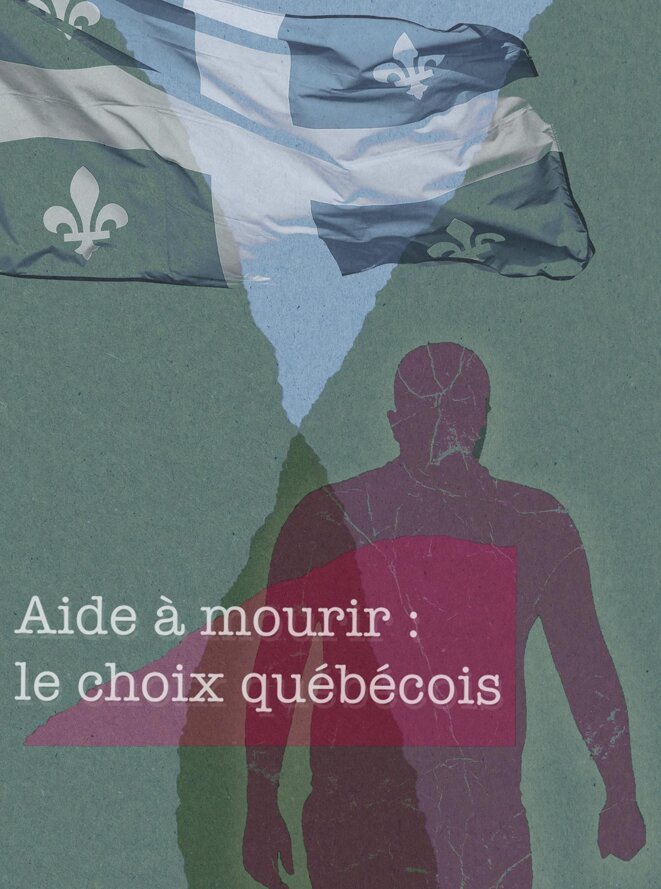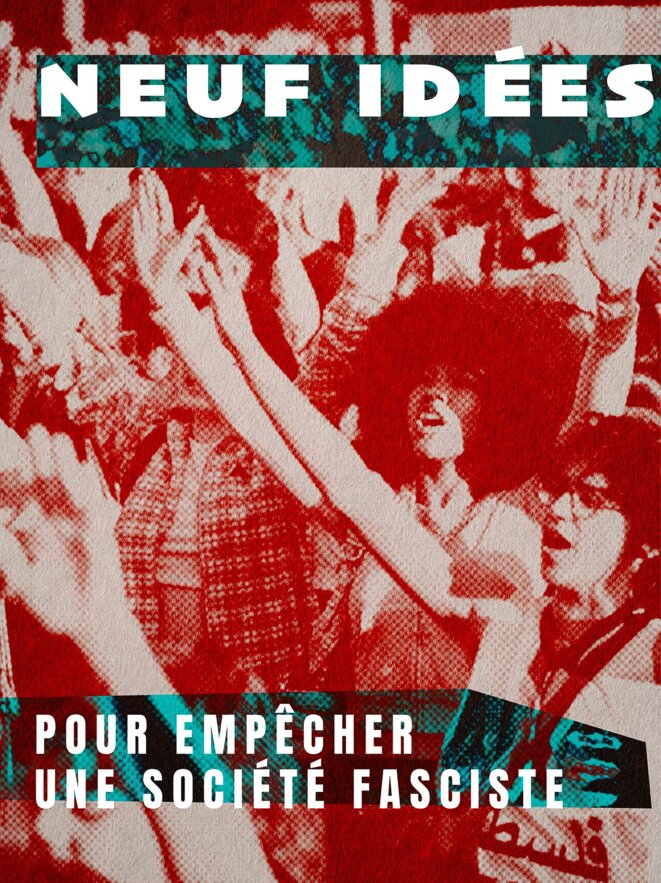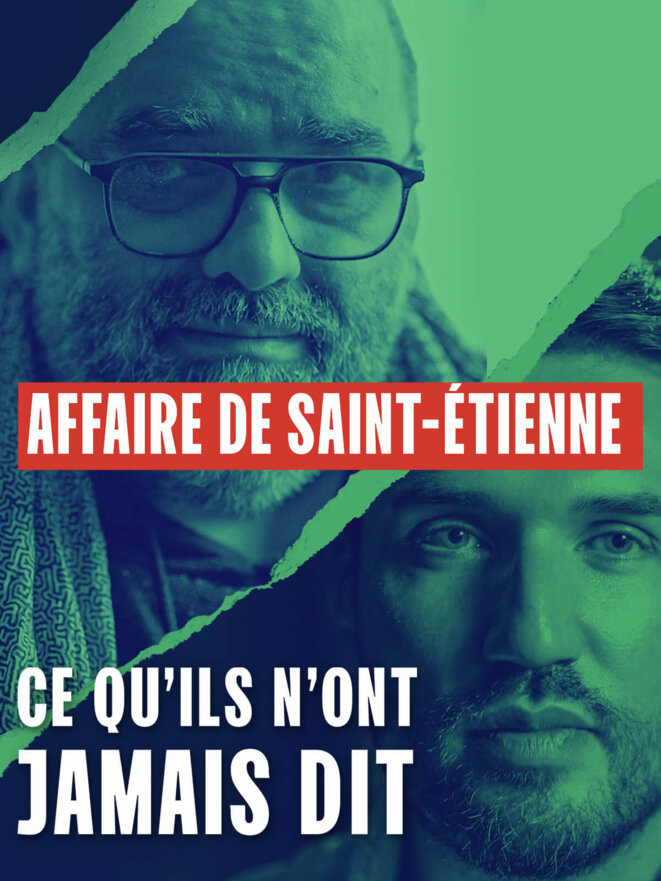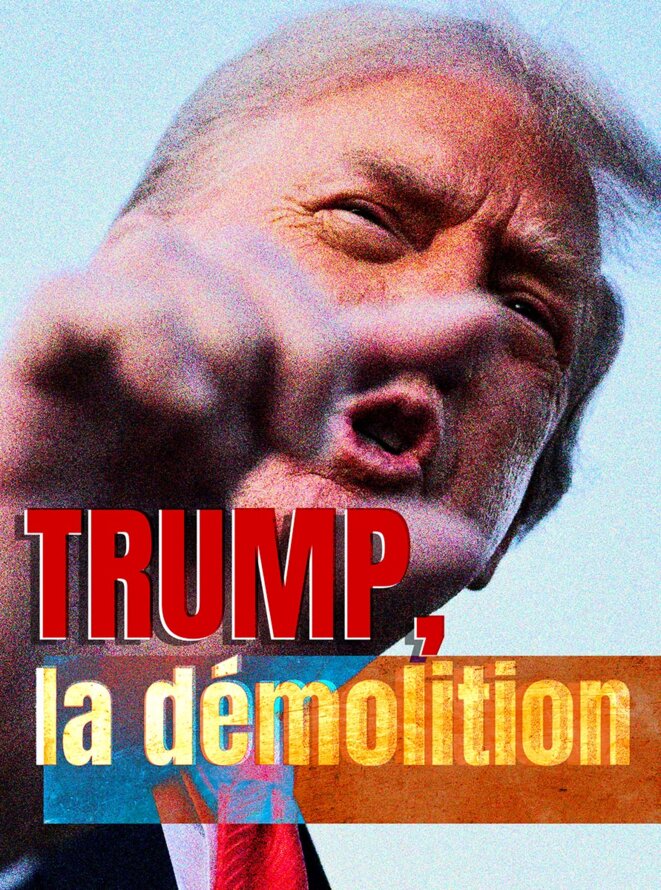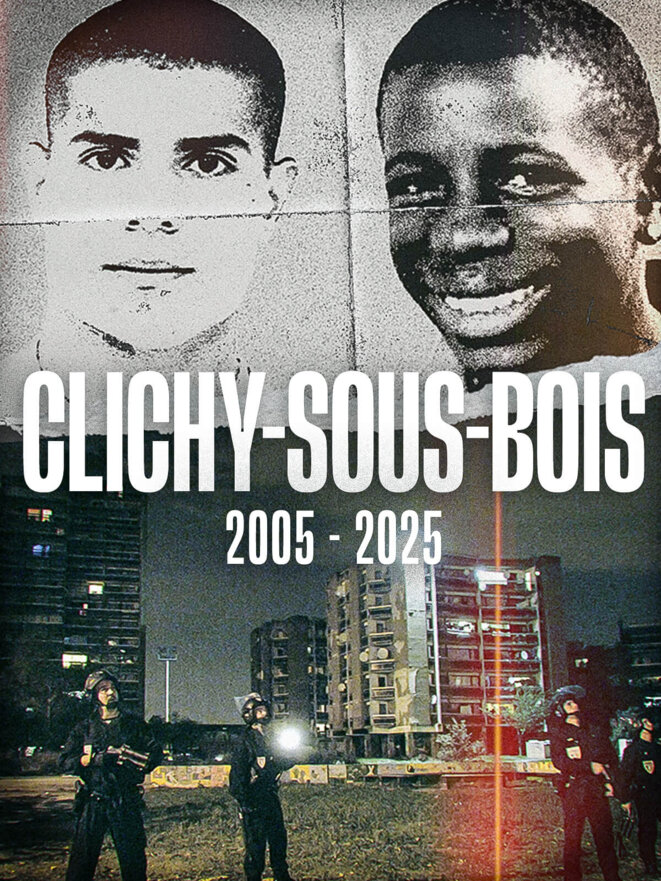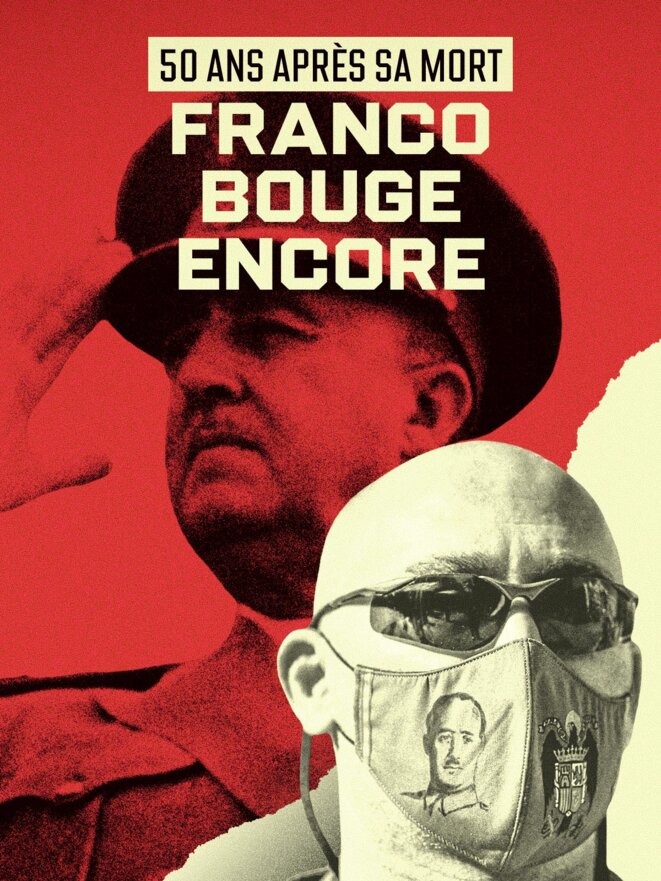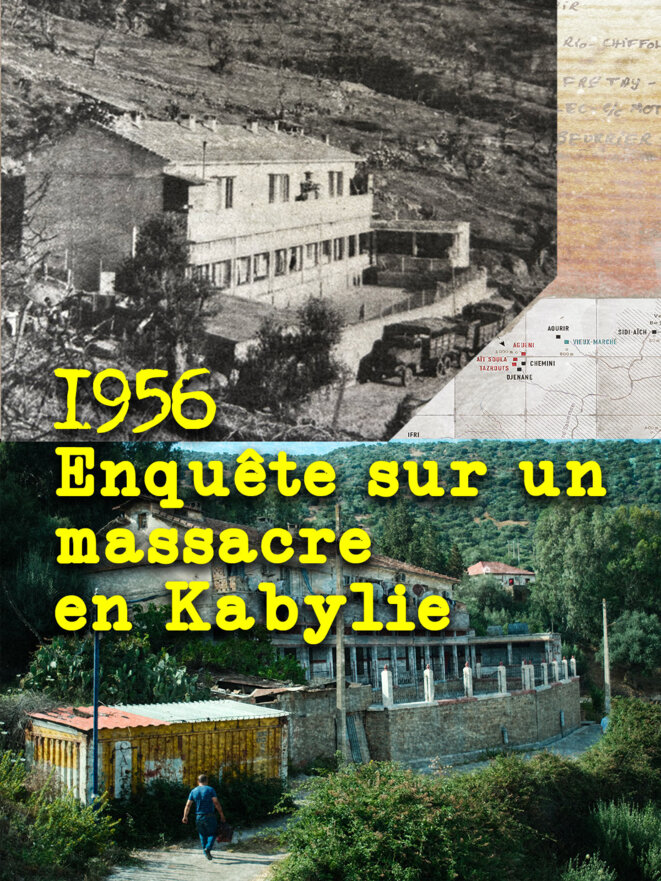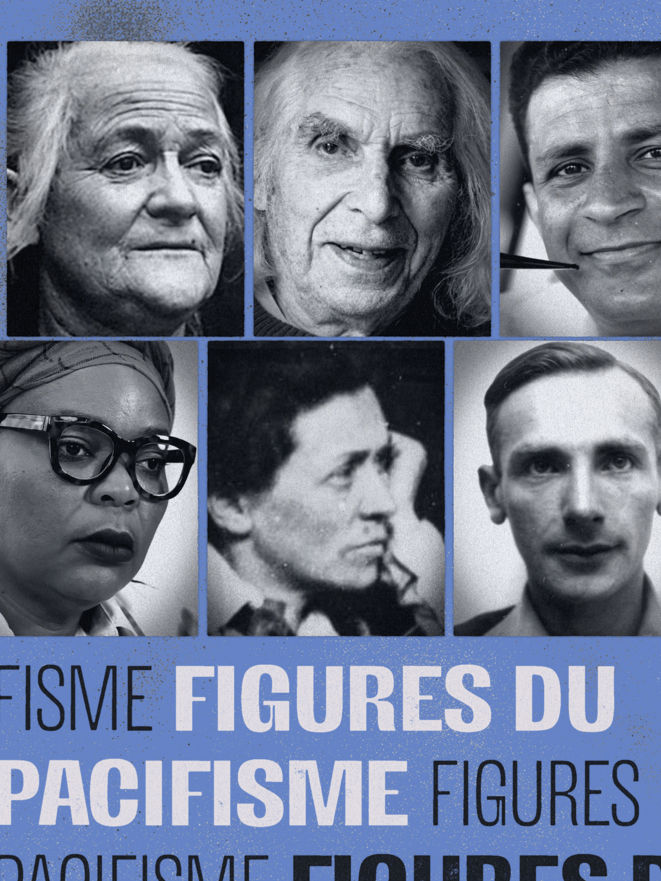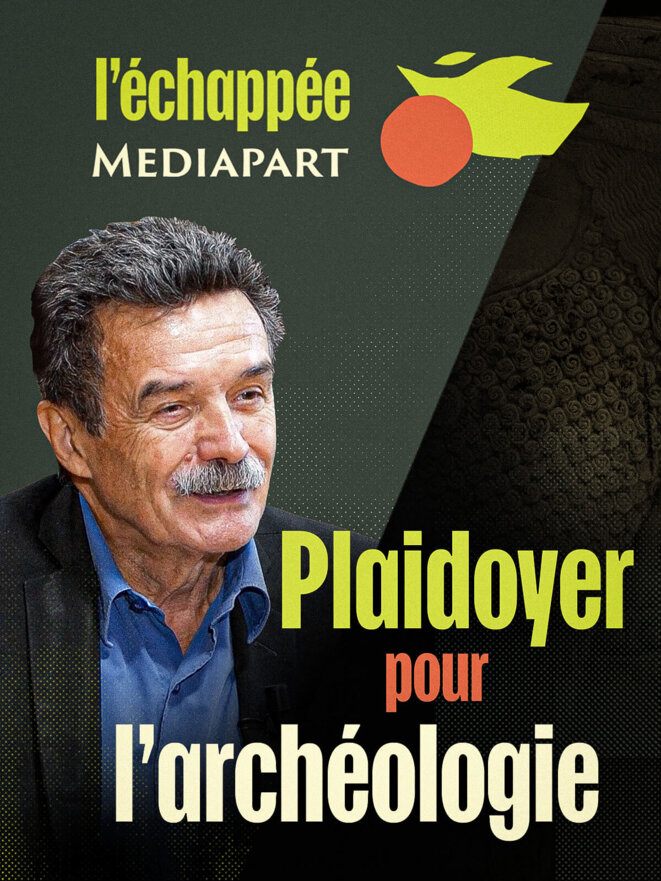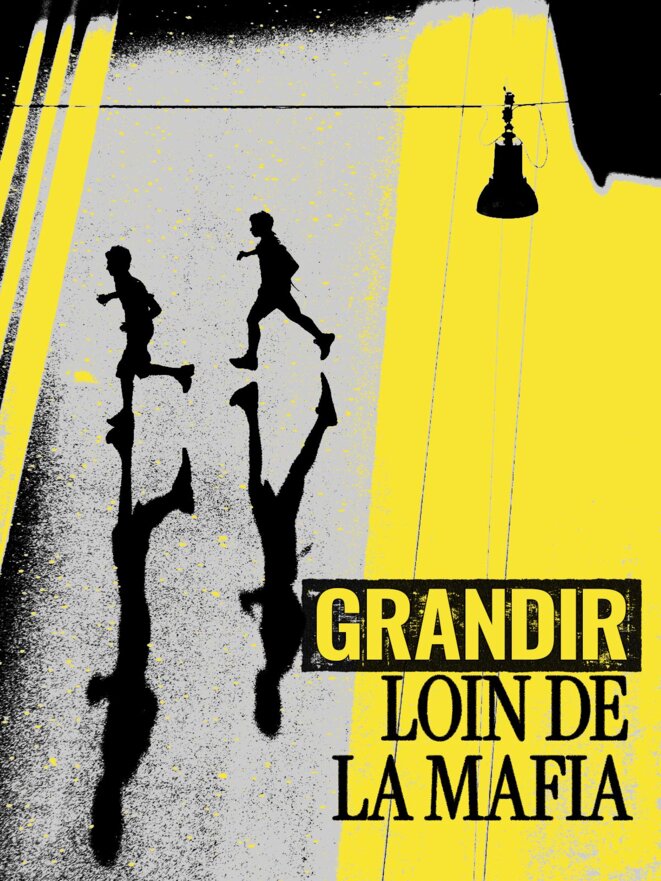Un travail, un appartement, une copine. Julien Pin, 25 ans, rêve juste de commencer sa vie, n'importe où pourvu qu'il y ait du boulot. Mais il devra encore attendre. Julien n'a pas le permis de conduire. Pas non plus de voiture. Prisonnier à Beaurevoir, 1.550 âmes en pleine pampa picarde, juste derrière la frontière du Nord-Pas-de-Calais. Un gros bourg quand même, comparé aux villages alentour: il y a le collège du canton, une poste ouverte tous les jours, une maison de retraite, une pharmacie, une supérette, un café (le dernier). Un notaire. Sur la place principale, devant la mairie et l'hôtel (fermé) se croisent trois boulevards de taille soviétique, «nos principales artères», dit le maire. Vides. Beaurevoir était une petite ville prospère quand la broderie faisait sa richesse. Les ateliers fermés, le chômage culmine à 30%.
> Cliquer sur l'image pour afficher le diaporama sonore :

Agrandissement : Illustration 1

Julien est un grand garçon blond, énervé sous des allures de calme. Il déverse d'une voix douce un flot de rage: Julien ronge son frein depuis ses 18 ans. Cette année-là, auréolé d'un CAP, tout juste embauché, le voilà licencié. La Chine terrasse presque tous les brodeurs de Beaurevoir et, au bout de la chaîne, il y a lui qui trinque. Depuis, il n'a jamais vraiment travaillé. Tout ça ne serait peut-être pas arrivé s'il avait le fameux papier rose. «Ici pour trouver du travail faut aller sur Saint-Quentin, Cambrai, Bohain. Trop loin.» Saint-Quentin n'est pourtant qu'à 20 kilomètres, Cambrai à 22, Bohain à 14. «Il n'y a pas de bus, y a rien. C'est surtout ça le problème quand on est dans un village trop éloigné des villes. Puis dans les villages voisins, y a pas de boulot. Alors on fait les vendanges, des petits boulots à droite à gauche, c'est tout ce qu'on trouve.»
Sa maman, auxiliaire de vie à la maison de retraite, n'a pas les moyens de lui payer le permis. Pas comme certains de ses amis, partis depuis longtemps. «Les gars comme moi, c'est pas pareil. On n'a pas d'argent, on se galère, quoi.» Il aimerait prendre un appartement. «T'as envie de bouger, c'est sûr, mais tu vois bien que tu peux pas.»
Le maire : «Transports gratuits, ou on va crever»
Ici, la voiture est un minimum vital. Un début de statut social. Sans elle, il passe «pour un crevard», un gars juste bon à «rapiner». Pour sortir de Beaurevoir, il «faut demander aux copains, aux frangines», «t'as pas le choix, toujours demander, dépendre de quelqu'un c'est vachement gênant, j'ai pas envie de passer ma vie à ça».
Parfois, Julien prend le bus. Quand il doit se rendre à Pôle emploi, par exemple. C'est à Saint-Quentin, le chef-lieu de l'Aisne. Aller-retour, une heure et demie en voiture, rendez-vous compris. Avec le bus, il faut une journée. Il n'y en a que deux le matin (le premier avant 7 heures), un en fin d'après-midi, sauf le mercredi. «Si j'ai un rendez-vous à l'ANPE à 4 heures de l'après-midi, je suis obligé de prendre un bus le matin à 8h30. Parce qu'il n'y en a pas d'autres après. A Saint-Quentin, j'ai rien à faire. Alors je fais rien, j'attends. Et je rentre à 5 heures.»
Il vit chez sa mère. Obligé. «Avant 25 ans, j'ai eu une période sans emploi, sans chômage, sans rien.» Plus de droits, pas assez vieux pour toucher le RMI. «Je suis tombé sur des annonces ou c'était marqué “permis pas demandé, débutant accepté” mais fallait être titulaire du RMI. Les entreprises embauchent souvent des érémistes parce qu'elles touchent des primes, ça les arrange. Alors toi t'es content, t'as 20 ans, tu crois que tu vas trouver du travail, puis en fin de compte rien du tout. Au fil des années, c'est de plus en plus dur et tu te demandes si ça va toujours être comme ça.»
Des journées à faire «rien, je joue à la console. Si tes copains ont du travail, toi t'as rien à faire et surtout t'es sans argent, c'est ça le pire». Certains de ses amis vivent dans les villages autour et c'est encore pire. «Je sais pas comment ils font là-bas. Enfin si, je sais. Ils ont rien à faire, ils font rien, ils boivent de l'alcool, ils font comme tous les jeunes, ils se font chier.» Depuis le mois de juillet, la mairie a rouvert les vannes des contrats aidés, coupées net avant la crise. Julien a retrouvé un travail payé 720 euros. Il repeint les bâtiments communaux. Il peut enfin économiser, est en train de passer le code, la maison de l'emploi de Bohain financera 80% du permis. L'an dernier, il n'y avait pas eu droit. Et avant, personne ne lui avait dit qu'on pouvait l'aider. Avec prudence, il se prend à rêver. «Là, je suis bien lancé.»
Eric Limpens, le maire (sans étiquette), réclame «des transports gratuits, sinon on va crever. Les gens ici ont des savoir-faire, mais pas de moyens de locomotion, ils n'ont pas envie d'être des assistés». Cette année, l'élu a fait des vœux offensifs. Devant ses administrés, il a dit que, désormais, il ferait de préférence travailler les entreprises locales qui embauchent des gens de la commune pour les soutenir dans la crise, et tant pis si c'est «un peu du protectionnisme»: «Quand Renault qu'on a soutenu avec la prime à la casse délocalise en Turquie, y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et puis faudrait qu'on m'explique pourquoi le lin qu'on cultive dans le Vexin est traité en Chine puis revient ici une fois transformé», dit le maire qui est aussi agriculteur.
«La bande des Quatre»
Dans sa bénédiction laïque de début d'année, le maire a annoncé deux grandes nouvelles: la construction d'un cabinet médical (encore faut-il trouver le remplaçant du docteur Cousin, lessivé) et l'arrivée de la vidéo-surveillance. Pardon, de la «vidéo-protection». Le maire y tient. Il y aurait donc de la délinquance à Beaurevoir? «Non, mais il y a eu des incivilités par le passé, des panneaux stop pliés, de la casse d'abribus», dit l'édile. «On a été au-devant des desiderata de la population, admet le premier adjoint, François Fayolle. Si en ville, les forces de l'ordre cernent les problèmes, ça peut peut-être se déplacer chez nous après. On commence à voir de temps en temps des regroupements de jeunes qui viennent, des plaques d'immatriculation de la Somme et du 59» (le département du Nord, ndlr). Le sous-préfet encourage la démarche. L'Etat subventionne. «Beaurevoir sera un village tranquille et nous pourrons attirer des habitants, dit Eric Limpens. Le conseil municipal était mitigé, certains ont craint qu'avec les caméras, la gendarmerie ne soit supprimée.»
A Beaurevoir, Julien est connu comme le loup blanc. Quand il était un peu plus jeune, c'était même une terreur du village. «Avec mes potes, les gens nous appelaient la bande des Quatre.» «J'ai cassé pas mal de choses, ouais. L'ennui, l'ennui à mort, t'en veux à tout le monde et tu casses tout. Tu veux faire voir que t'es là. Avec les potes, on était là à l'arrêt de bus, les gens ils passaient c'était comme si on faisait partie du décor! Mais là, les gens te disent pas bonjour, ils te prennent pour une racaille ou je sais pas. T'existes plus dans le village on dirait. Alors tu te fais remarquer, tu casses tout, tu fous le bordel. Puis au bout d'un moment, tu te dis ça sert à rien tu te punis toi-même.»
Le maire d'avant leur menait la vie dure, raconte Julien «et on le lui rendait bien». Il montre une maison face à l'église dont l'entrée a été murée. «Il avait fait poser les parpaings pour pas qu'on y rentre.» Traîner n'aidait pas non plus pour les flirts. «Quand les filles te voient plantées dans l'arrêt de bus, forcément c'est pas attirant, elles se sauvent quoi, c'est logique.»
Julien aimerait que son petit frère de 13 ans devienne footballeur. Ainsi, lui au moins obtiendrait son bon de sortie. Pas comme «ceux qui arrêtent l'école à 16 ans, ou ceux qui y sont encore mais font des trucs qu'ils n'ont même pas choisi»; ceux qui, à leur tour, pourraient prendre leurs quartiers dans l'abribus. Le maire ne sait pas trop quoi faire pour tous ses jeunes. Il est déjà content qu'on parle d'eux: «Ils ne cassent pas de voitures, eux, alors on les oublie.»