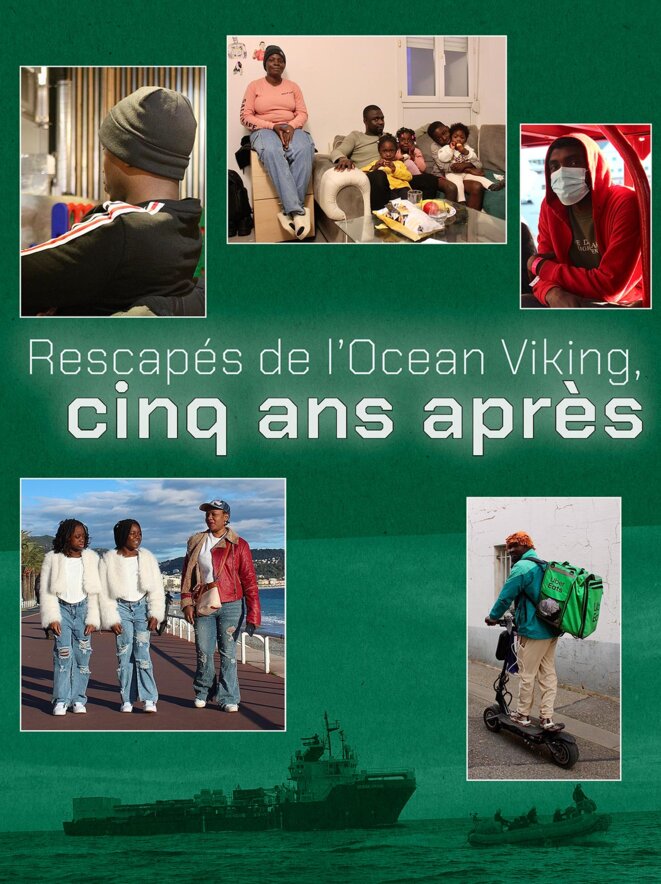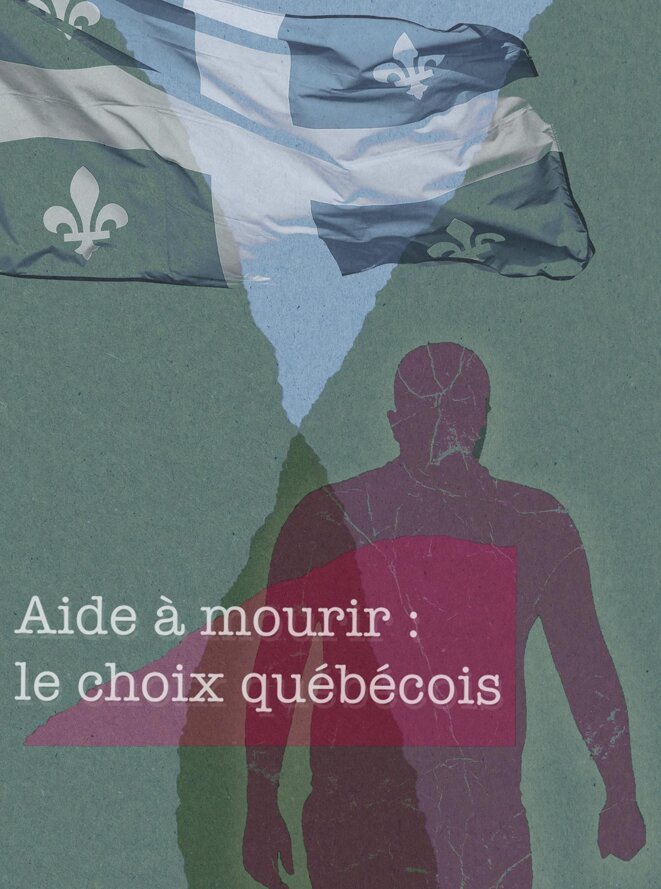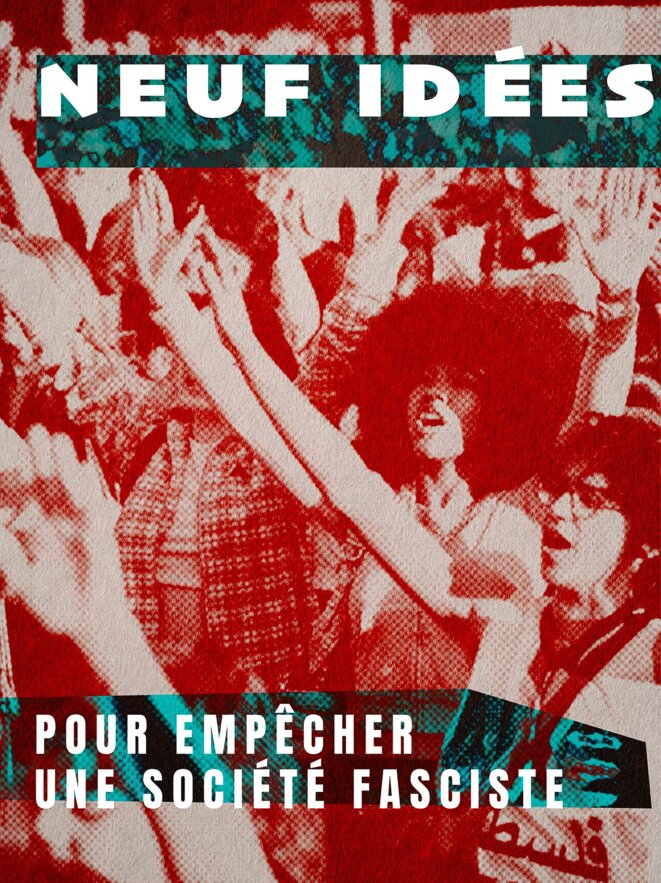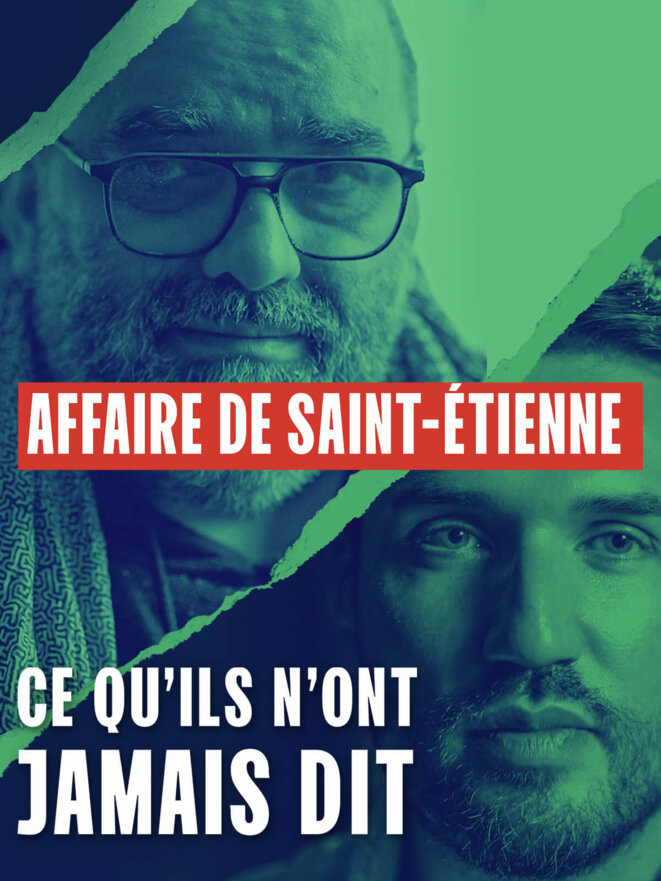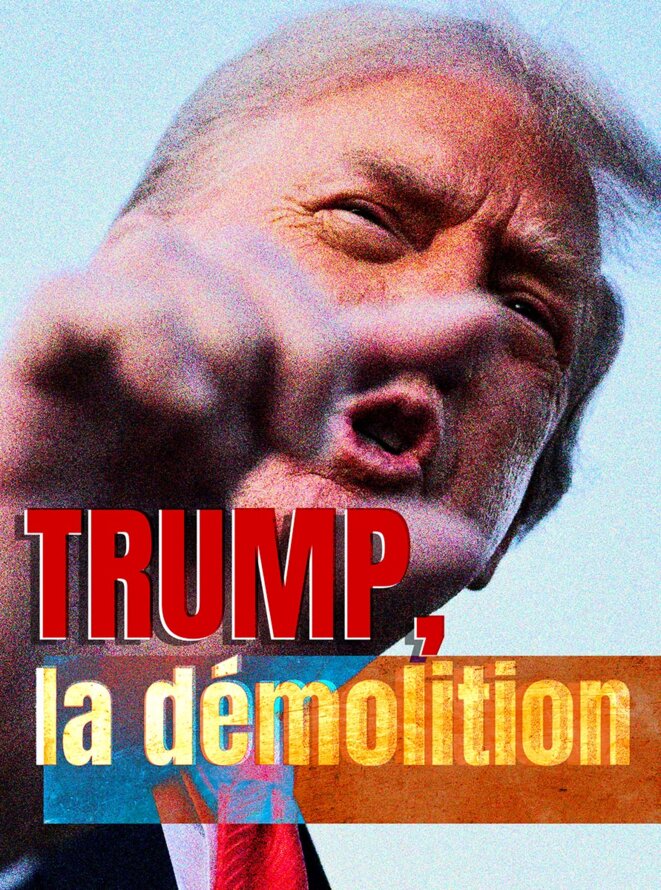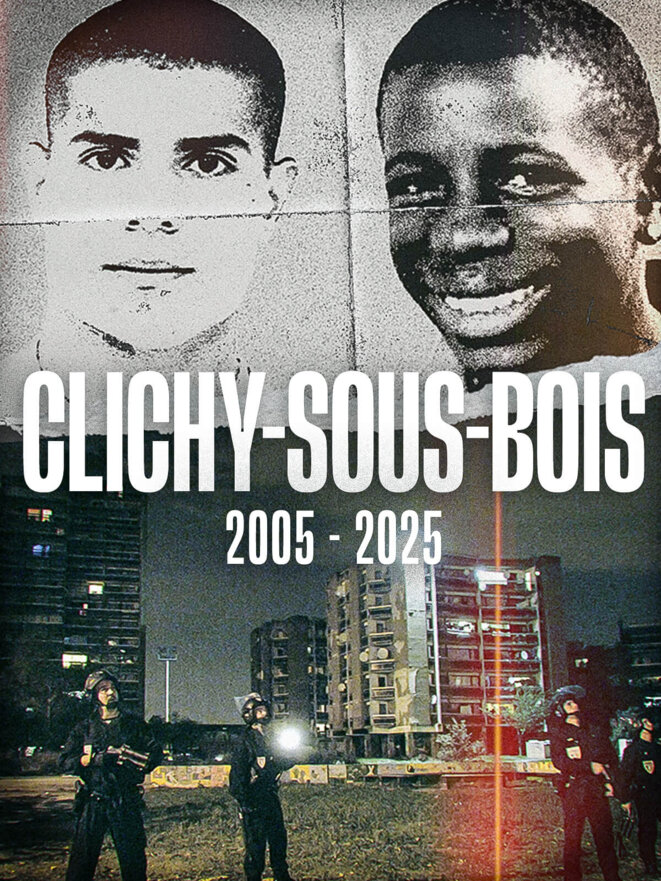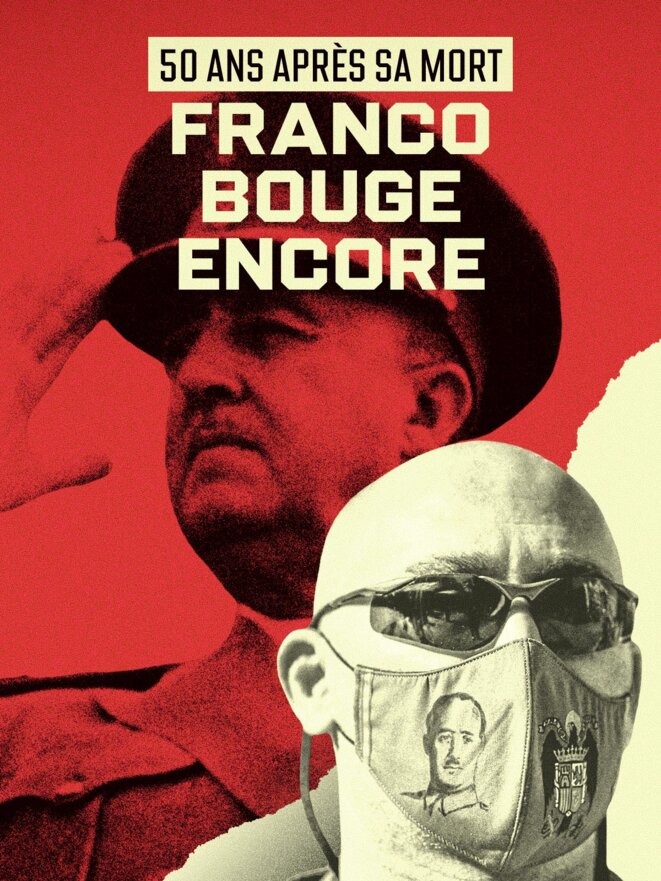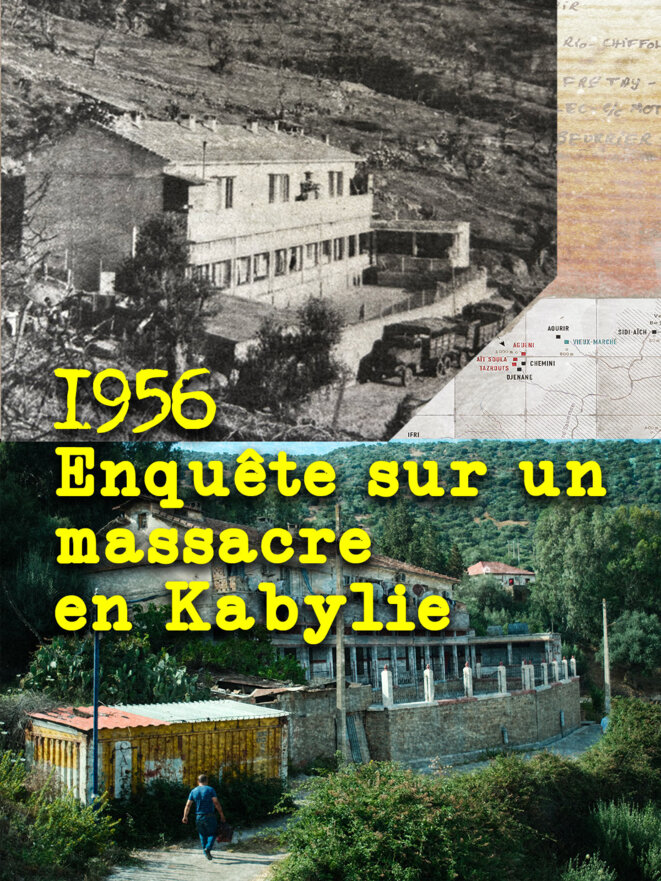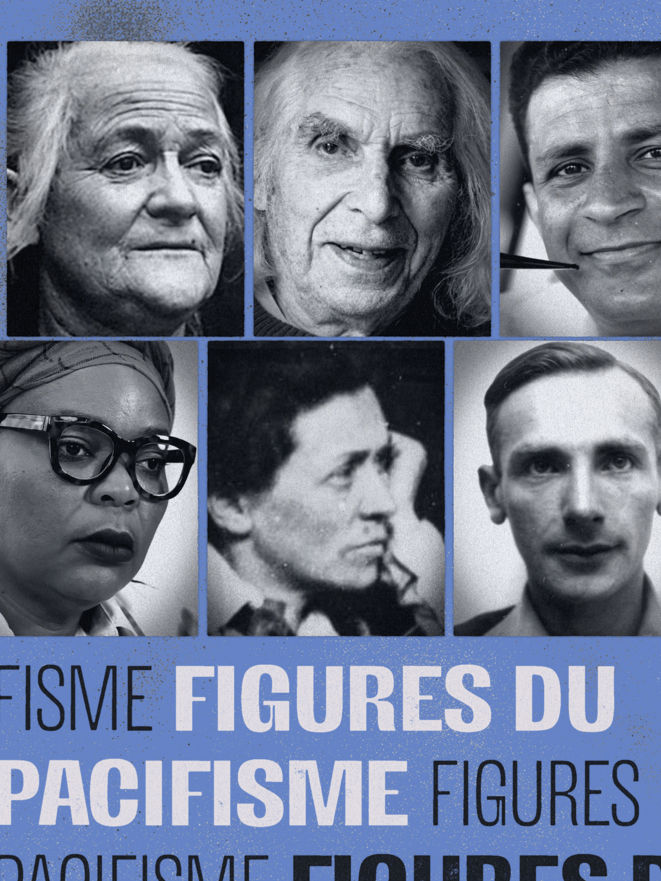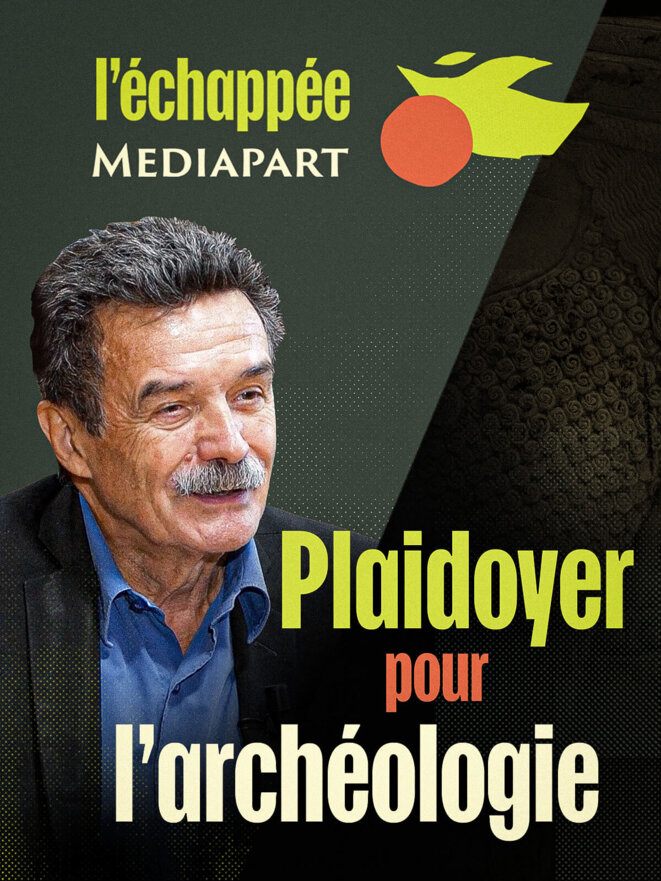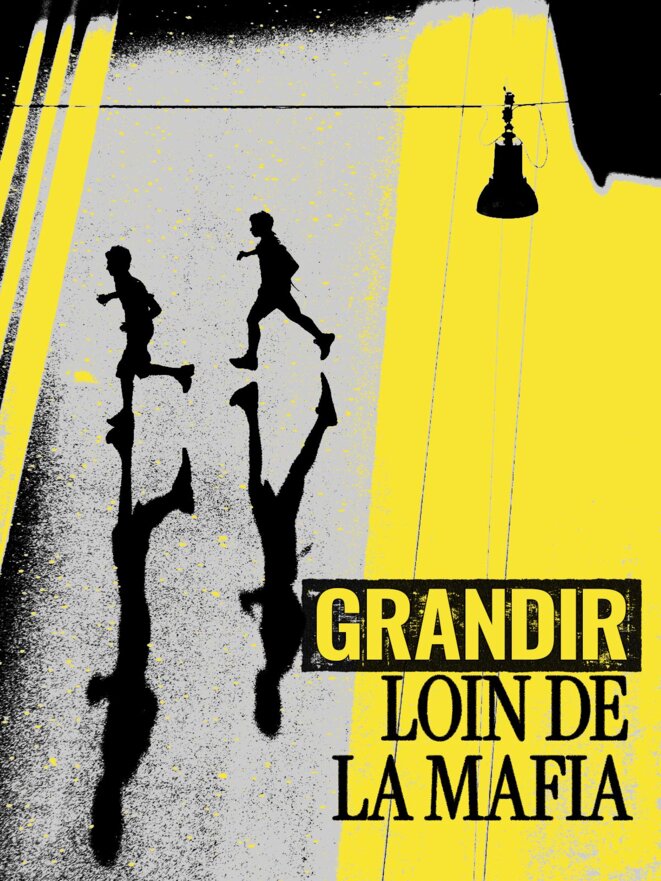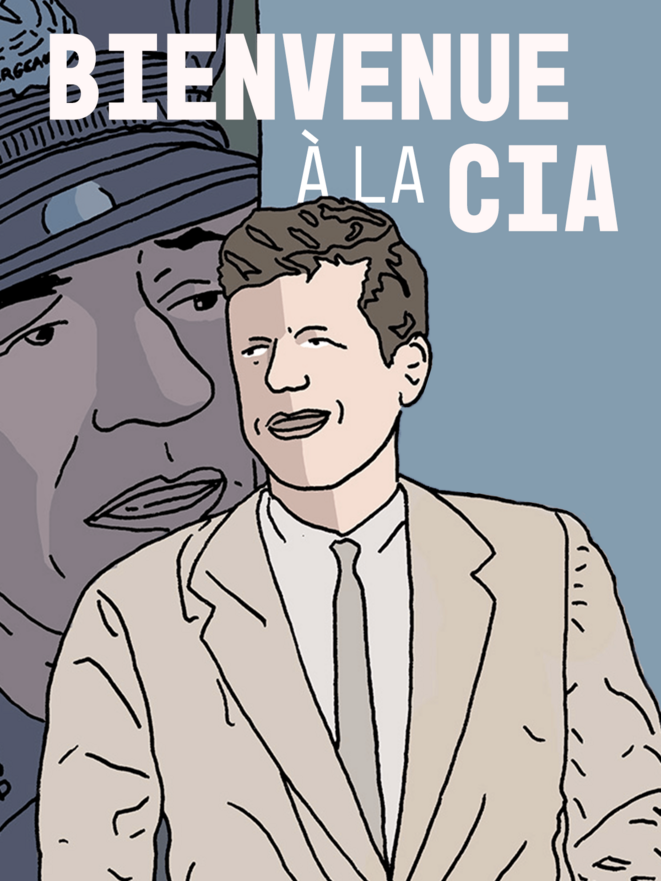Harald Welzer, 41 ans, est psychosociologue. Il dirige à Essen le Center for Interdisciplinary Memory Research, qui dépend de l'université. Ses travaux portent sur la mémoire et la violence. Quasiment anonyme en France, à part une tribune dans Le Monde publiée il y a quelques mois, Welzer est un intellectuel reconnu en Allemagne. Il intervient régulièrement dans les pages Culture de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, grand journal conservateur. Certains de ses ouvrages ont connu de beaux succès d'édition. Entretien dans son bureau à Essen, dans la Ruhr, sur le sentiment européen, ses liens avec les intellectuels français, et l'urgente nécessité de repenser notre modèle de développement.

Agrandissement : Illustration 1

Les Européens vont élire leurs députés. Vous êtes psychosociologue: les peuples européens se connaissent-ils? Leurs imaginaires communiquent-ils?
Allemands, Français, Italiens... Nous vivons dans des mondes séparés. L'unité politique de l'Europe ne signifie pas que les peuples européens se connaissent mieux. Il y a des affinités entre voisins, par exemple les Allemands avec les Autrichiens et les Suisses à cause de la langue... mais les identités nationales restent prédominantes. Je suis par exemple assez frappé dont nos médias ont rendu compte, ces dernières semaines, de l'éventuelle entrée de Fiat au capital d'Opel. [Fiat s'est finalement retiré, ndlr]. Un détail a retenu l'attention: le fait que le patron de Fiat, Sergio Macchione, porte en toutes circonstances une chemise et un pull-over et pas un costume. Comme si on sous-entendait que ce n'était peut-être pas raisonnable de lui confier un fleuron de l'industrie allemande comme Opel... Je ne dis pas que c'est bien ou mal. C'est aussi avec ce genre de clichés sur les Italiens que les Allemands forgent leur identité. Après, pour Opel, c'est peut-être une mauvaise décision: juste parce qu'on ne voulait pas confier Opel à un Italien qui porte des pull-overs, on l'a confié à un Autrichien exilé au Canada soutenu par des oligarques russes [Le groupe Magna, ndlr]!
Le sentiment européen existe-t-il?
Dans le cadre d'une étude, le centre de recherche que je dirige a invité des professeurs d'histoire de différents pays européens à parler les uns des autres. Ils disaient tous au départ: «L'Europe c'est important, nous devons apprendre à nous connaître», ce genre de choses que l'on dit tout le temps. Mais en creusant, on s'est aperçus que les imaginaires ne communiquaient pas entre eux. L'idée européenne n'est qu'une abstraction. C'est une énorme bureaucratie à laquelle il est difficile de s'identifier. Nos différences culturelles restent intactes.
Vous êtes psychologue, sociologue, vous vous intéressez à la politique, à l'histoire... Comment vous définiriez-vous?
Je suis un «dilettante universel». Les barrières entre les disciplines m'ont toujours dérangé. J'ai deux thèmes de recherche: le souvenir et la violence, deux phénomènes que l'on ne peut appréhender qu'en croisant les regards, en mélangeant la psychologie, la sociologie, l'histoire. Comment peut-on écrire sur le souvenir sans connaître le fonctionnement des neurones? Pareil avec la violence. C'est une option toujours possible. Elle est le produit d'une culture, d'une histoire et aussi de processus biochimiques internes au cerveau.
En Allemagne, votre livre Grand-père n'était pas nazi (2002, voir sous l'onglet Prolonger) a eu un retentissement considérable. Certains ont dit qu'il marquait le point final de la réflexion sur le nazisme...
(Il rit) Un point final? C'est un début, au contraire! Pour un livre de sociologie, ce livre a eu un retentissement formidable. Il a été réédité plusieurs fois, a suscité des films, des documentaires, des projets dans les écoles. Grâce à ce livre, les Allemands ont commencé à s'interroger sur leur propre grand-père. En général, les petits-enfants allemands racontent toujours des histoires positives sur leur grand-père. Ils essaient de lui construire un passé de résistant, même si ce n'était pas le cas. Mais comme le dit l'historien américain Raul Hilberg, l'Holocauste en Allemagne est une histoire de famille. C'est comme ça. Chaque famille a été en quelque sorte contaminée, en bien ou en mal. Imaginez: vous avez 14 ou 18 ans, vous avez ce grand-père, votre grand-père chéri. A l'école vous avez appris que l'Allemagne a fait des choses terribles, qu'il ne faut plus jamais que cela arrive. Eh bien, l'histoire, c'est tout ça à la fois. Ce que les enfants apprennent à l'école et ce gentil papy avec lequel vous fêtez Noël tous les ans. Je voulais juste faire comprendre ça.
En 2006, quand Jonathan Littel a publié Les Bienveillantes, vous avez écrit que ce livre vous déplaisait, mais que vous ne trouviez pas étonnant qu'il ait eu un succès considérable en France. Pourquoi?
Pour les Allemands, l'idée que le père, l'oncle ou un ami de la famille a été gardien d'un camp de concentration ou a travaillé pour la Gestapo est presque familière. C'est inconfortable, certes, mais pas inconcevable. C'est ce qu'a montré Christopher Browning dans Des hommes ordinaires [accès sous ce lien au texte intégral]. Les hommes du 101e bataillon de réserve de la police allemande qui ont exécuté la Solution finale en Pologne étaient des dentistes, des avocats, des banquiers qui, sans que l'on sache pourquoi, en sont venus à tuer des gens. Pour les Français, au contraire, cette idée est totalement étrangère. Dans Les Bienveillantes, Littel construit la figure d'un criminel franco-allemand, un personnage très cultivé. En France, le personnage de Maximilien Aue a fonctionné parce qu'il n'est pas que français: il est aussi et surtout allemand... Le lecteur français peut donc, comme dans un thriller ou un film d'horreur, jouir de toutes ces choses écœurantes et pornographiques que Littel raconte et, en même temps, rester à distance. En Allemagne, cette figure n'aurait absolument pas fonctionné, tout simplement parce que personne n'aurait été étonné qu'un intellectuel puisse être nazi.
Quelles sont vos références intellectuelles? Qui sont vos inspirateurs? Lisez-vous des auteurs français?
Je suis assez éclectique. D'abord, je m'inscris dans la tradition américaine de la psychologie sociale, incarnée par l'Ecole de Chicago: l'observation du quotidien. l'interview, la description des faits. En ce qui concerne mes influences théoriques, je vais les chercher dans l'Ecole critique de Francfort, fondée entre les deux guerres (Théodor Adorno, Herbert Marcuse...). A vrai dire, les intellectuels français n'exercent pas une grande influence sur moi. Bien sûr, j'ai lu Bourdieu, Roland Barthes et Michel Foucault mais c'est à peu près tout. Je n'ai pas lu Jacques Derrida ou Jean Baudrillard, par exemple. Je sais que je devrais le faire mais je crains que cela ne me nourrisse pas intellectuellement. Jacques Lacan non plus, je trouve la psychanalyse complètement ésotérique. Ce n'est pas mon monde, tout simplement.
Correspondez-vous régulièrement avec des chercheurs français?
En France, mon livre Les Exécuteurs, Des hommes normaux aux meurtriers de masse est paru en 2007 chez Gallimard [voir sous l'onglet Prolonger]. Il ne s'est pas beaucoup vendu, au contraire de l'Allemagne. J'ai eu quelques recensions dans la presse, des positives et des négatives. Je ne les ai même pas lues, je ne parle pas français... Aucun intellectuel français n'a essayé de me contacter pour en parler, pas un email, pas d'invitation, rien. «Zero». A vrai dire, je ne m'en étais même pas rendu compte avant que vous ne me posiez la question...
Les intellectuels français sont-ils encore influents en Allemagne?
La littérature et la philosophie française sont, je crois, assez connus en tout cas dans les cercles intéressés. Mais en ce qui concerne l'histoire et les sciences sociales, l'influence des chercheurs français est selon moi relativement limitée, à part bien sûr les ethnologues et Claude Lévi-Strauss. Les intellectuels des sciences sociales françaises me paraissent plutôt renfermés sur eux. Hermétiques. Plus qu'ici, en tout cas. Nous avons en général des relations beaucoup plus suivies et même intensives avec le monde intellectuel anglo-saxon. Les universitaires allemands font l'effort de publier en anglais, c'est beaucoup moins le cas des Français.
Votre dernier livre, Les Guerres climatiques, est paru en Allemagne il y a un an, et sera publié en France cet été [voir sous l'onglet Prolonger]. Vous insistez sur la crise actuelle de la démocratie et prônez l'urgence d'un nouveau modèle de société pour les sociétés occidentales...
Ce livre a suscité beaucoup de commentaires, avec des réactions très négatives et très positives. On m'a reproché d'être alarmiste. Je l'assume: c'est fait exprès! Je ne crois pas qu'il faille cacher la vérité aux gens, accompagner les mauvaises nouvelles de pommade. Le livre se vend bien, on m'appelle souvent pour le présenter. En général, on discute moins du constat que je dresse, c'est-à-dire la possibilité que le changement climatique entraîne un déchaînement de violence dans les décennies à venir, que des solutions possibles.
Ma thèse, c'est que notre modèle culturel a atteint ses limites. Le modèle industriel né en Europe a été un succès fou, mais aujourd'hui qu'il est globalisé, il est déjà mort. Avec la globalisation, il n'y a plus de mondes extérieurs dont on puisse exploiter les ressources. La crise économique que nous traversons n'est pas un accident, c'est une déflagration systémique, la manifestation que notre modèle de développement est en train de mourir. Je sens que les gens sont très inquiets de ce qui nous attend, qu'ils veulent du changement, mais qu'ils n'arrivent pas à l'articuler en un projet politique.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette inquiétude ne se traduit pas par des manifestations de mécontentement ou par plus de débats intellectuels. En Allemagne, c'est particulièrement frappant. Tout est si calme, comme si ce qui nous arrivait était une fatalité. Je crois que cela ne va pas durer. Cet état de calme actuel n'est qu'apparent. Il va se passer quelque chose. Cette inquiétude va selon moi trouver des moyens d'expression, qui pourront être violentes. Mais quoi? Difficile à dire...
Vous prophétisez la fin de notre modèle industriel ici, dans la ville d'Essen, au cœur même de la Ruhr, symbole même du miracle économique des Trente Glorieuses...
Nous sommes au cœur du problème. Cette région décline. Les politiques essaient de «culturaliser» ce déclin, ils ouvrent des centres d'art contemporain dans les usines et les mines désaffectées. Essen sera même capitale européenne de la culture en 2010. Il me semble pourtant que c'est d'ici que pourrait partir la grande transformation. Opel est en faillite? Reprenons tout du début. C'est pour l'heure complètement impensable mais ô combien nécessaire!
Iriez-vous dire cela aux salariés d'Opel qui ont peur de perdre leur emploi?
On peut aussi leur dire, aux salariés d'Opel, que leur problème n'est pas la chute des ventes de voiture. La cause de leurs ennuis, c'est que leurs dirigeants ont raté l'occasion de moderniser l'entreprise. Ils ont échoué à inventer d'autres formes de mobilité, à transformer leurs produits. Ils ont fait des voitures toujours plus grosses! Dans l'ancienne RDA socialiste, on fabriquait des produits factices. Ils n'étaient pas destinés à être vendus, ils servaient juste à faire tourner les usines. On les stockait. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec l'automobile. Bien sûr, si je vais dans une usine d'Opel en tenant ce genre de propos, au mieux, je prends des tomates sur la tête. Mais ce n'est pas mon problème. Faire en sorte de déplaire le moins possible pour ne pas prendre de tomates, c'est le problème des politiques. Moi, je suis scientifique, je dis ce que je pense.
Propos recueillis par Mathieu Magnaudeix, envoyé spécial à Essen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie)