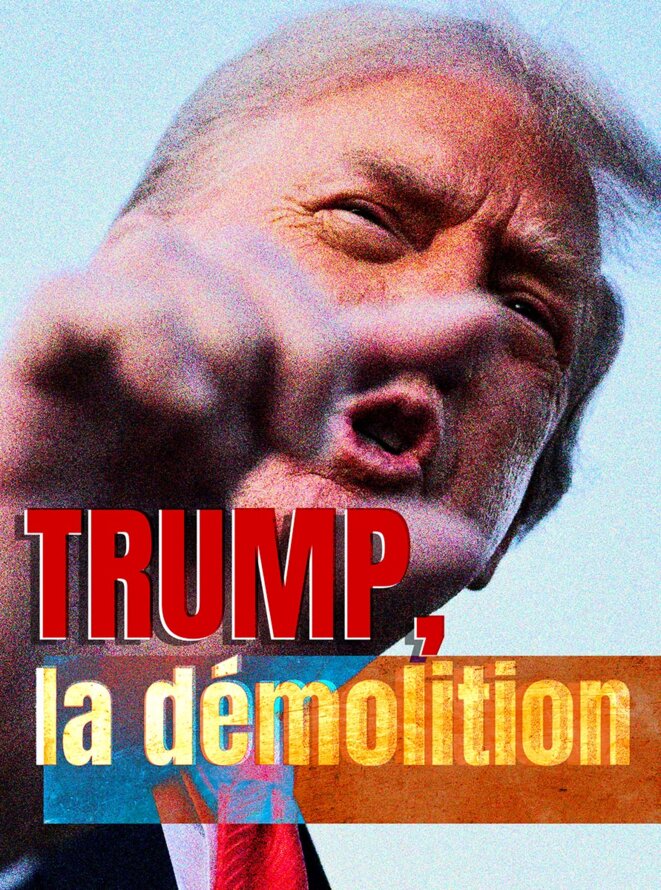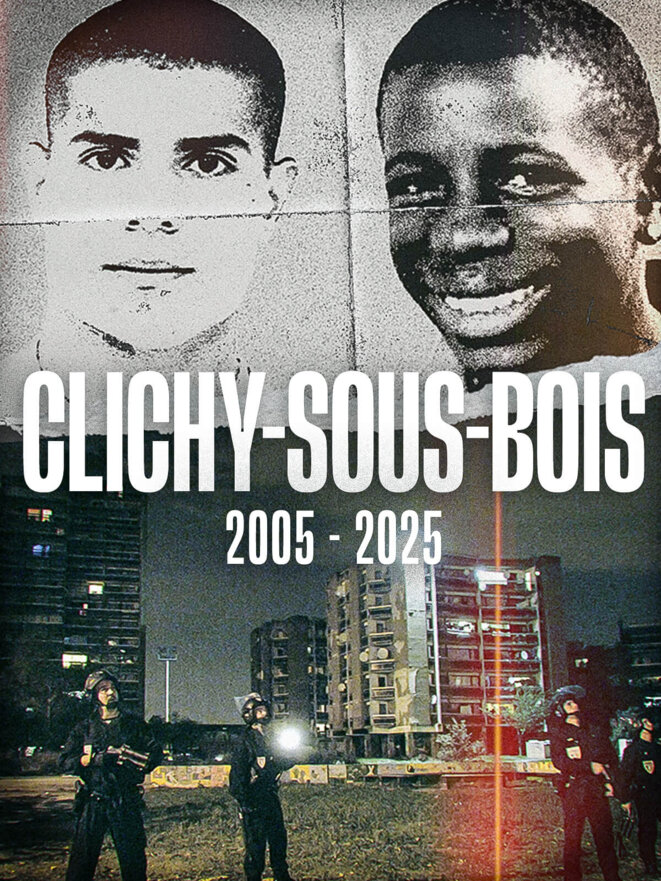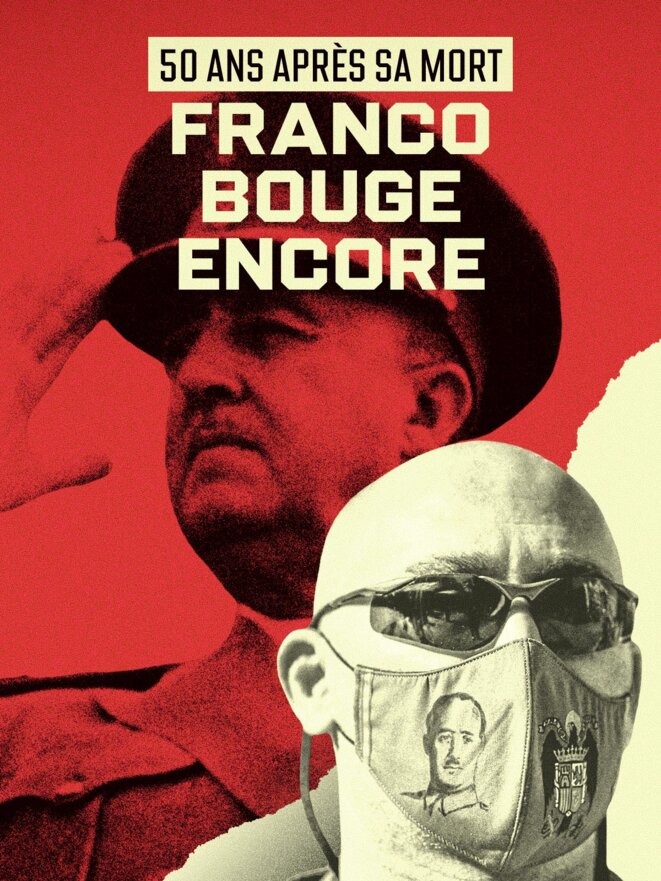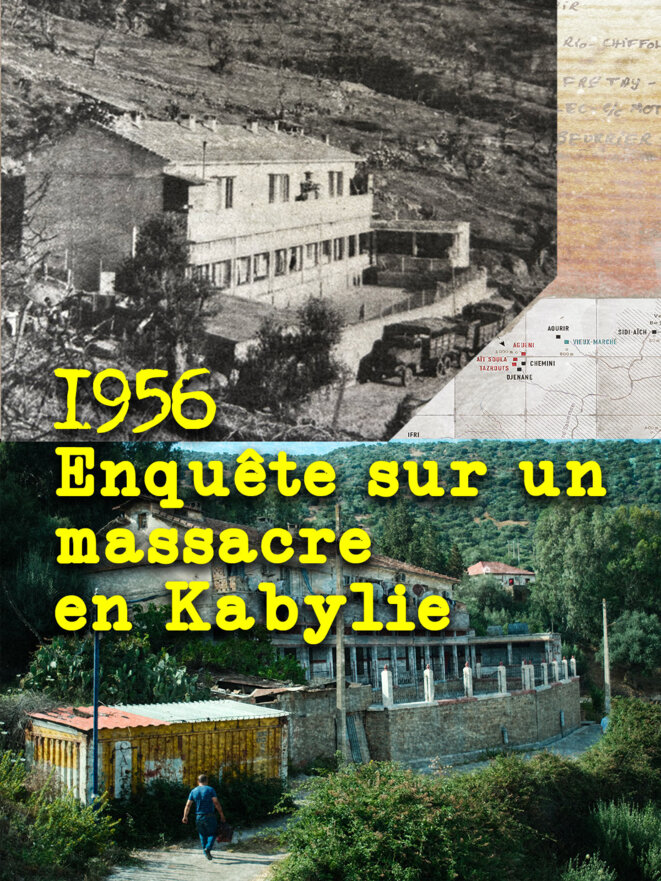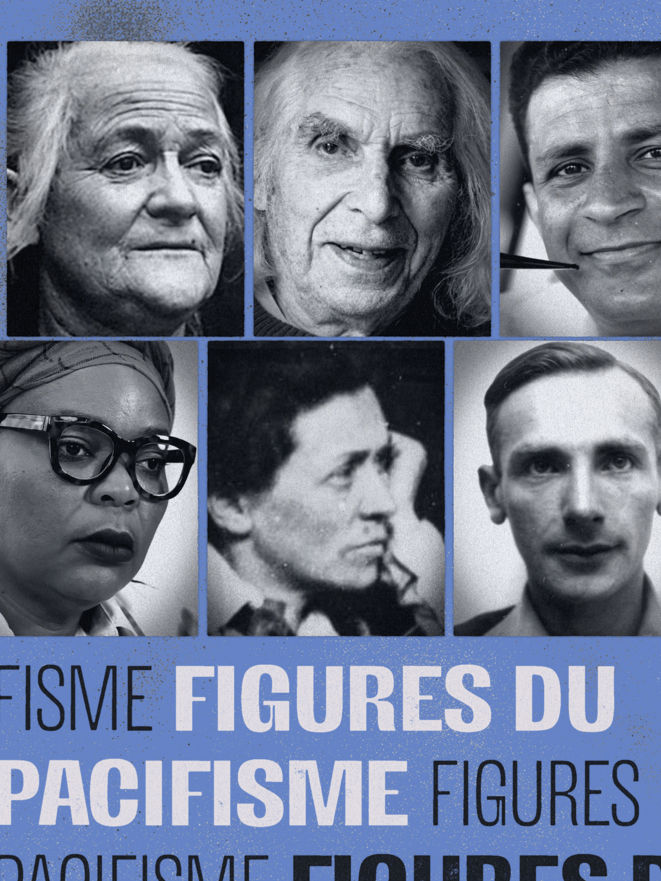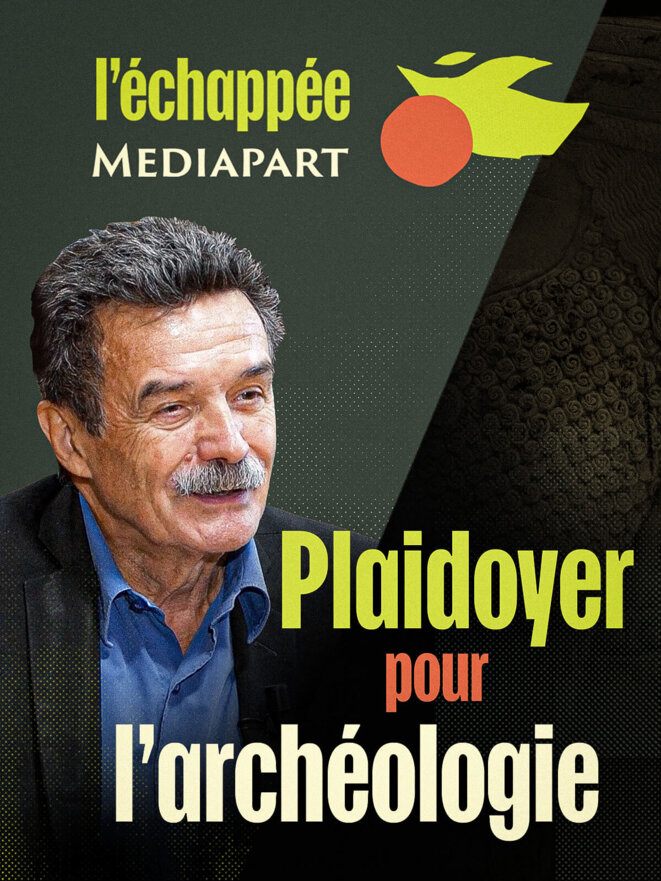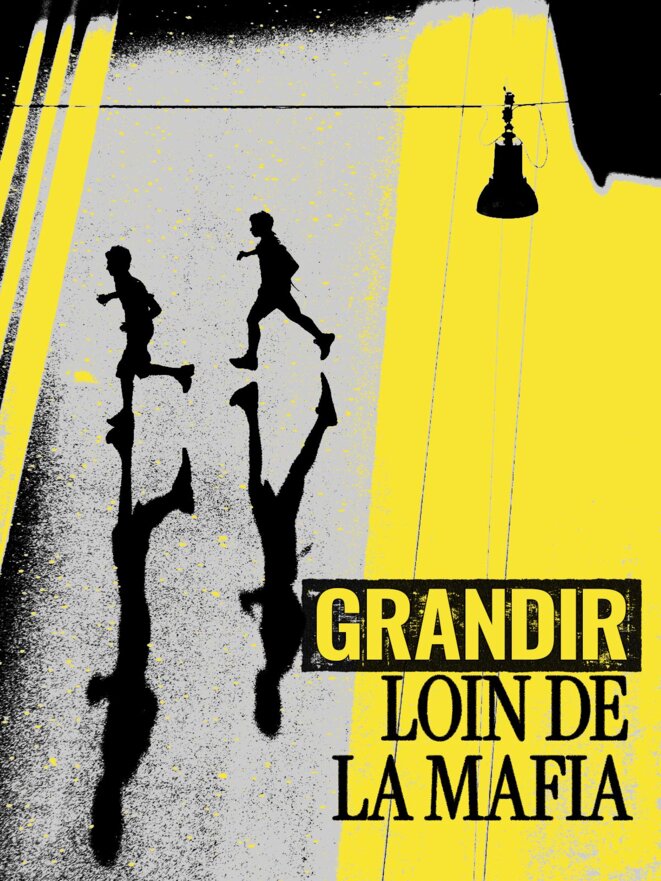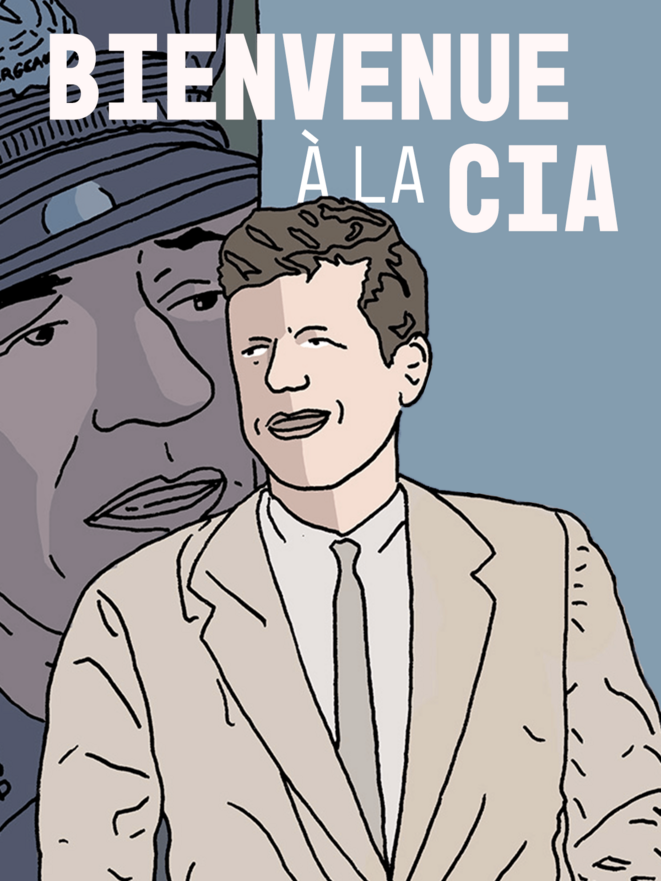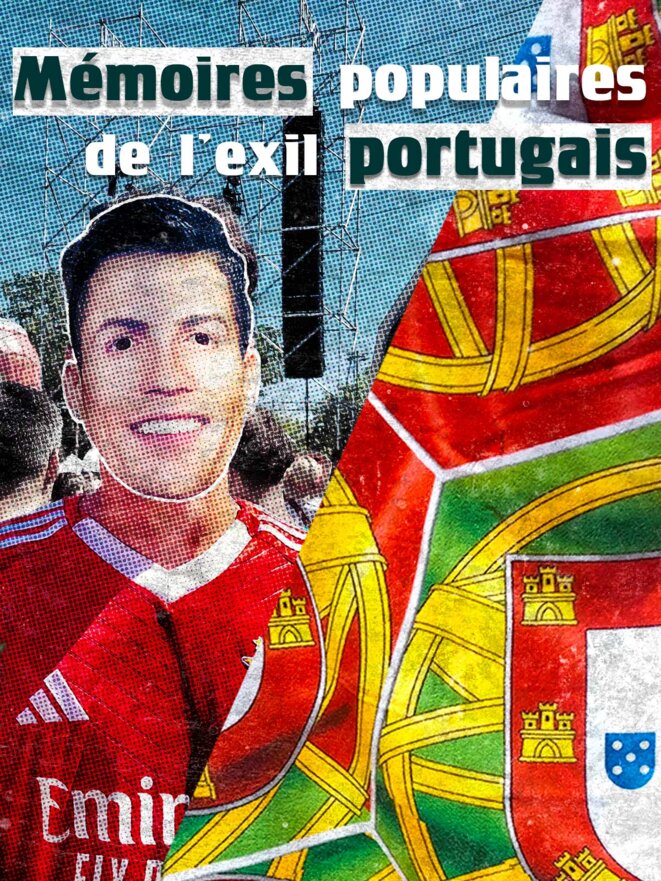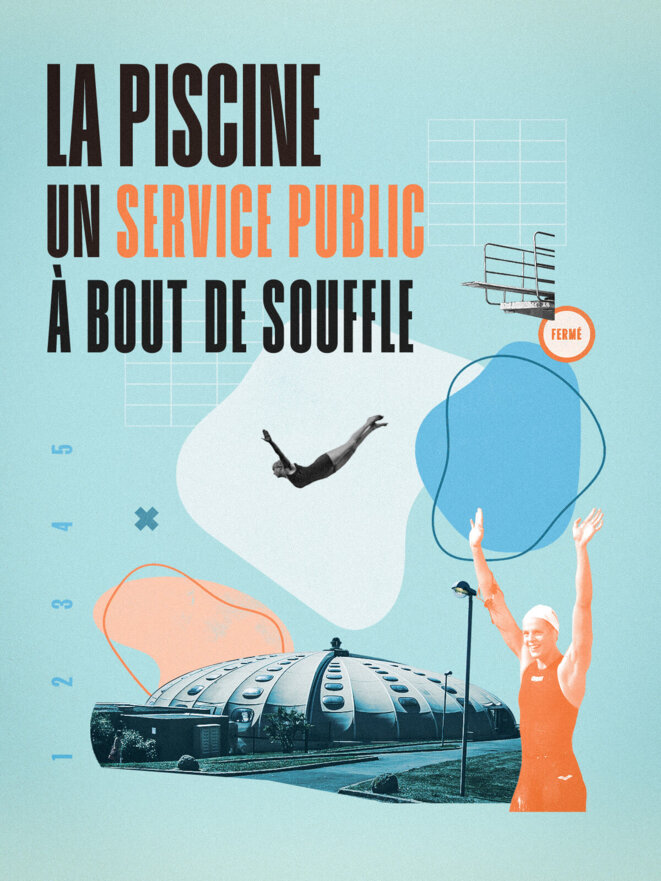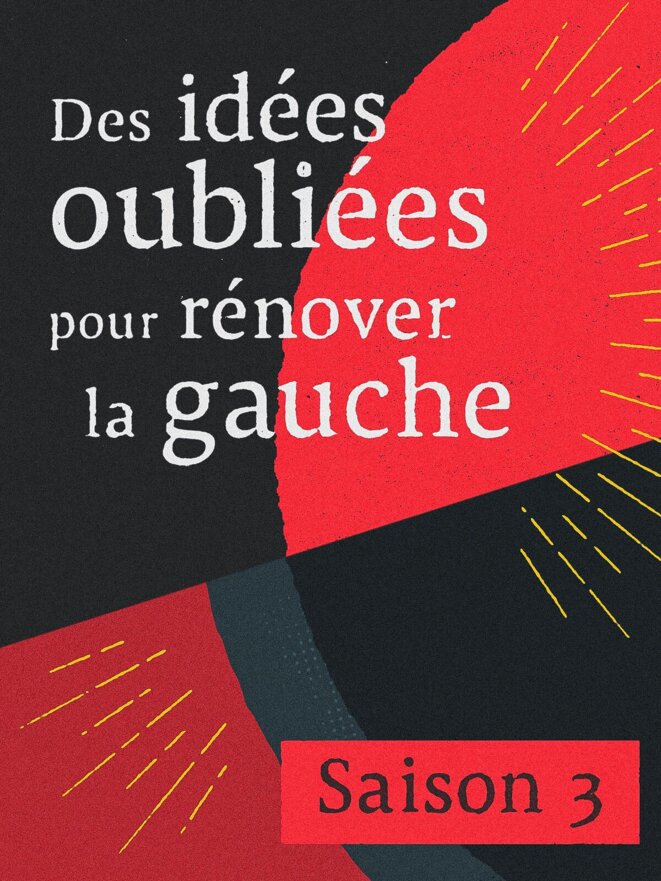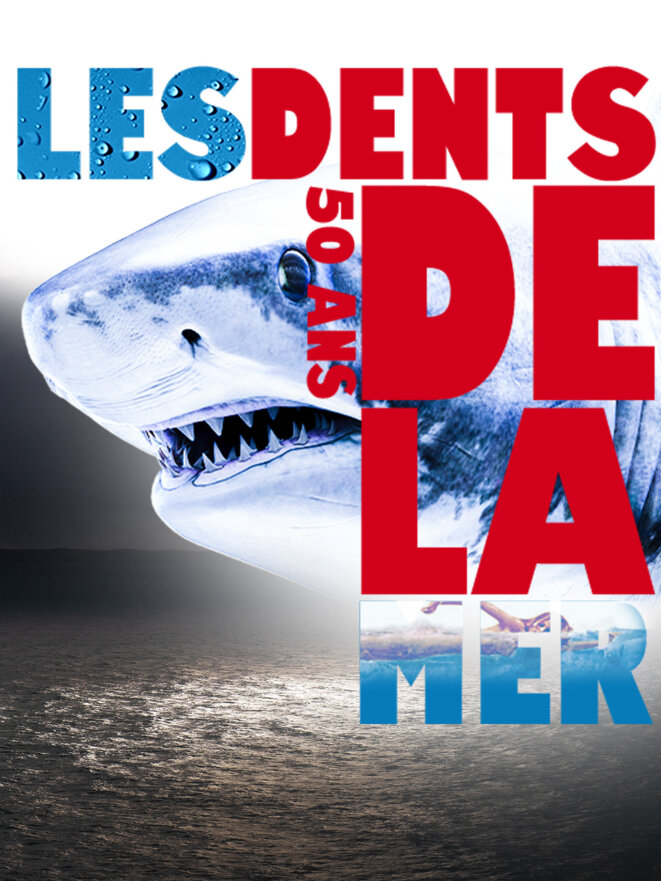Birgit Steuer n'ira pas travailler. Deux jours qu'elle est en grève. Dès huit heures du matin, elle et 2000 collègues ont investi la Hans-Böckler Platz, rendez-vous habituel des manifestations à Cologne. Il y a du café, et il est fort. On a apporté des pliants, et les crécelles pour faire du bruit. Birgit est nounou. Elle travaille dans un jardin d'enfants municipal. Comme elle, la plupart des employées des jardins d'enfants municipaux de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (nord-ouest) ont débrayé. A Cologne, à Dortmund, à Aix-la-Chapelle.
«Nous valons plus que ça», disent les banderoles. En 2007, les parlementaires de l'Etat régional (Land) de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont voté une loi qui encourage les parents à confier les moins de trois ans aux jardins d'enfants. «Depuis cette loi, c'est l'enfer», raconte Birgit. Les petits affluent, les meubles prévus pour des 3-6 ans ne sont pas adaptés. Les parents exigent toujours plus, des cours d'anglais ou des sessions de «baby-yoga», dit Birgit. Arrêts maladies en cascade. A la tribune, le porte-parole du syndicat des services Ver.di exige des postes, des moyens, plus de reconnaissance.

Agrandissement : Illustration 1

Manif des nounous de Cologne, 18 mai.
La mesure était pourtant louable : l'Etat régional (Land) de Rhénanie voulait développer la prise en charge des tout-petits pour permettre à leurs mères de travailler. Actuellement, seuls 7% des moins de trois ans du Land sont pris en charge par des jardins d'enfants publics ou privés, financés par des églises ou des associations de parents — le taux est plus élevé à l'Est, un héritage de la RDA socialiste. Les autres sont gardés par leurs mères, ou confiés à des nourrices privées. Ici, l'école maternelle n'existe pas. A chacun de se débrouiller. A chacune, plutôt : en Allemagne, l'éducation des enfants reste l'affaire des femmes.
Les racines du modèle patriarcal sont anciennes. Le réformateur protestant Luther voulait des épouses toutes dévouées à leur foyer, comme des nonnes à Dieu, explique l'historienne Barbara Vinken dans un ouvrage sur la figure tutélaire de la mère allemande. Plus tard, philosophes et pédagogues ont sanctifié la femme discrète, pieuse et mère irréprochable. Jusqu'à l'apogée nazi : le régime d'Hitler s'est évertué à transformer la femme en machine à enfanter au service du Reich.
La mère cantonnée au foyer

Agrandissement : Illustration 2

Ce passé a laissé des traces. Birgit Steuer, la nounou (photo), a été élevée dans une famille typique de l'après-guerre. Maman à la maison, papa seul pourvoyeur des besoins du foyer. «Ma mère n'a jamais été indépendante, dit-elle. Tous les mois, mon père lui donnait son argent de poche. Pour elle, pour les courses et pour les enfants.» Les femmes allemandes ont obtenu le droit de vote trente et un ans avant les Françaises, en 1919, à la faveur de la parenthèse démocratique de la République de Weimar. Mais jusqu'en 1977, le code civil s'est entêté à leur attribuer comme première mission de faire chauffer les fourneaux et d'élever la progéniture, rappellent les universitaires français Antoine Math et Jeanne Fagnani.
Birgit s'est érigée contre ce modèle conservateur, les «trois K» comme elle dit («Kinder, Küche, Kirche» – les enfants, la cuisine, l'église). Mariée, deux enfants, elle a osé travailler à temps plein. Son mari n'était pas d'accord. Elle a divorcé. Pourtant, Birgit n'est pas dupe : elle reste marquée par son éducation, la prétendue asymétrie des sexes et cette culpabilité qui, dit-elle, obsède toute mère allemande. «J'éprouverai toujours du stress, toujours le souci de bien-faire, comme si c'était à la mère seule de s'inquiéter pour les enfants. J'ai beau être féministe, j'ai été éduquée avec cette idée que l'homme vaut plus que la femme.» Parfois, sa fille lui quémande des compliments alors que Birgit félicite son garçon pour un rien. Elle essaie de faire attention. Elle n'y arrive pas toujours.
Alice Schwarzer connaît cette ritournelle par cœur. "Frau" Schwarzer reste le phare incontesté du féminisme allemand. Simone de Beauvoir a été son amie. Elle a été une des pionnières du MLF en France, a conduit le combat pour la dépénalisation de l'avortement en Allemagne. A 66 ans, elle reste une avocate acharnée de l'égalité. On la voit souvent à la télé. Elle a l'oreille de la chancelière Angela Merkel, première femme élue à la tête du pays dont elle a applaudi la victoire en 2005. Rédactrice en chef du magazine féministe Emma, elle reçoit dans une tour du XIIIe siècle : dans ce donjon construit pour défendre Cologne, elle a installé un centre de documentation sur le combat des femmes pour leur émancipation. Selon la féministe, les stigmates du nazisme n'ont pas encore disparu. «La figure de la mère écrase encore nos concitoyennes, dit-elle. Les femmes veulent égaler les hommes au travail, puisqu'on leur a raconté qu'une femme moderne est attirante, aimée, et aussi un peu sainte... et elles veulent en même temps être mères à 100%! Bien sûr, c'est très difficile à concilier.» [Cliquer ici pour l'intégralité de l'entretien avec Alice Schwarzer]
Condamnées au temps partiel
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Même si la Loi fondamentale de 1949, constitution de la République fédérale dont l'Allemagne célèbre cette année le 60e anniversaire, stipule l'égalité entre les hommes et les femmes, elle n'est toujours pas une réalité. Une Allemande gagne en moyenne 24% de moins qu'un homme, et l'écart n'a pas évolué depuis 15 ans selon l'institut de la statistique – d'après Eurostat, l'Allemagne est presque lanterne rouge européenne en la matière, seule l'Estonie fait pire. Près de 60% des femmes travaillent – c'est beaucoup –, mais près d'une sur deux exerce à temps partiel. «En politique, dans l'économie, dans les universités, le pourcentage de femmes diminue à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie», constate la Hans-Böckler Stiftung, une institution proche des syndicats. Malgré les quotas instaurés par certains partis politiques (les sociaux-démocrates et les Verts). Malgré les postes créés dans les entreprises, les municipalités et les universités pour favoriser l'égalité.

Agrandissement : Illustration 3

«Salaire égal pour les femmes» : le parti Die Linke (gauche) a fait de l'égalité salariale entre hommes et femmes un thème de campagne pour les européennes.
La répartition sexuelle des métiers reste une réalité. Ceux de coiffeurs, vendeurs, infirmiers et nourrices vont presque tous à des femmes. Pas une ne dirige un grand groupe coté à la bourse de Francfort. Idem à l'autre bout de l'échelle sociale, dans les Aldi, Lidl, Kik ou Schlecker, les grandes enseignes discount. «Les caissières, les simples employés sont presque uniquement des femmes. Les directeurs locaux presque tous des hommes», résume Birgit Döring, secrétaire pour Cologne de la section commerce du syndicat Ver.di.
La longueur des études (souvent au-delà de 30 ans) empêche les plus qualifiées de faire des enfants. Et le manque dramatique d'infrastructures de garde d'enfant, qui ferment en milieu d'après-midi quand elles existent, condamne les mères célibataires au temps partiel. «Je connais des tas de femmes qui élèvent leur enfant seules et vont travailler après l'avoir couché, poursuit l'énergique Döring. Elles sont bien sûr à bout. Il leur faut un véritable talent d'organisation.» «La situation des femmes élevant seules leurs enfants ne cesse de se compliquer, confirme Kathrin Göring-Eckardt, vice-présidente (Verts, opposition) du Bundestag, la chambre basse du Parlement. Elles sont les plus menacées et les plus touchées par la pauvreté.»
Qu'elle soit caissière ou banquière, l'emploi du temps d'une maman en Allemagne relève souvent du parcours d'obstacles. Mère (française) d'une petite Lucie qui vient de souffler ses trois bougies, Marlène Guitard, 33 ans, vit à Cologne-Raderthal. C'est à la sortie de la ville, ça ressemble à la forêt. Lotissement bon chic bon genre : des médecins, des ingénieurs, des avocats. Le quartier a été construit pour l'armée d'occupation britannique.
La semaine, son mari Christian (allemand, ingénieur télécom), parcourt l'Europe. Juriste dans une fédération professionnelle, Marlène détaille un agenda minuté au chronomètre. Le lundi et le mardi, elle amène Lucie dans un «groupe de jeu» à 9 heures, vient la prendre à 13 heures. Les autres jours, il faut venir chercher Lucie à 16h30. Marlène ne travaille qu'à 80%. «Je dois anticiper tous mes déplacements professionnels. Un après-midi, je n'étais pas à Cologne, Christian non plus. Il a dû rentrer de Bruxelles pour aller chercher Lucie et la ramener le lendemain matin, puis il est illico reparti en Belgique.»
Une démographie souffreteuse

Agrandissement : Illustration 4

Marlène Guittard travaille à 80% pour s'occuper de Lucie, 3 ans.
«Être une mère à plein temps est devenu un passe-temps pour les gens aisés», déplore Dorothéa Böhm. Médecin à Bielefeld, au nord-ouest de Cologne, elle milite comme les autres membres du Réseau Famille (Familiennetzwerk) pour la reconnaissance de la maternité à temps plein comme activité professionnelle. Selon elle, la durée maximale du congé parental (trois ans) est bien trop courte. «Mère, c'est peut-être le plus important des métiers», poursuit le docteur Böhm. D'après elle, la nature ordonne aux femmes de tout donner à ses enfants : «Je crois à la sagesse de l'évolution biologique naturelle. Je crois au pouvoir de l'amour, et l'amour entre une mère et son bébé est une des plus merveilleuses, une des plus importantes formes d'amour.»
Ces propos consternent Jutta Hoffritz. «Ils reflètent encore l'opinion de nombreux compatriotes», se lamente cette journaliste de l'hebdo de l'intelligentsia, Die Zeit, auteur d'un essai au vitriol sur la mère allemande [voir sous l'onglet Prolonger]. Digne héritière de Frau Schwarzer, Hoffritz prône la révolte contre les remparts mentaux qui emmurent les femmes. Pour elle, l'Allemagne ne sait voir dans les mères qu'«Übermütter» ou «Rabenmütter» : soit «hypermères» omniprésentes, soit «mamans-corbeaux» accusées de délaisser leur progéniture pour faire carrière. Poules et corbeaux se déchirent depuis des lustres : dans les médias, le débat sur la petite enfance et l'opportunité de mettre les tout-petits à la crèche est un thème récurrent. D'après l'hebdomadaire Der Spiegel, il aurait même viré à la «guerre de religion».
S'ils continuent à crier fort, les tradis comme le docteur Böhm semblent pourtant en train de perdre la partie. L'Allemagne commence en effet à s'inquiéter sérieusement pour son avenir. A raison : avec 1,3 enfant par femme (contre 2% en France), le pays affiche un des plus faibles taux de natalité de l'OCDE. D'après l'économiste Alex Plünnecke de l'Institut de l'économie allemande (IW) de Cologne, cette «grève des ventres» pourrait coûter très cher au pays : «Si la démographie reste aussi atone, la France pourrait dépasser l'Allemagne dans les années 2030 en terme de PIB par habitant», prophétise-t-il. En 2007, ses analyses publiées dans le journal conservateur Die Welt ont provoqué un électrochoc. D'autant que des études de l'OCDE ont contribué à pointer les faiblesses alarmantes du système éducatif, longtemps considéré comme un modèle. «Les entreprises craignent de ne plus avoir assez de main-d'œuvre qualifiée à l'avenir, et un enfant sur trois est aujourd'hui originaire de l'immigration. Investir dans les infrastructures scolaires devient donc urgent», affirme Plünnecke, partisan d'une scolarisation précoce des enfants.
Ursula von der Leyen, la ministre de la famille aux sept enfants, a suivi le conseil du chercheur, auteur d'études pour le compte du gouvernement. Pour favoriser la natalité, le nombre de places en crèche doit être triplé d'ici 2013. Malgré les contestations dans son propre camp (la CDU chrétienne-démocrate, le parti de Merkel), von der Leyen a instauré l'«Elterngeld», un congé parental importé de Suède. Il permet aux deux parents de prendre en charge à tour de rôle le nouveau-né, et d'éviter que la maternité ne signe l'arrêt de mort professionnelle des femmes. D'après le chercheur Plünnecke, les tout premiers résultats montrent une progression frémissante de la natalité dans les villes et une plus grande implication des papas. La ministre réfléchit à une éventuelle extension. «Parmi les plus jeunes, l'égalité entre les hommes et les femmes est une évidence, le nombre de pères engagés ne va donc cesser d'augmenter», veut croire la députée des Verts, Goering-Eckardt. A Cologne, du haut de sa tour, la féministe Schwarzer nuance : «Oui, l'Allemagne est en train de changer. Mais le chemin sera très long.»
Lire aussi notre entretien avec la féministe Alice Schwarzer, avocate depuis trente ans de l'égalité homme-femmes en Allemagne.
Texte et photos : Mathieu Magnaudeix, envoyé spécial à Cologne.