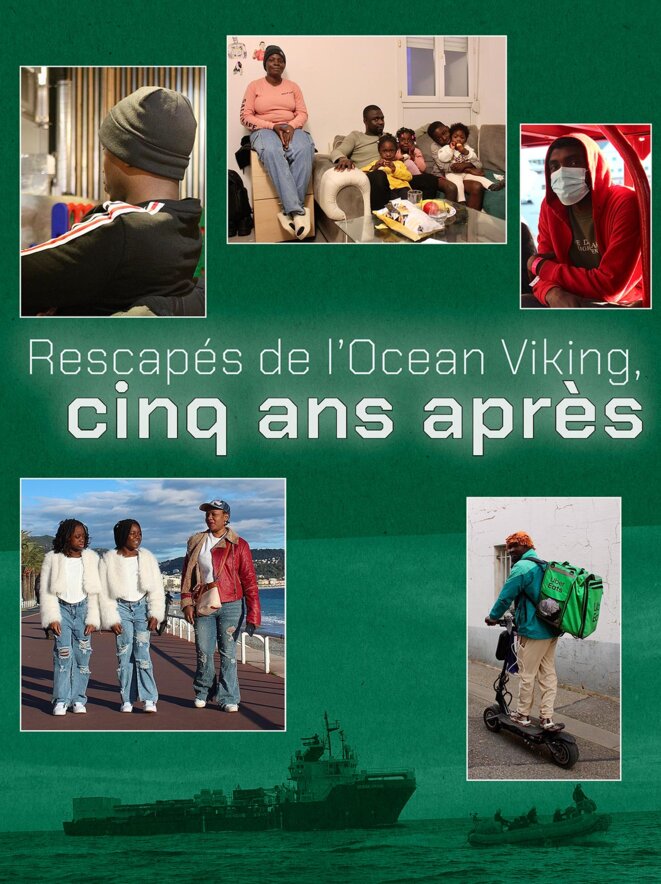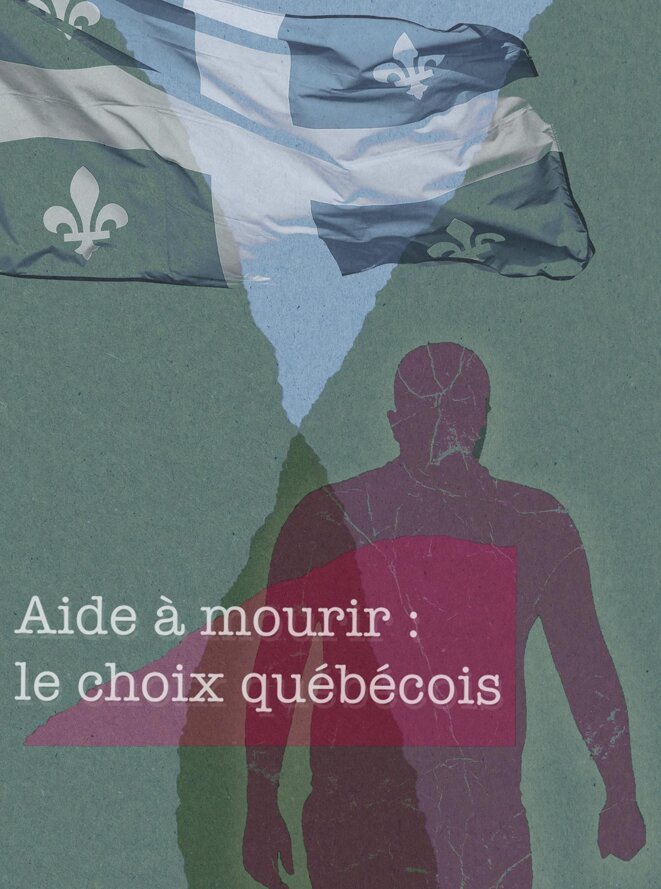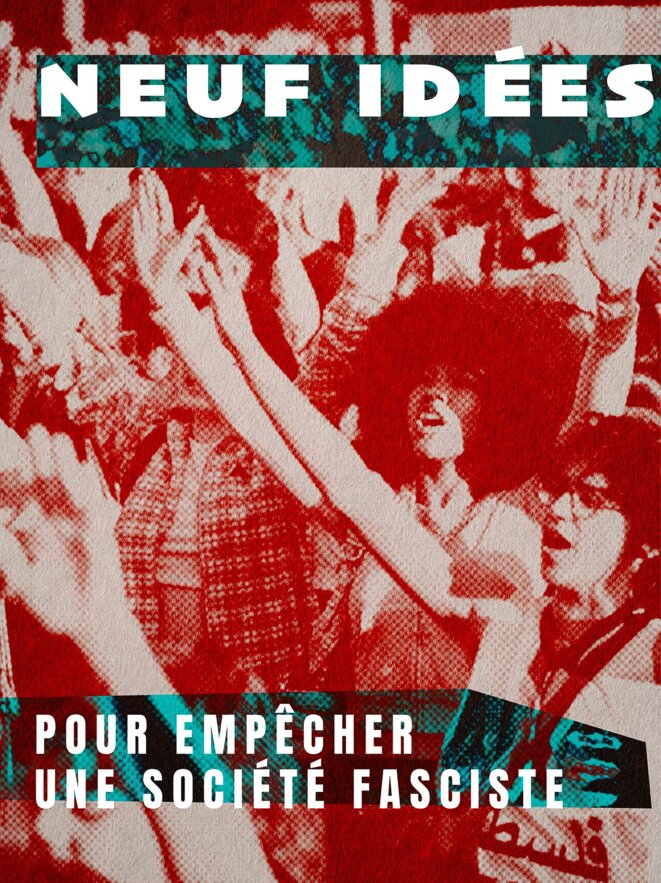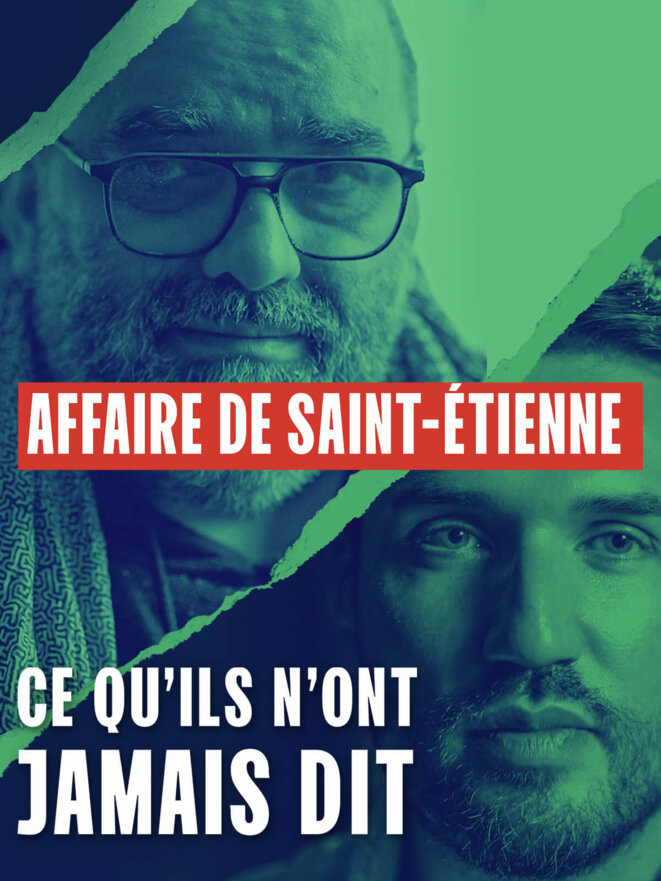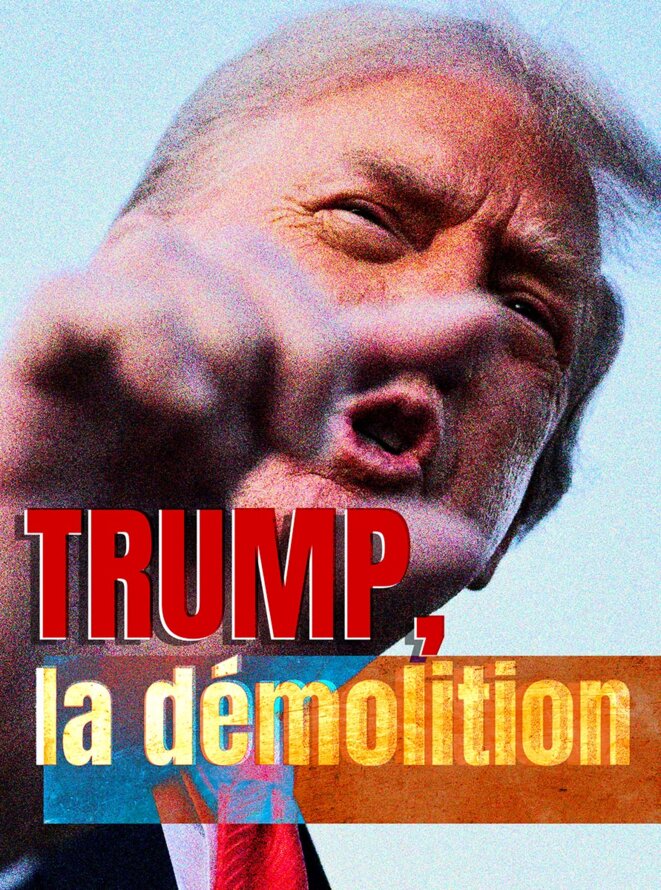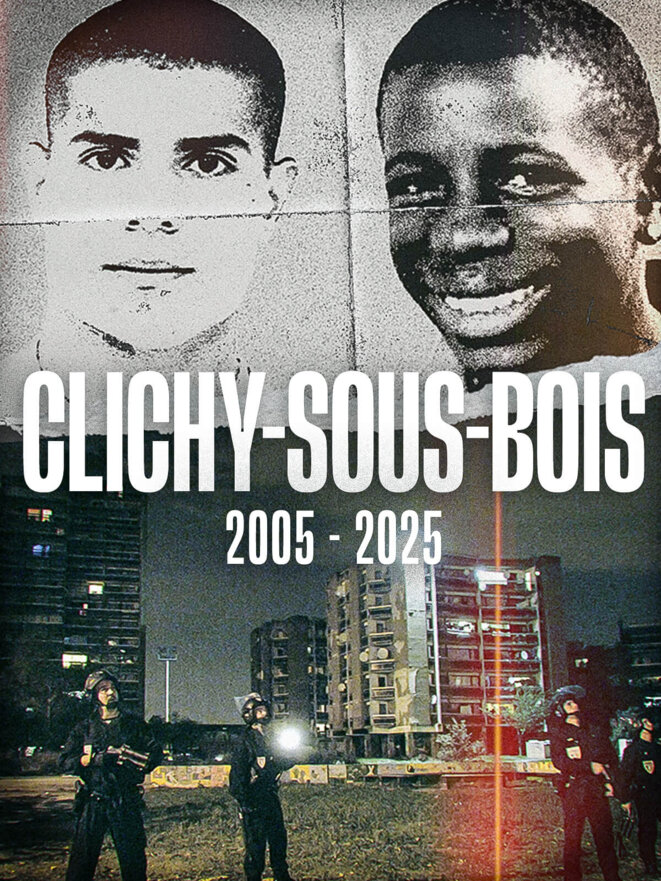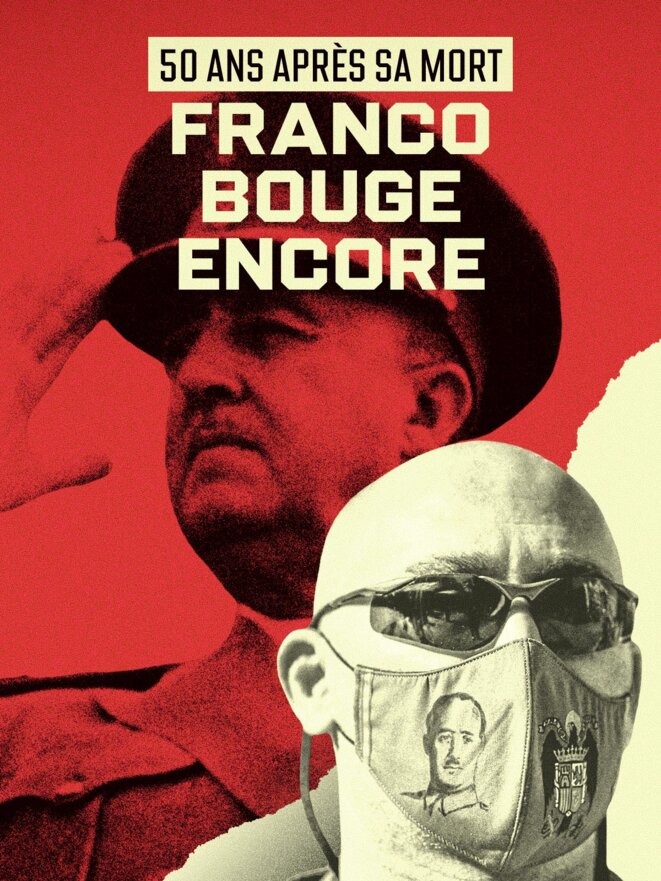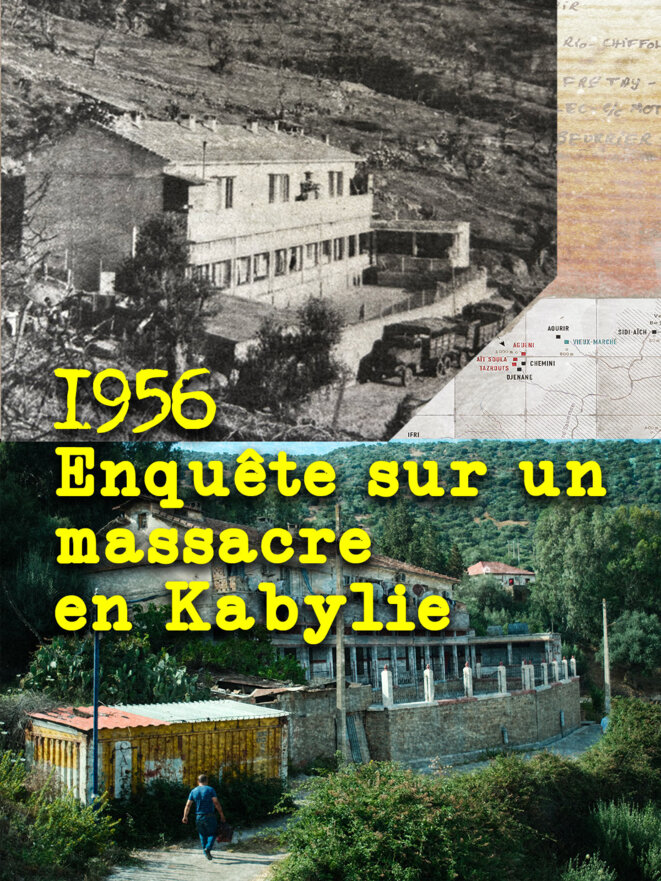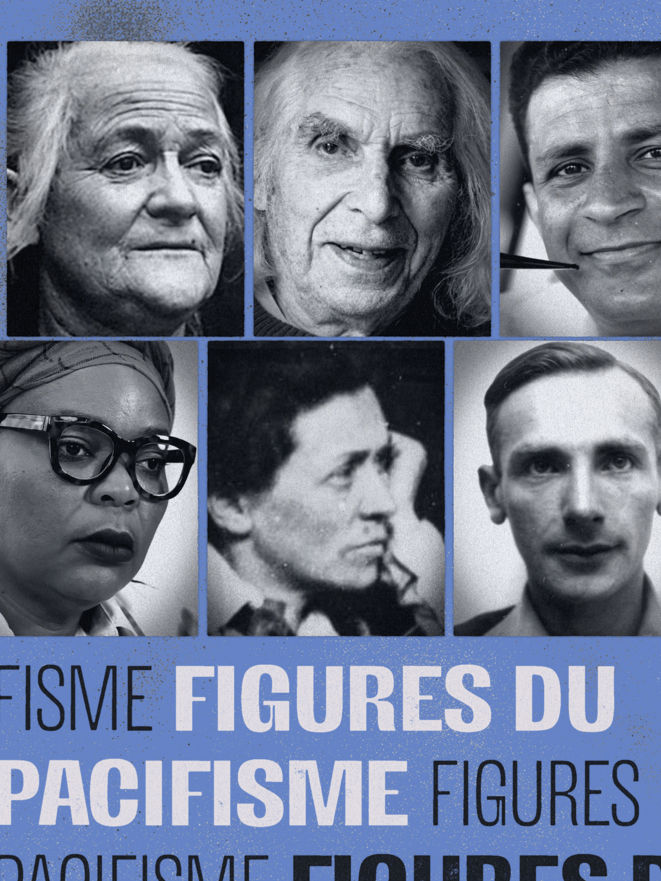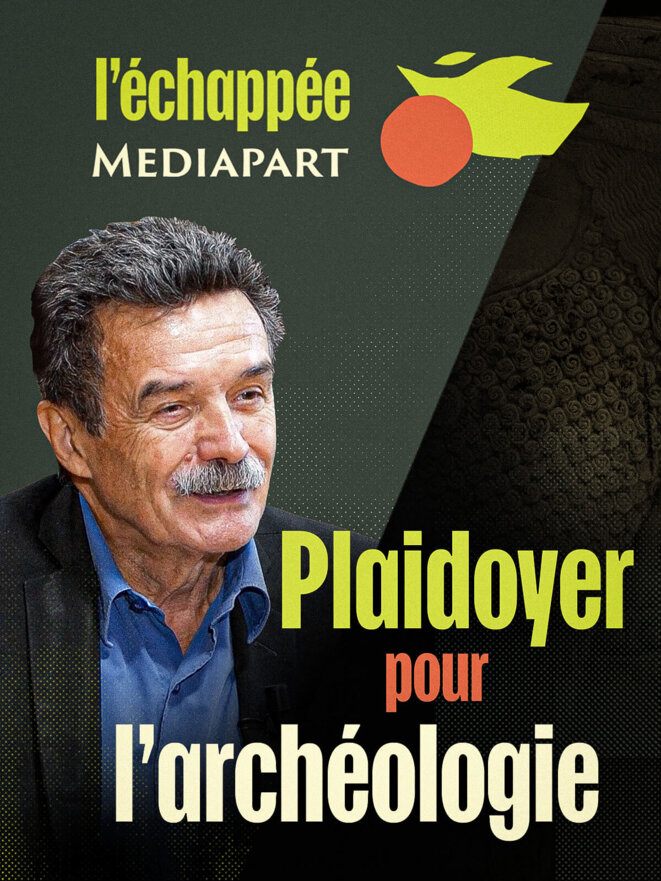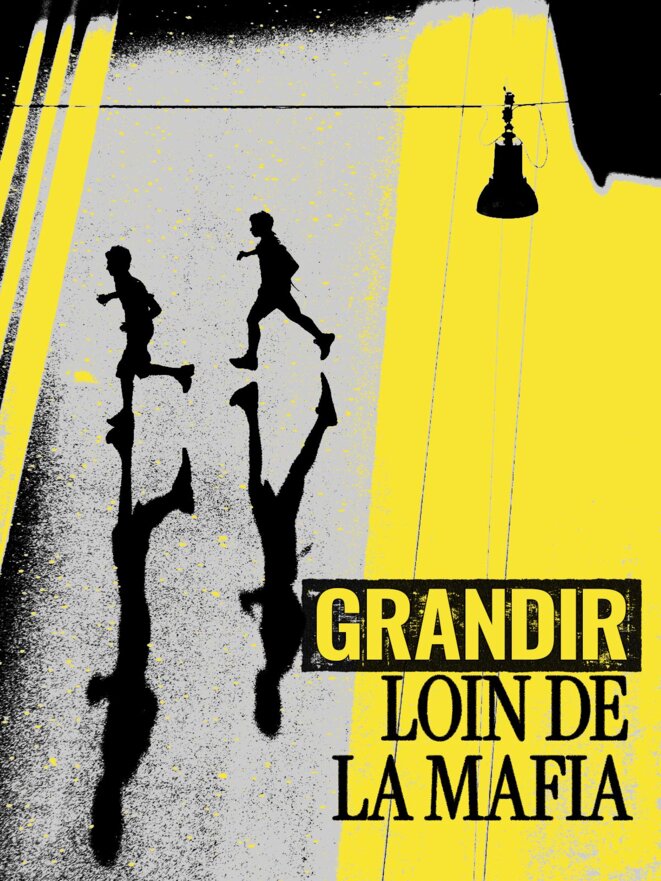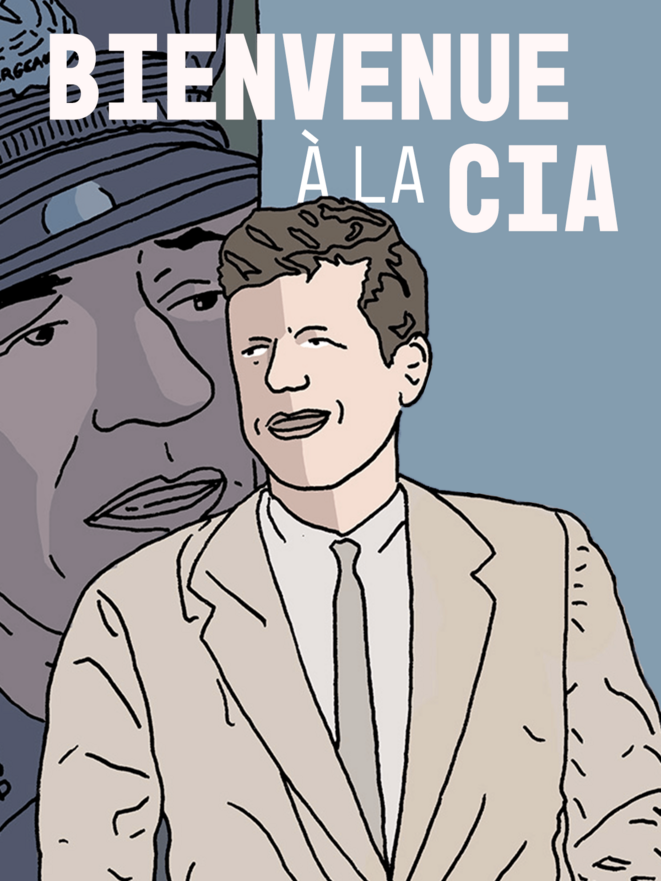À la suite de la révolution qui a abouti au départ de Ben Ali, environ 40 000 Tunisiens ont tenté de rejoindre l’Europe en traversant la Méditerranée. Selon les estimations du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), au moins 1 500 personnes sont mortes aux portes de l’Union européenne en 2011, faisant de cette mer un cimetière migratoire. Des Tunisiens, mais également des ressortissants d’Afrique sub-saharienne fuyant la Libye en guerre y ont trouvé la mort.
Des mères de migrants tunisiens se mobilisent depuis un an pour obtenir, auprès des autorités de leur pays et du gouvernement italien, des informations sur leurs fils disparus. En vie ou mort, elles veulent savoir. Sit-in, manifestations : elles multiplient les actions. L'une d'entre elles a récemment été hospitalisée après s'être immolée par le feu.

Tout en exprimant leur douleur, ces femmes dénoncent les politiques migratoires européennes. Leur mouvement s’inscrit dans une histoire des luttes rappelant celle des mères argentines de la place de Mai. Entretien avec la philosophe italienne Federica Sossi, professeur à l’université de Bergame en Italie, féministe et militante engagée auprès de ces mères. Elle anime le site Storie migranti où sont rassemblés en plusieurs langues des récits de migrants.
Quelle est la genèse de la mobilisation des mères tunisiennes à la recherche de leurs fils disparus ?

Les mères et les familles ont commencé à s’organiser quand elles n’ont plus eu de nouvelles de leurs fils. Depuis mai 2011, elles font plusieurs fois par semaine des sit-in et des manifestations à Tunis. Elles brandissent les photos de leurs enfants et demandent à être reçues par les autorités. Des actions sont aussi organisées à Sfax et dans plusieurs villes en Italie. Ces femmes viennent des périphéries pauvres de Tunis, de Sfax et de l’intérieur du pays. Elles n’ont jamais cessé de se mobiliser. À tour de rôle, par groupe de 5 à 30, elles se rendent avenue Bourguiba ou devant les ministères de la capitale tunisienne, surtout le ministère des affaires sociales où se trouve le secrétariat général à l’immigration.
Que demandent-elles ?
Leurs fils ont quitté la Tunisie juste après la révolution. Elles veulent savoir ce qu’ils sont devenus. Entre 300 et 350 personnes sont portées disparues, c’est-à-dire que leurs corps n’ont pas été récupérés et qu’on n’a pas retrouvé la trace de leurs embarcations. Six bateaux, partis les 1er, 14 et 29 mars, ainsi que le 29 avril (deux bateaux) et le 5 mai 2011, sont concernés. Il est possible qu’ils aient fait naufrage et qu’il n’y ait pas de survivants, mais il est aussi possible que certains soient arrivés puis enfermés dans des centres de rétention. Les mères veulent croire qu’ils sont vivants, d’autant que quelques-unes disent les reconnaître sur des vidéos tournées en Italie sur l’île de Lampedusa et à Manduria, dans les Pouilles.
Comment les avez-vous rencontrées ?
Je fais partie d’un groupe de féministes italiennes qui s’appelle 25-11, en référence à la date d’une action que nous avons menée en 2009 pour soutenir une femme nigérienne détenue dans le centre de rétention de Milan. Cette femme avait dénoncé les tentatives de viol de la part du chef de police de ce centre. Nous avions déployé une banderole où nous avions écrit : « Dans les centres de rétention, la police viole les femmes ». La réponse de la police, pour enlever cette inscription, a été de nous frapper.
En juin, août et septembre 2011, plusieurs d’entre nous sommes allées en Tunisie. Nous avons rencontré les familles à la Ligue des droits de l’homme, à Tunis. On a compris qu’elles se connaissaient et qu’elles avaient déjà organisé des sit-in et des manifestations, mais que l’ex-gouvernement provisoire ne s’intéressait pas à elles. Dès septembre, elles avaient rédigé une liste avec les noms des disparus.
Pour que les choses bougent, ces femmes devaient se faire entendre au-delà de la Tunisie. Pour cela, il fallait interpeller les autorités italiennes et européennes, c’est-à-dire les États responsables de cette politique de contrôle des migrations qui fait disparaître, efface les personnes qui traversent leurs frontières. Depuis dix ans, la Méditerranée est devenue un cimetière marin.

Agrandissement : Illustration 4

Quelles actions en commun avez-vous mené ?
En octobre 2011, nous avons lancé une campagne en Tunisie et en Italie que nous avons appelée « D’une rive à l’autre : des vies qui comptent », pour faire savoir que si les vies des migrants ne comptent pas pour les responsables politiques, elles comptent pour nous et pour les familles.
Nous avons écrit à l’ensemble des ministres tunisiens et italiens concernés, publié un appel et organisé des actions au théâtre de Milan. Les jeunes arrivant en Europe «brûlent» les frontières. D’une certaine manière, ils unifient les rives, l’espace européen et africain. De part et d’autre, nous contestons la politique de séparation des espaces voulue par les États membres de l’Union européenne.
Pendant des mois, personne ne nous a répondu. Le 30 mars 2012, nous avons réitéré en faisant des manifestations ensemble. Un rassemblement a eu lieu devant l’ambassade tunisienne à Rome. Les mères se sont, elles, réunies devant l’ambassade italienne à Tunis. Elles ont été créatives et radicales : elles ont presque pris d’assaut avec leur corps et leurs cris l’ambassade italienne qui était fermée à ce moment-là.
Que peuvent faire les autorités tunisiennes et italiennes pour retrouver la trace de ces bateaux fantômes et de leurs passagers ?
Beaucoup de choses. Les mères ont besoin de clarté et de transparence. Elles ont le droit de savoir. Les institutions ne doivent pas être silencieuses face à leur douleur. Or, en ne répondant pas ou en délivrant les informations par bribes, elles sèment la confusion. Nous avons d’abord demandé au gouvernement tunisien d’envoyer à Rome les empreintes digitales des Tunisiens disparus. Ce type de procédure est très rapide quand il s’agit d’expulser des sans-papiers. Après plusieurs mois, les empreintes ont finalement été transmises et la comparaison a pu être faite. Mais l’Italie a refusé de nous délivrer les résultats, disant que c’était aux Tunisiens de le faire.
À Tunis, aucune communication officielle n’a été organisée. À force d’acharnement, quelques familles ont reçu une réponse négative, c’est-à-dire que les empreintes ne coïncident pas avec celles recueillies en Italie. Le problème, c’est qu’on ne sait pas exactement quelles empreintes ont été envoyées. En plus, les autorités italiennes reconnaissent elles-mêmes qu’elles ont été débordées lors des premières arrivées et qu’elles n’ont pas eu le temps de collecter toutes les empreintes. Donc les mères doutent encore.
Une commission d’enquête aurait dû être lancée immédiatement. Les empreintes auraient pu être vérifiées tout de suite. Pour savoir si les bateaux étaient bel et bien arrivés à destination, il aurait fallu accéder aux archives de la gare côtière et de la questure italienne. On nous a refusé ces informations, seuls les fonctionnaires d’État étant autorisés à les obtenir. La compagnie de téléphone utilisée par les migrants aurait dû être sollicitée pour localiser les derniers appels émis. On aurait pu faire un tour des centres de rétention : les familles veulent voir de leurs yeux. Une commission aurait pu expertiser les vidéos pour identifier les personnes présentes sur les images. Rien de tout cela n’a été fait. Il est encore temps, même si c’est tard.
Est-ce que le réflexe de n’importe quel migrant n’est pas de prévenir sa famille à son arrivée ? En refusant de délivrer les informations dont elles disposent, les autorités italiennes et tunisiennes n’empêchent-elles pas les mères de faire leur deuil ?
C’est ce que je pense. On a l’impression d’une folie migratoire des États qui concentrent leurs moyens techniques pour contrôler, expulser et faire disparaître les personnes. En revanche, ils ne font rien pour répondre à la douleur. Effectivement, en général, les migrants appellent leurs familles restées au pays. Selon la loi italienne, quand ils sont enfermés en centre de rétention, ils ont la possibilité d’appeler, sauf en cas de révolte comme cela a été le cas à Milan, les portables ont été confisqués. Il est probable que plus aucun d’entre eux ne soit aujourd’hui en rétention, s’ils y ont jamais été. Mais comme des mères croient les voir sur des vidéos, elles gardent espoir.

Des familles ont-elles mené leur propre enquête ?
Les familles concernées sont pauvres, elles n’ont pas la possibilité de faire d’enquêtes individuelles, les visas auraient été refusés. Mais une délégation de familles est venue en Italie début janvier. Elle est allée à Palerme, puis à Rome. Des avocats italiens ont été mis à leur disposition pour porter plainte contre la disparition de leurs fils. D’autres veulent aller en France, et aussi porter plainte à Bruxelles.
Pourquoi les mères ont-elles pris la tête de cette mobilisation ?
Les familles entières sont mobilisées. Mais ce sont les mères qui ont pris les rênes et qui viennent le plus souvent aux sit-in. Ce sont elles qui ont mis au monde les disparus, elles veulent les retrouver. Peut-être que les pères travaillent. Peut-être aussi que ceux-ci ont plus de mal à montrer leur douleur.

Faites-vous la comparaison avec la mobilisation des mères argentines de la place de Mai ?
Ces mouvements de révolte se ressemblent, même si les femmes tunisiennes ne font pas le rapprochement. Elles sont issues de quartiers pauvres, je ne crois pas qu’elles connaissent l’histoire des mères en Argentine, en tout cas, on n’en a jamais parlé. Dans une vidéo que nous avons diffusée au théâtre de Milan, des sœurs se présentaient à la caméra en disant : « Je suis la sœur d’untel, mais je suis la mère de tous. » Cette mobilisation est spontanée, sans référence particulière, mais cette spontanéité est très politique car c’est la première fois que sont exprimés de manière concrète les effets des politiques mortelles de l’Union européenne en Méditerranée. Ce ne sont plus les associations antiracistes européennes qui dénoncent telle ou telle mesure, tel ou tel dispositif, ce sont des mères qui ont probablement perdu leur enfant en mer. Ça change le regard.
La spécificité de cette mobilisation n’est-elle pas que ces femmes demandent des comptes, alors qu’en général, ceux qui sont considérés comme des clandestins ne se sentent pas le droit de demander quoi que ce soit et se taisent ?
Oui, c’est une demande de vie ou de mort qui est liée au contexte politique en Tunisie, à la révolution. Les mères en Éthiopie n’ont pas la possibilité de se mobiliser de cette façon. Les mères au Maroc non plus. Les Tunisiens se sont battus contre la dictature, pour dire que les vies comptent. Avec la révolution, ils ont acquis la liberté, donc aussi la liberté de mouvement, et ils ne comprennent pas qu’on les empêche de circuler. En leur refusant l’accès aux visas et aux bateaux de ligne, les politiques migratoires européennes les obligent à prendre des risques, à mettre en péril leur vie. Eux savent qu’il n’y a pas de démocratie sans liberté de circuler. Ce qui est spécifique dans cette lutte, c’est que les femmes demandent des comptes à leurs autorités et aux représentants de l’Union européenne. Elles leur disent : « Ce qui nous arrive n’est pas un hasard. Vous êtes responsables. »
Lire également sous l'onglet "Prolonger"