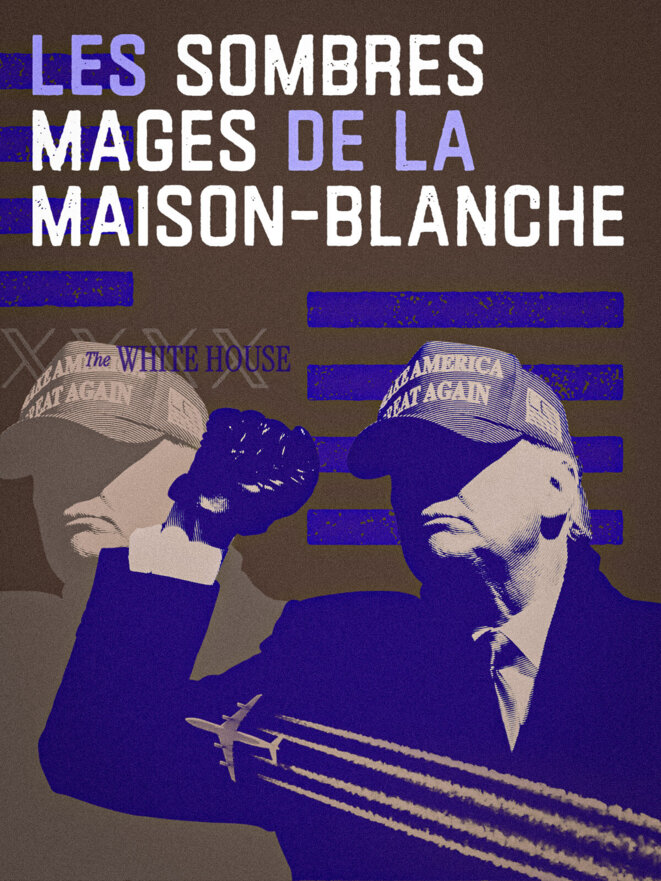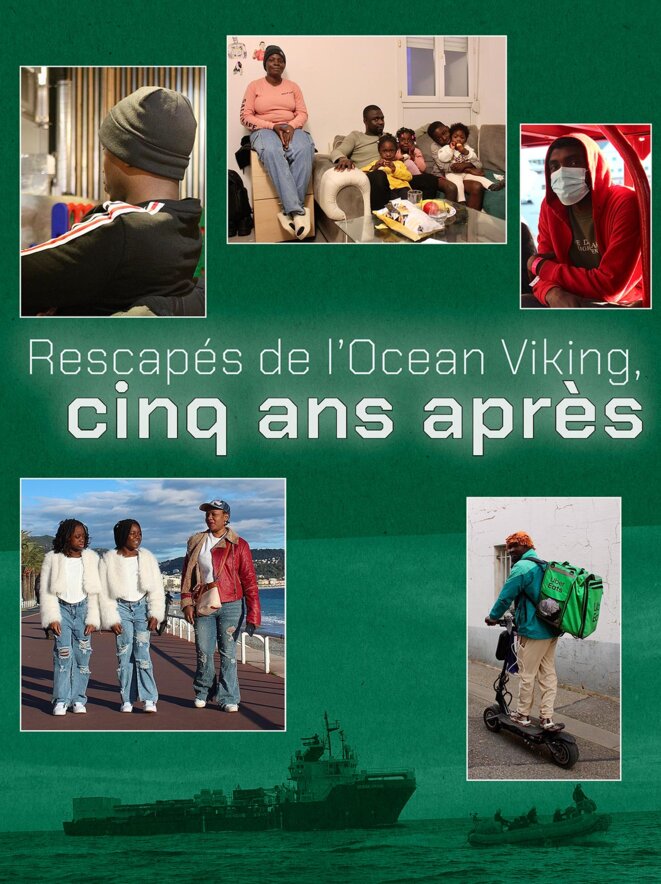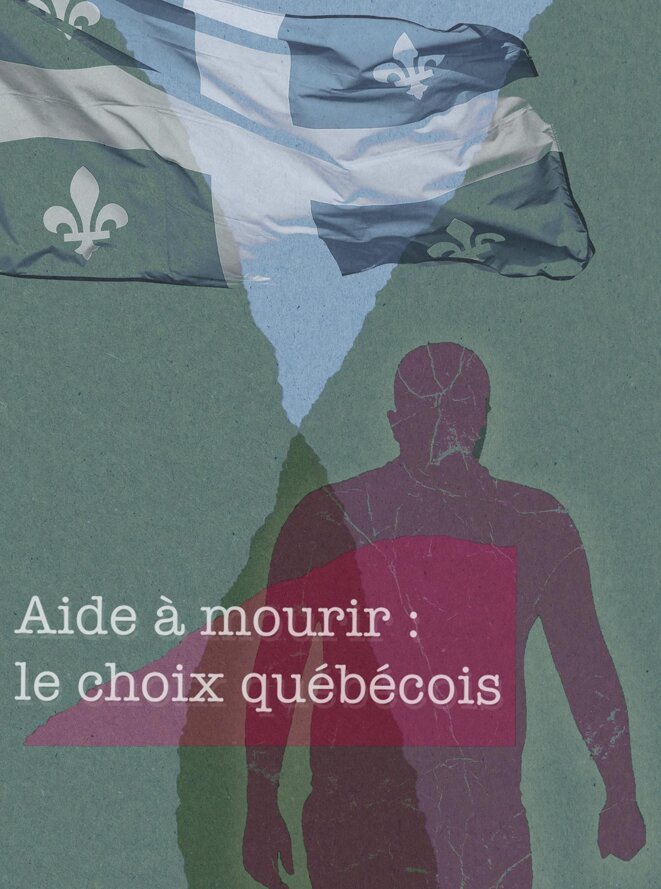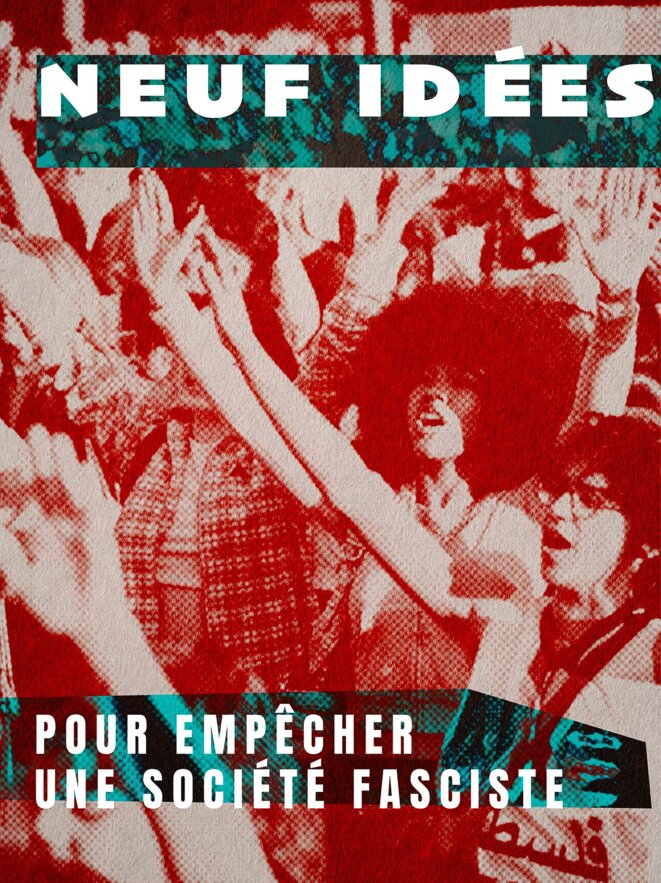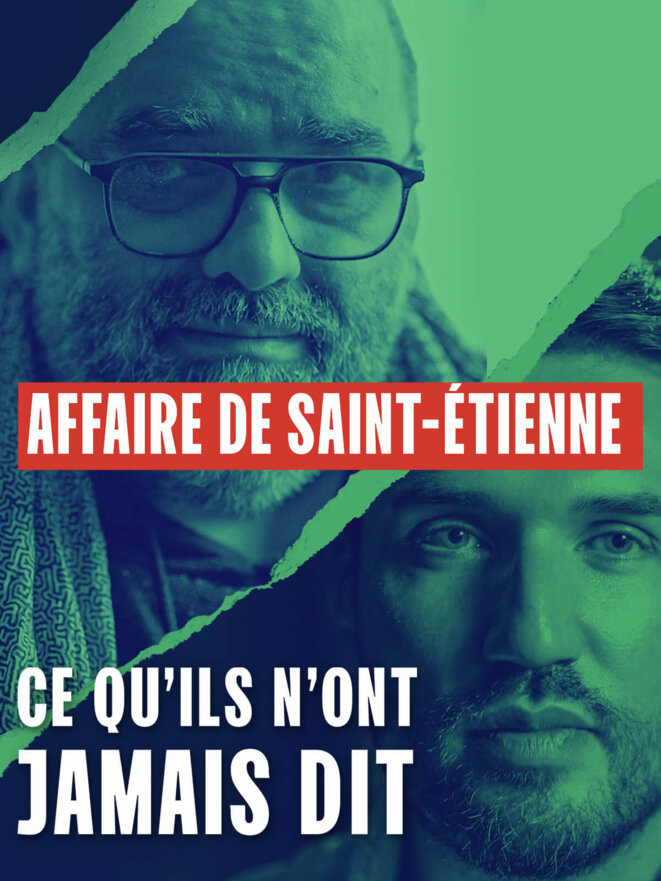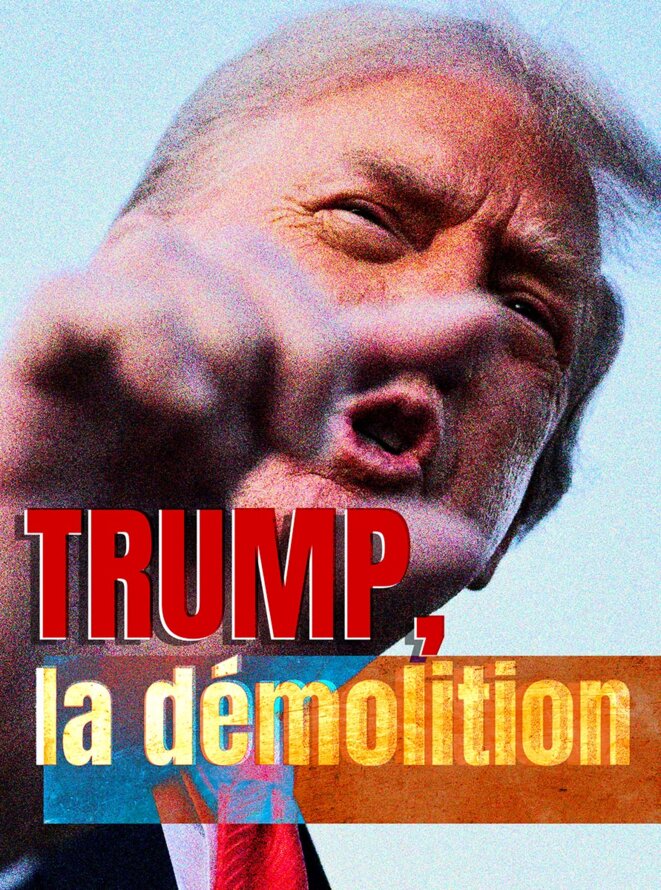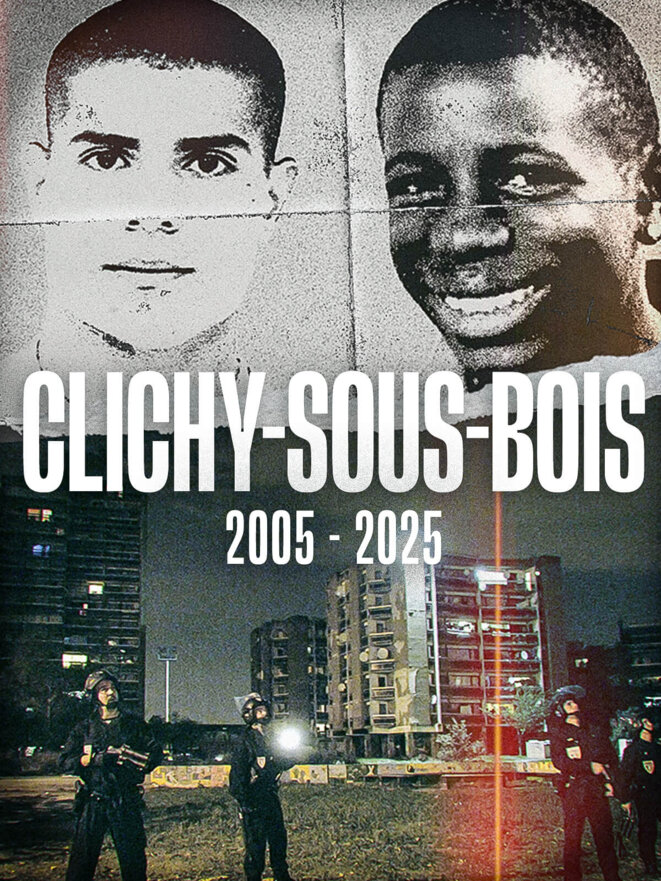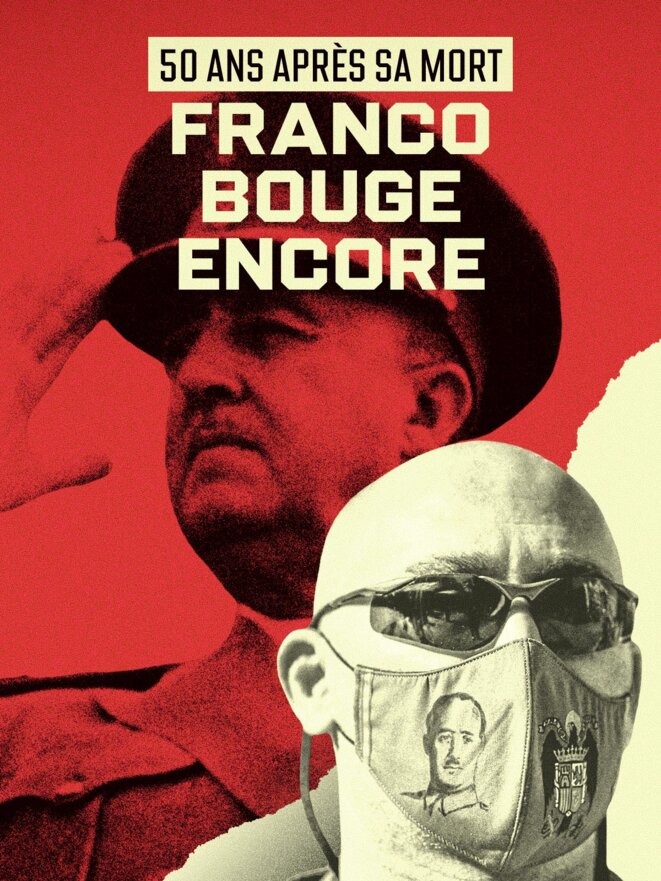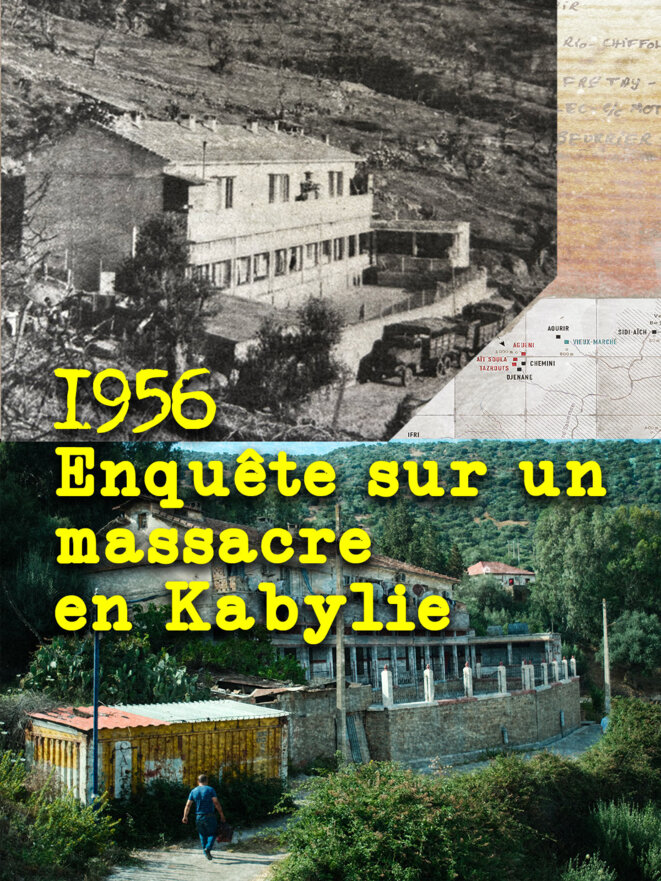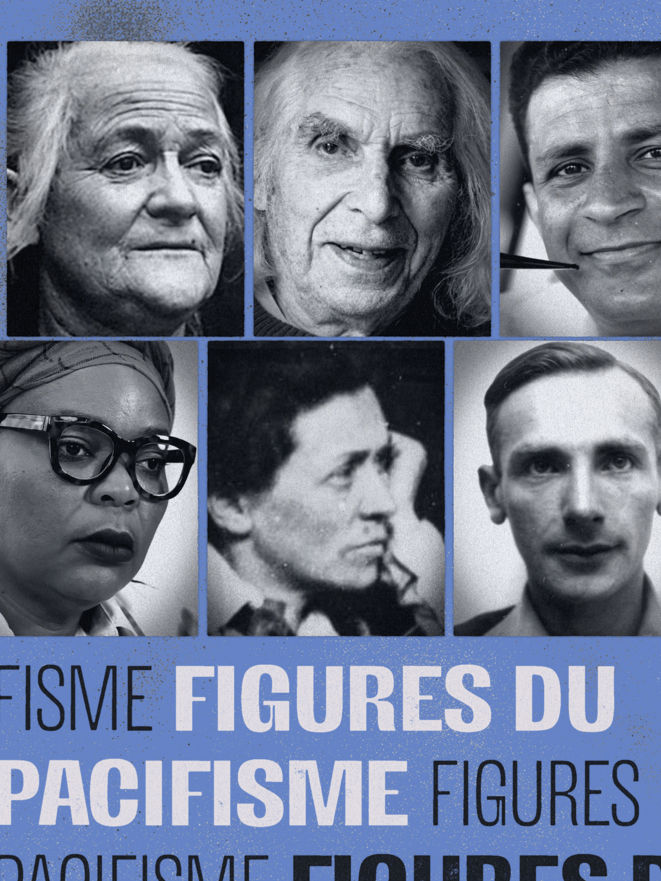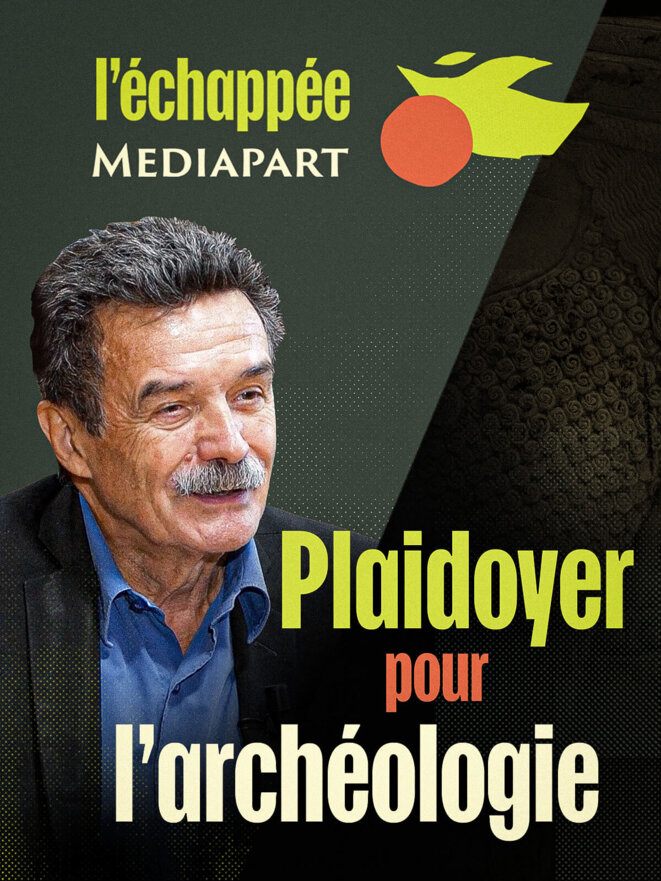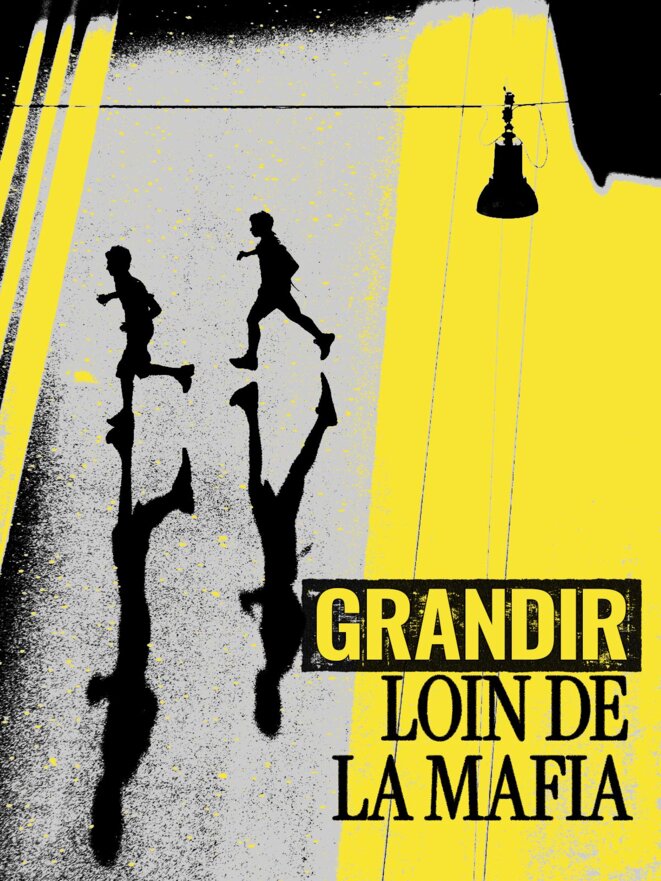Carolin Emcke est née en 1967. Elle a étudié la philosophie à Francfort avec Jürgen Habermas, a suivi un cursus d'histoire et de sciences politiques à Londres et Harvard. Elle a travaillé au magazine Der Spiegel comme grand reporter, où elle a couvert les conflits en Afghanistan, au Pakistan, au Kosovo, en Irak. Depuis 2007, elle écrit des reportages dans l'hebdomadaire Die Zeit. Elle a publié en 2008 Stumme Gewalt, un livre sur la Fraction armée rouge. Entretien chez elle, à Berlin.

Quelles images associez-vous à la France?
La France charrie dans l'esprit d'un Allemand un imaginaire très fort. C'est un pays cultivé, élégant, où l'on se sent bien. Quand j'arrive à Paris, je me sens tout de suite heureuse. La France est très souvent associée à Paris. Cet imaginaire est un peu ambivalent, on se dit par exemple que la France est un pays arrogant. Dès que je suis à Paris, je ne peux d'ailleurs pas m'empêcher de me dire que moi aussi, je serais arrogante si j'y vivais.
Paris est le centre de l'Europe, c'est évident. Berlin, ma ville, est très différente. C'est le seul endroit en Allemagne où je ne me sens pas étrangère. Cette rudesse, ces blessures de l'histoire encore ouvertes, cette laideur: Berlin est la seule ville allemande où je peux habiter, aucune autre ne serait vivable pour moi. La vieille bourgeoisie en est absente, soit parce qu'elle a été massacrée, soit parce qu'elle n'est jamais restée, et cela permet à cette ville de ne pas observer les conventions.
Pour moi, la France, c'est aussi un paysage littéraire avec des auteurs qui me sont essentiels. Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Emmanuel Levinas, Tzvetan Todorov [son blog, sur Mediapart]... Et Marcel Proust. Il a changé ma vie.
Pourquoi?
Proust a révolutionné la littérature. Ce style, cet art de l'observation, cet art de décrire la foison des associations d'idées, les souvenirs, les sentiments... Proust fait partie de ces figures de la philosophie et de la littérature que j'associe intimement à la France. Même s'il y a un certain nombre d'auteurs dans lesquels je ne me suis jamais plongée, comme Louis-Ferdinand Céline par exemple.
Les intellectuels français sont-ils connus ici?
Oui, certains. La philosophie critique d'Alain Badiou est très commentée. On le cite, on l'invite à des lectures. De même que Jacques Rancière. On les voit cependant un peu moins qu'avant dans les médias allemands. La génération de Jürgen Habermas ou de Jacques Derrida était très présente dans certains journaux de gauche, Die Zeit ou la Süddeutsche Zeitung. Ils publiaient des colonnes parfois très philosophiques, mais aussi plus grand public sur des sujets d'actualité. Et puis leurs successeurs, ceux qui ont aujourd'hui 50-55 ans, ont eu du mal à avoir la même surface dans les médias. Ils étaient peut-être plus politisés, je crois surtout en réalité qu'ils ne se sont pas autant mêlés au débat public. Ils n'ont pas pris leur place. En France, j'ai l'impression que certains intellectuels sont quand même un peu plus présents dans le débat public que chez nous.
Vous connaissez pourtant le rapport un peu compliqué de notre président de la République avec les intellectuels?
Oui, bon... votre président est clairement un problème.
Quelle image avez-vous de la France actuelle, celle de Nicolas Sarkozy?
Nicolas Sarkozy et Angela Merkel représentent deux façons tellement opposées de faire de la politique. D'un côté vous avez ce président qui brasse de l'air comme un ventilateur, et de l'autre, Angela Merkel, une femme qui me semble absolument dépourvue de toute conception du politique. Une figure étonnante, qui semble venir de nulle part, comme si elle n'avait aucune racine. Merkel a l'air tellement insensible, comme si elle était immunisée contre le monde. Sarkozy, c'est absolument le contraire! Cette pulsion qu'il a en lui, comme s'il était tiré par quelque force extérieure! Merkel, elle, freine des quatre fers, comme si elle refusait absolument de se laisser entraîner...
Le moteur franco-allemand existe-t-il vraiment?
Je crois que ce fameux moteur franco-allemand que Sarkozy et Merkel tentent d'incarner est considéré comme une abstraction par les Allemands de la rue. Pour les intellectuels, c'est un objet qui n'a pas de sens. En revanche, je peux vous dire que ce qui se passe en France sur le terrain social est ici regardé avec beaucoup d'attention par une grande partie de la gauche : les manifestations, ces patrons retenus dans les usines, les luttes sociales... Beaucoup d'observateurs, beaucoup de salariés regardent ce qui se passe chez vous. Moi aussi, je suis particulièrement attentive à la culture sociale en France. Même si j'ai un peu de mal quand certains intellectuels anti-mondialisation français de gauche flirtent avec un discours xénophobe...
«Parler d'Israël, c'est parler de notre propre histoire»

Agrandissement : Illustration 2

En reportage © Sebastian Bolesch
En Allemagne, le climat social semble plus calme...
La grève est très ritualisée, la culture syndicale n'est pas la même que chez vous... C'est d'ailleurs assez intéressant: entre la France et l'Allemagne, beaucoup de questions de société se posent très différemment. Prenez les banlieues, l'intégration ou l'islam. La France a été un pays colonial, c'est donc bien sûr très différent de chez nous où les immigrés sont pour la plupart des «travailleurs invités» (Gastarbeiter). Pareil pour Israël, Gaza, le Proche-Orient...
Pour des raisons historiques, ce sujet est lesté chez nous d'un poids si lourd! Israël n'est pas vraiment un pays qui nous est étranger. Pour un Allemand, parler d'Israël, c'est parler de sa propre histoire. Il est donc impossible pour un intellectuel de discuter de ce thème avec un regard distancé, impossible de se placer dans le rôle de l'observateur au-dessus de la mêlée. Beaucoup préfèrent donc ne rien dire du tout. Sur la scène internationale, la France joue, dans ce dossier en particulier, un rôle tout à fait différent. Les intellectuels français s'expriment naturellement, ils savent aussi que leur voix est légitime et qu'elle va porter.
Vous refusez cette position de retrait. Vous allez dans les pays arabes, vous écrivez de grands reportages, tradition journalistique assez rare en Allemagne...
C'est vrai. Si je me suis intéressée au monde arabe et à la question du Proche-Orient, c'est à cause de la Shoah. Ma génération n'a pas du tout connu la guerre, mais elle porte sur ses épaules une charge morale incroyable. Je me définis comme une intellectuelle, et en même temps je sais très bien que les intellectuels allemands des années 30 et 40 n'ont pas permis d'éviter le nazisme.
Voilà pourquoi en arrière-plan de mes reportages, il y a toujours cette question de la violence, des traumatismes qu'elle provoque, de l'incapacité des victimes à parler, à décrire ce qu'elles ont subi... Non pas parce qu'elles ne se rappellent plus. Bien au contraire! Mais parce qu'elles ont perdu la confiance qu'elles avaient dans le monde. Parfois la brutalité des violences a été tellement inattendue, tellement rapide, que les victimes mêmes n'arrivent pas à croire ce qui leur est arrivé... Leurs récits deviennent alors souvent inintelligibles, le fil des histoires qu'elles racontent est décousu.
Ce qui me passionne, c'est de reconstruire ces récits, parce que si l'on ne raconte pas l'histoire des victimes, alors les criminels gagnent. C'est toujours comme ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quand des Juifs ont commencé à être gazés dans des camions, il y avait des témoins, juifs eux-mêmes. Ils sont rentrés dans leur village: personne ne les a crus. Ce qu'ils racontaient était tout simplement incroyable. Ce qui m'intéresse, c'est de partir de cette expérience liée à l'histoire allemande pour regarder le monde, et tenter de raconter les histoires de tous ces gens que l'on n'écoute pas, parce que leurs récits paraissent aberrants.
Est-ce difficile d'être un reporter allemand à Gaza ou en Israël?
C'est terriblement compliqué. Dans les pays musulmans, je suis toujours reçue avec une certaine sympathie antisémite. Mes interlocuteurs se disent souvent: «Elle est allemande, elle est donc antisémite.» Il y a toujours un moment où on me dit: «Hitler aurait dû tous les...»
[Elle ne termine pas la phrase.]
Vraiment?
Toujours. Je l'ai entendu dans tous les pays de cette région où je suis allée. Au Pakistan, dans les territoires palestiniens, très souvent. Un peu moins fréquemment dans d'autres pays. C'est absolument abject. En même temps, c'est pour moi une très bonne occasion de remettre mon interlocuteur à sa place. Parce qu'il me croit antisémite et qu'il présume une certaine connivence entre nous pour cette raison là, je suis paradoxalement très crédible à ses yeux.
Que dites-vous, dans ces cas-là?
J'arrête de travailler. Je pose mon carnet et mon stylo. Et j'explique que si, tout cela a bien existé. Je dis que nous, les Allemands, avons tué 6 millions de Juifs. Qu'ils ont été enfermés, torturés, gazés. Dans le monde musulman, beaucoup ne savent pas que bon nombre de Juifs massacrés étaient des citoyens allemands. Je leur explique donc que la Shoah, c'est aussi ma propre histoire. En général, mon interlocuteur est plutôt irrité. Dans certaines régions très reculées du Pakistan ou de l'Afghanistan, il faut beaucoup de temps. Ce sont des zones où la tradition orale est très forte. Je commence à parler, le doyen de la communauté arrive, et bientôt tout le village est là, à nous écouter.
Cette occasion d'expliquer ce qui s'est vraiment passé, je ne la laisse jamais passer. Pour moi, tout cela est très difficile. J'ai beaucoup de mal à écrire mes reportages quand je reviens du Proche-Orient ou des pays musulmans. Je me demande toujours si je suis assez prudente, si je ne prends pas parti pour un camp ou pour un autre.
Vous avez écrit un livre sur la Fraction armée rouge, ces activistes d'extrême gauche qui ont commis une série de meurtres dans les années 70 et 80 – ils ont notamment tué votre parrain en 1989. Si je vous dis que c'est une histoire très allemande, vous êtes d'accord?
Oui, même s'il y a eu des phénomènes un peu similaires dans beaucoup d'autres pays du monde, par exemple en France avec Action Directe. Mais là où vous avez raison, c'est que Baader et tous les autres sont vraiment des enfants d'Auschwitz. Auschwitz nous a appris – et cela reste vrai –, que ne pas s'opposer à un crime, ne pas résister, ne pas l'empêcher, c'est un crime en soi. Andreas Baader et ses compères étaient des jeunes Allemands de la première génération d'après-guerre, habités par cette leçon d'Auschwitz. Je comprends donc tout à fait leurs motifs. Mais je crois que leur méthode était mauvaise.