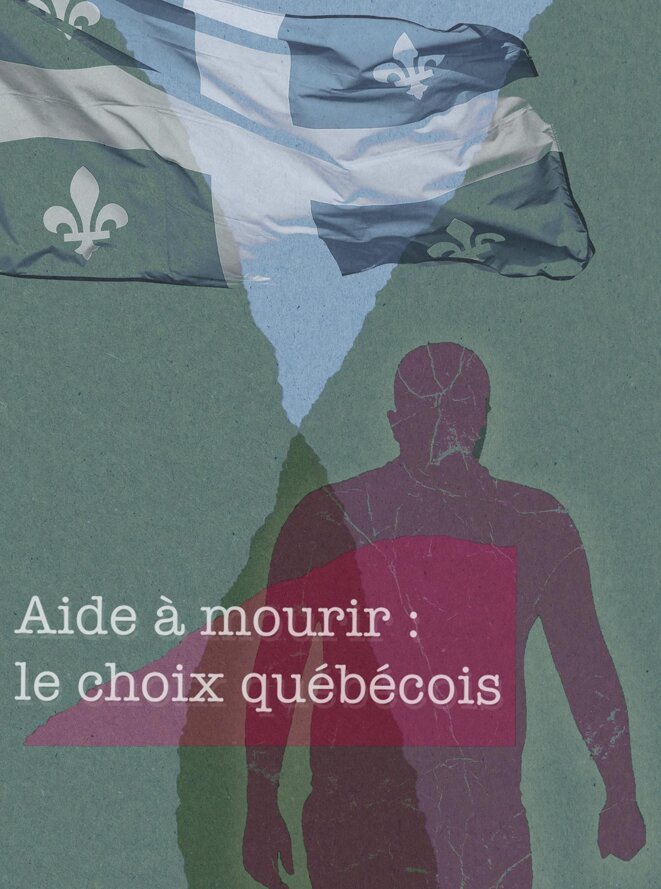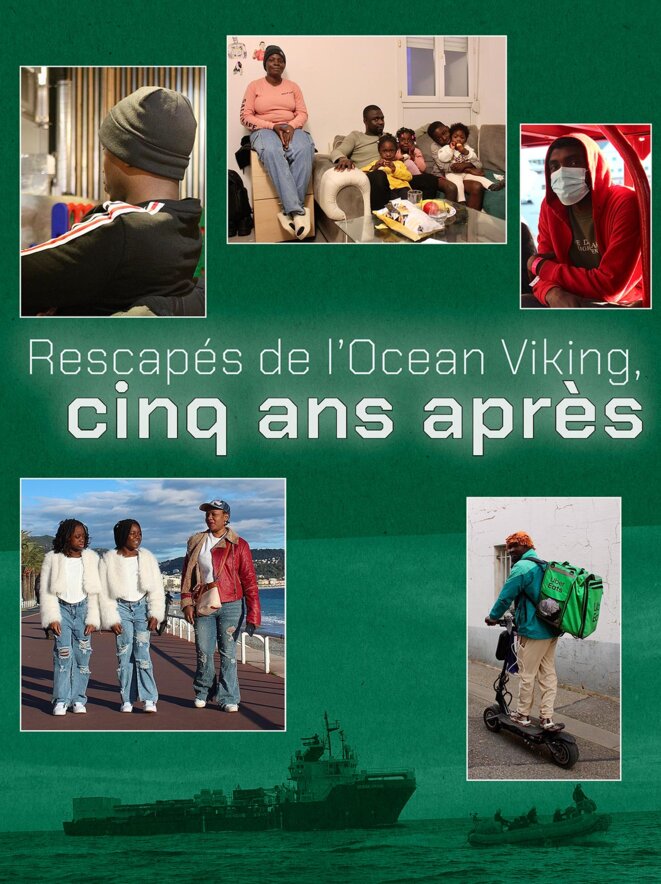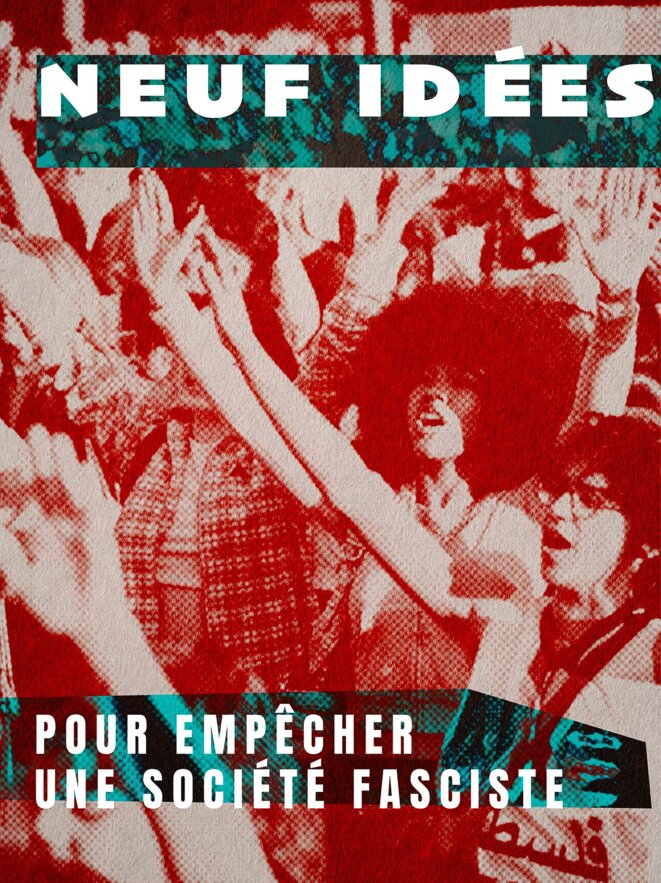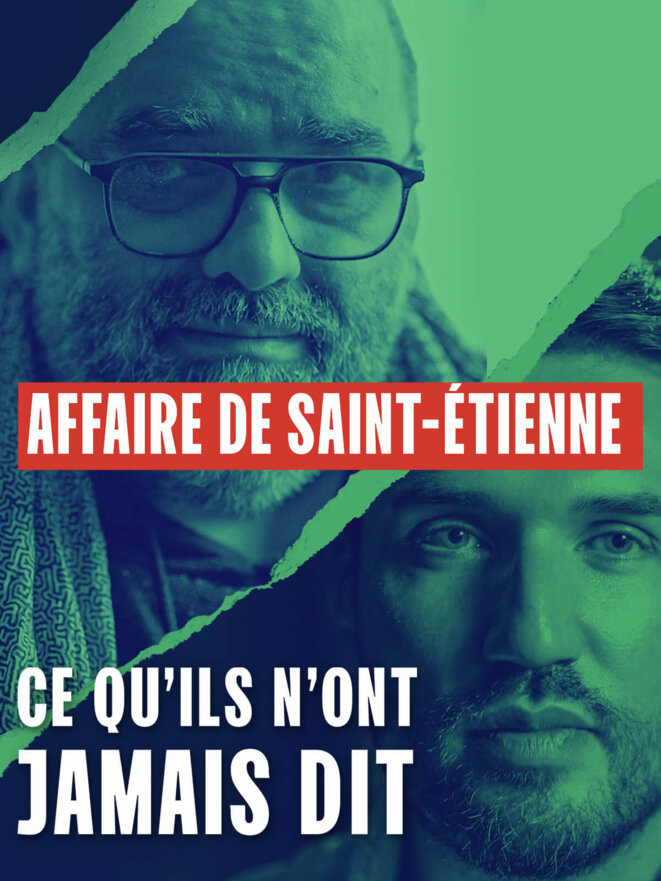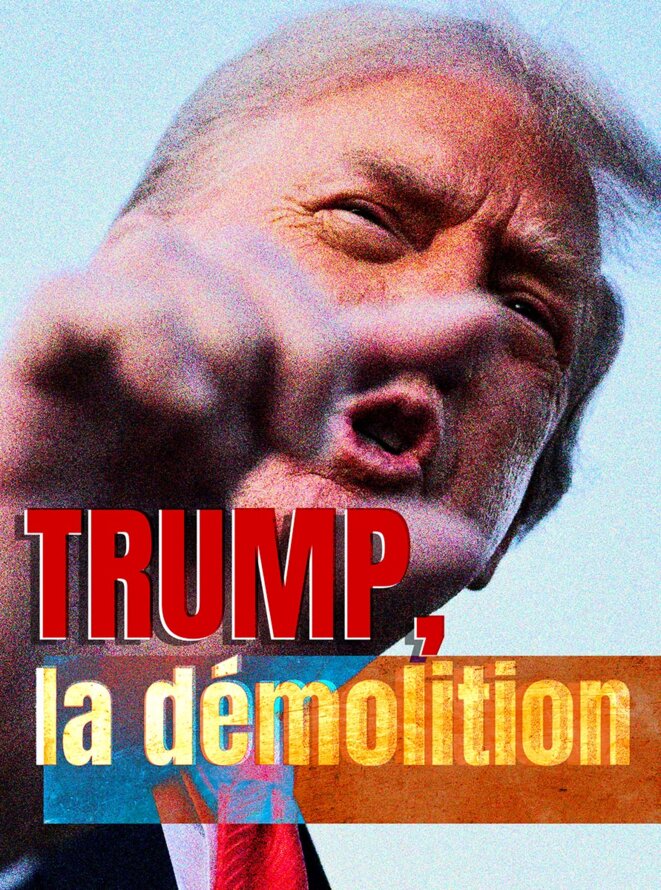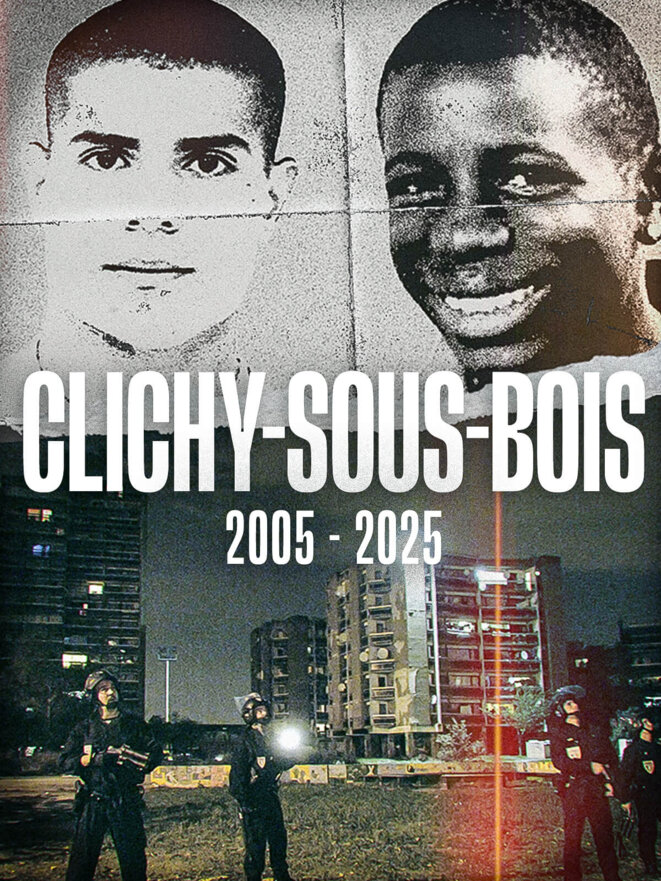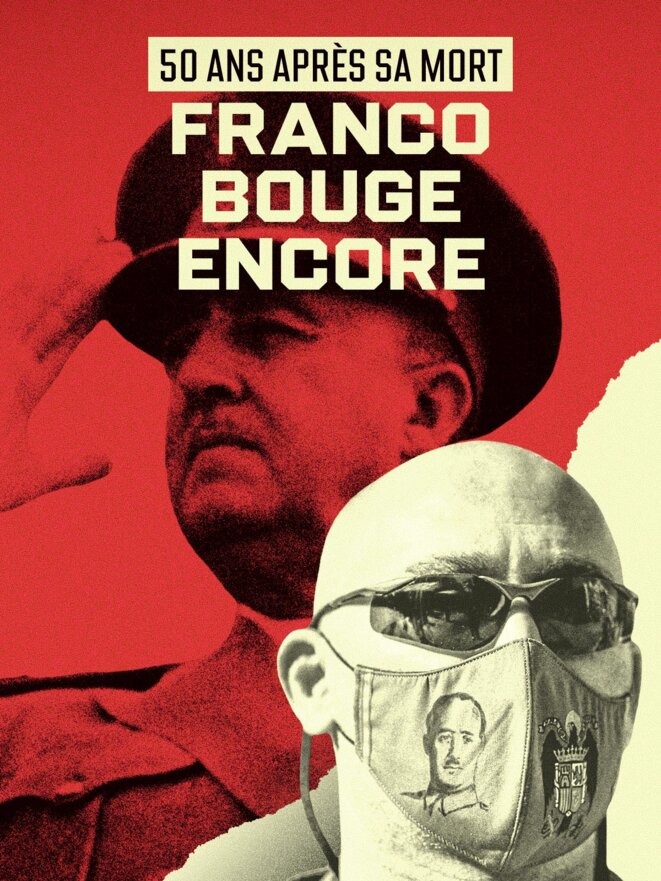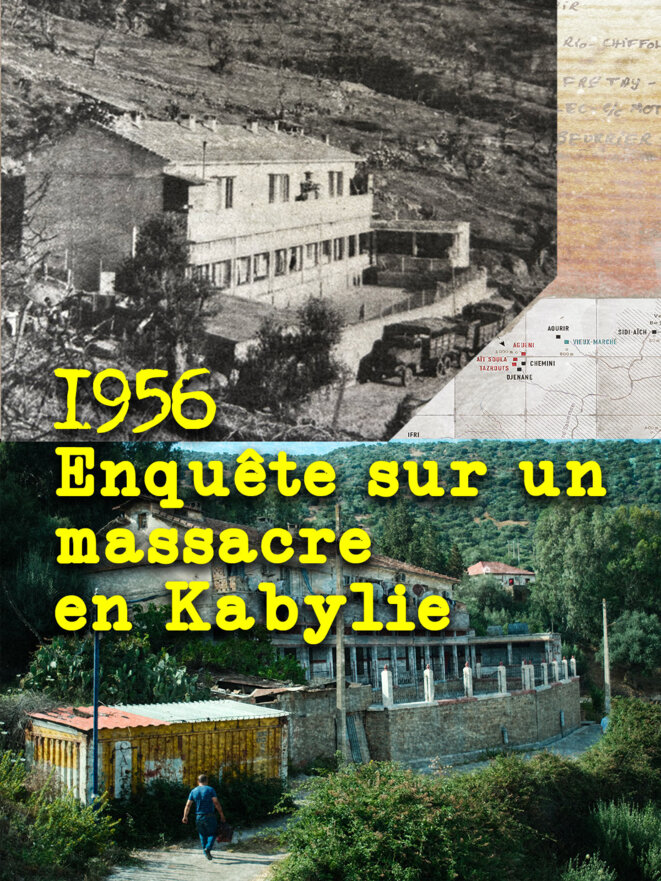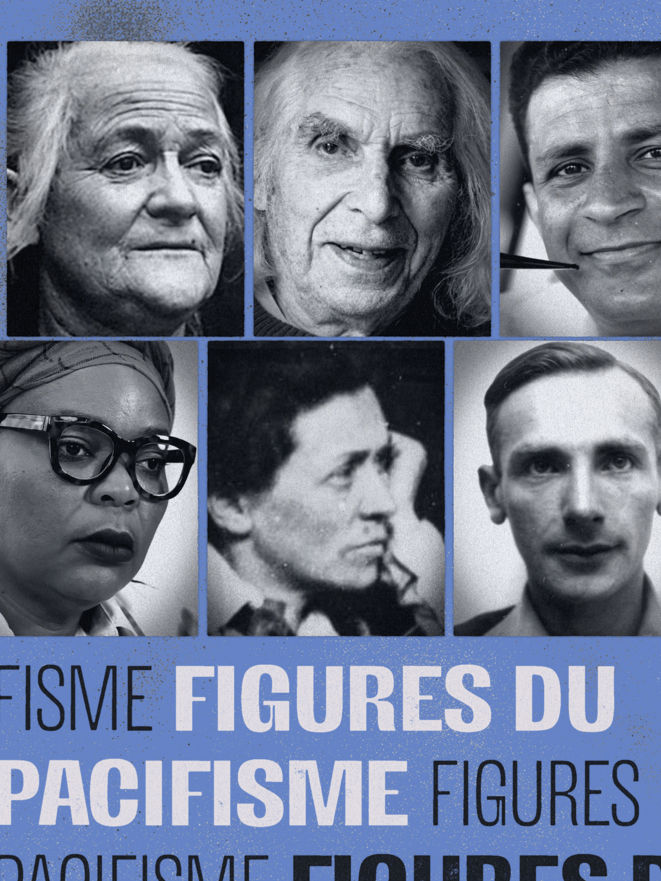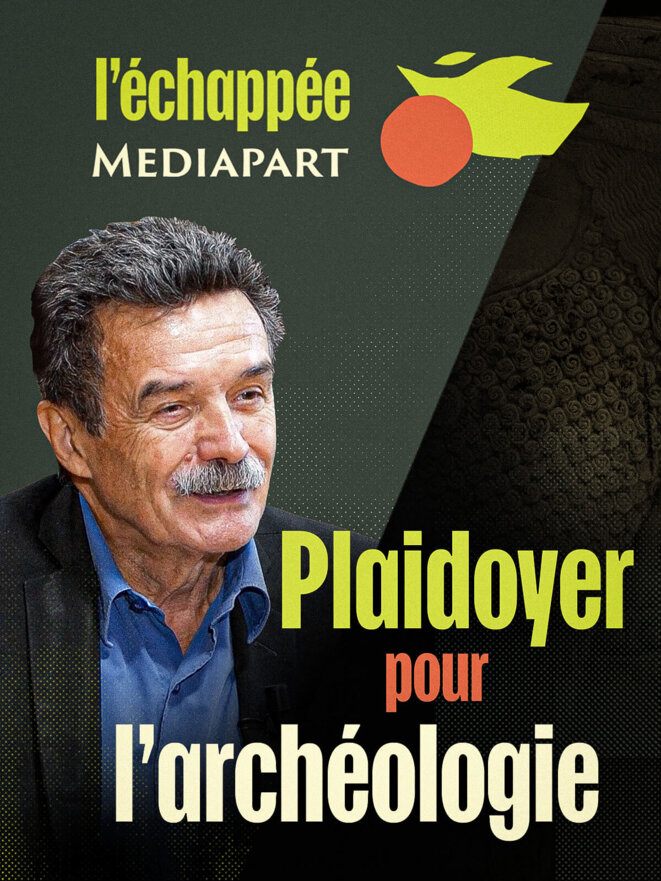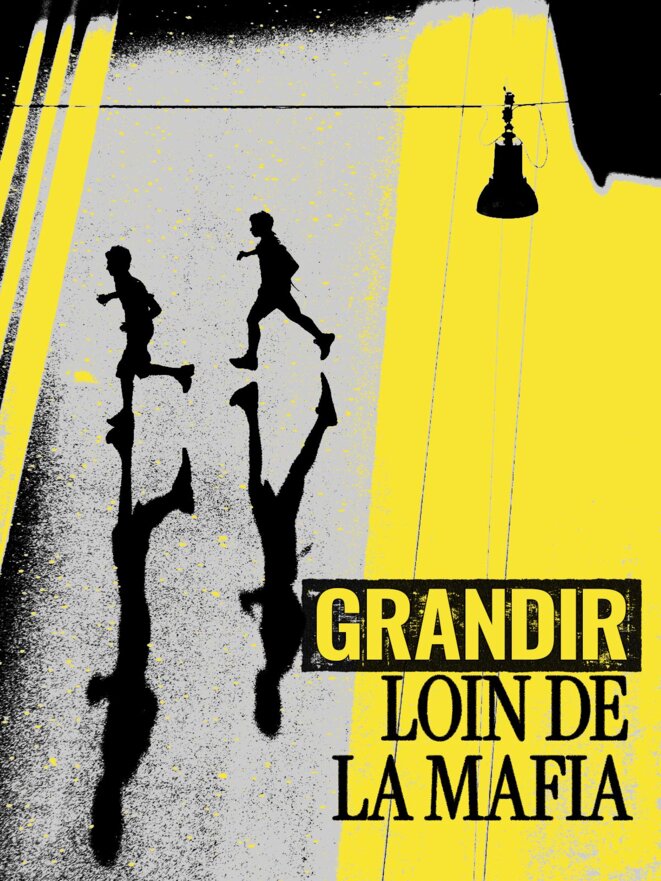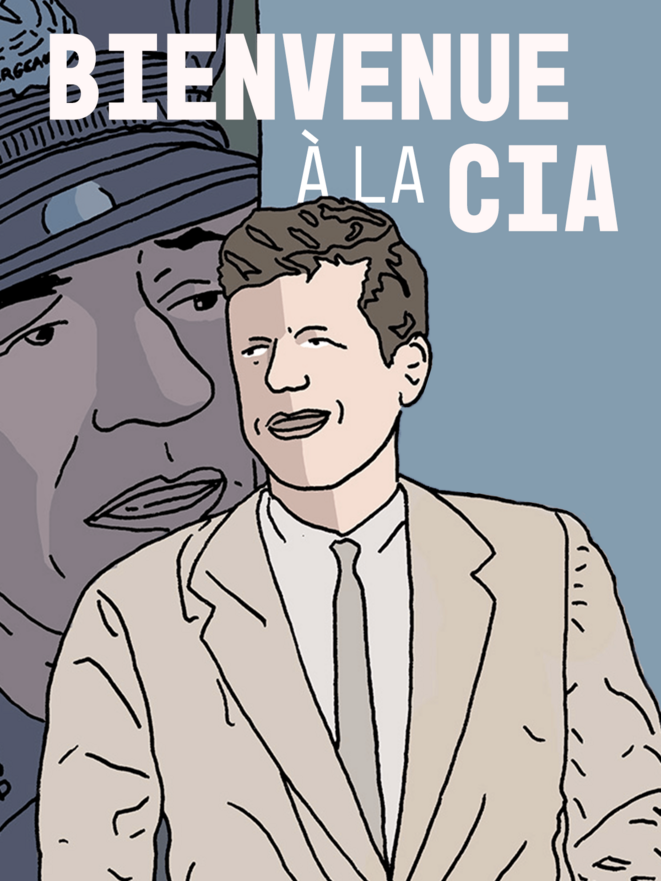De notre envoyé spécial en Birmanie
Avec l'Albanie d'Enver Hoxha, la Birmanie de la junte militaire a été, dans l'histoire récente, l'un des pays les plus soucieux de contrôler les mots et les images que les habitants pouvaient recevoir ou exprimer. Peindre une ampoule brisée était prohibé, car perçu comme un acte hostile au régime dans un pays connu pour ses nombreuses coupures d'électricité. Les réunions de plus de cinq personnes étaient interdites. Internet n'était pas accessible. Les téléphones portables n'existaient pas. Les lignes fixes étaient espionnées.

Toutes les publications devaient obtenir une autorisation préalable du bureau de censure, et la plupart des journaux étaient ainsi publiés avec de nombreux trous correspondant aux passages litigieux. Le quotidien officiel, The New Light of Myanmar, avait rapidement été surnommé « The New Lie of Myanmar », parce que, comparé à lui, la Pravda aurait pu passer pour un journal satirique. Et l'allégorie, l'allusion ou l'ironie étaient les figures de style préférées des écrivains pour tenter d'éviter les foudres du censeur en chef, Tint Swe, surnommé le « bourreau de la littérature ».
« Il faut vous représenter que nous, qui habitions à Rangoon, ne savions rien de ce qui se passait à Mandalay, la grande ville à 500 km au nord, explique Thi Lah, qui préfère s'exprimer sous pseudo parce que, même si les journalistes étrangers peuvent désormais travailler quasiment sans contrainte, elle redoute encore de possibles représailles. S'il se produisait un bombardement, une catastrophe aérienne ou un tremblement de terre, nous n'en savions que ce que la junte en disait sur la radio officielle », comme lorsque les militaires avaient minimisé les conséquences du cyclone Nargis qui, en 2008, a dévasté le delta de l'Irrawaddy en faisant plus de 130 000 morts.
La situation est résumée par Zarganar, l'humoriste le plus célèbre du pays, à la fois ancien prisonnier politique et ancien dentiste, dans la fable d'un homme parvenu jusqu'en Inde pour faire soigner sa rage de dents. Au docteur étonné qui l'interroge pour savoir s'il n'existe pas de dentiste en Birmanie, il répond : « Si, mais nous n'avons pas le droit d'ouvrir la bouche. »
Toutefois, en dépit du double jeu des nouvelles autorités « civiles » qui contrôlent d'une main ce qu'elles accordent de l'autre, la découverte et l'apprentissage de la liberté d'expression constituent sans doute la partie la plus sensible du processus de transition engagé par la junte auto-dissoute depuis novembre 2010 et la libération d'Aung San Suu Kyi. Même si un journal sportif, qui avait alors joué avec les couleurs d’un titre sur le football pour saluer cette libération, puisqu'en reliant les lettres rouges entre elles on pouvait lire « Suu free », avait, pour cela, écopé de quinze jours de suspension…

Agrandissement : Illustration 2

L'ouverture d'un pays et la mutation d'un régime ne se jouent pas seulement dans les lois discutées au Parlement, l'organisation d'élections ou les réformes constitutionnelles. Dans un pays aussi reclus et replié sur lui-même que l'a été la Birmanie, l'émancipation progressive d'une parole, non seulement politique, mais aussi personnelle, agit sur l'esprit des individus et la définition même de l'espace public.
Le lieu le plus visible de cette nouvelle liberté d'expression est la presse, pour laquelle un rapport de RSF de janvier 2013, a été jusqu'à parler de « printemps birman des médias » en s'interrogeant sur la solidité des réformes engagées tout en montrant l'avancée fulgurante du secteur, surtout depuis le 20 août 2012, lorsque le gouvernement a décrété la fin de la censure des médias.
Depuis le 1er avril 2013, les lecteurs ont, pour la première fois depuis la nationalisation de tous les journaux en 1964, la possibilité d’acheter des quotidiens détenus par des intérêts privés, comme par exemple Voice Daily, ou le quotidien qu'envisage de lancer la Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi, D-Wave. Les médias d'opposition exilés, en Thaïlande comme le journal Irrawaddy, ou émettant depuis la Norvège, comme Democratic Voice of Burma (DVB), ont réinstallé leurs bureaux et leur personnel à Rangoon.

Agrandissement : Illustration 3

Pour Zoe Way Latt, chef du bureau de Rangoon de la DVB, tout juste rentré d'exil après vingt-deux ans passés en Thaïlande, « désormais on peut dire ce qu'on veut. Même s'il reste difficile d'interviewer des militaires et de connaître l'étendue de leur business ».
« On peut critiquer ouvertement le président, l'armée, les ministres, s'enthousiasme même Kyaw Min Yu, alias Jimmy, ancien leader des révoltes étudiantes de 1988. Il y a encore seulement trois ans, non seulement on ne pouvait pas leur faire de critiques, mais il était même interdit de parler d’eux ! »
Lah Lah Win, une jeune journaliste intrépide de la DVB, emprisonnée de 2007 à 2012 pour avoir couvert la révolte des moines se souvient ironiquement du temps « où on ne pouvait parler que des acteurs et des actrices, alors que, maintenant, il se passe tellement de choses qu'on ne sait plus où donner de la tête ».
« La liberté de la presse demeure limitée »

La Birmanie est-elle pour autant susceptible de retrouver le rôle pionnier en matière de liberté de la presse qu'elle a longtemps eu en Asie, grâce notamment à la législation progressiste mise en place par le roi Mindon ?
Les paroles de ce monarque réformateur du XIXe siècle restent en effet gravées dans la mémoire des journalistes birmans du XXIe : « Si j’agis mal, écrivez sur moi. Si les reines agissent mal, écrivez sur elles. Si mes fils et mes filles agissent mal, écrivez sur eux. Si les juges et maires agissent mal, écrivez sur eux. Nul ne peut s’en prendre aux journalistes pour avoir exprimé la vérité. »
Mais le nouveau gouvernement « civil », auquel la junte auto-dissoute a confié les rênes du pays ne partage sans doute pas sincèrement les convictions du roi Mindon, en dépit des mesures de libéralisation qu'il a pu prendre. « Une loi sur les médias écrits a été votée, mais elle demeure floue, explique Zoe Way Latt. Et il n'existe toujours pas de loi sur les médias audiovisuels, même si on nous en annonce une pour septembre. » La loi sur la presse de 1962 qui stipule que les journaux ne doivent pas « critiquer le gouvernement et mettre en cause la sécurité nationale » n'a pas été abolie. Et malgré la levée de la censure, la Division de vérification et d’enregistrement de la presse continue d’exister.

Agrandissement : Illustration 5

À ces insuffisantes garanties législatives, s’ajoutent les pratiques des autorités, qui n'osant plus trop attaquer directement les journalistes, s’en prennent, en guise de compensation, à ceux que ces derniers interviewent. Fin juin, trois activistes ayant demandé, dans un journal local, la levée de l’état d'urgence dans la région de Monywa, au nord de la Birmanie, où un conflit autour d'une mine de cuivre a été violemment réprimé par les forces de l'ordre, ont été convoqués par la police pour être incarcérés. L'un d'entre eux, Ma Aye Mynt, 35 ans, explique « avoir peur d'être arrêté d'un instant à l'autre. La liberté de la presse demeure limitée, notamment sur toutes les questions qui touchent à l'économie et aux intérêts de l'armée ».
Autre exemple, évoqué par Lah Lah Win « après qu'un journaliste a raconté que, lors d'une conférence officielle, le drapeau birman était accroché à l'envers, signe, disait-il, d'une critique de la politique gouvernementale, le responsable a été limogé ».
Outre ces obstacles légaux et ces intimidations officieuses, la libéralisation des médias, en forme de privatisation, est loin d'être automatiquement synonyme de fin de l'emprise gouvernementale. Kuma travaille ainsi dans l'une des radios FM privées qui ont émergé ces derniers temps. Mais, précise-t-elle, la station où elle officie, Ruby FM, lancée il y a deux ans « appartient aux familles des membres du gouvernement ».

Pareil pour Cherry FM qui appartient à U Thura Shwe Man, le « speaker » du Parlement depuis 2011, réputé être un des « durs » du nouveau régime et ouvertement candidat à l'élection présidentielle de 2015. Sur ces radios, la moindre critique du gouvernement est « inenvisageable », précise Kuma. Pour elle, le retour des médias emblématiques de l'opposition en exil, comme Irrawaddy ou DVB, est même « une erreur. Les autorités leur ont permis de rentrer en Birmanie pour pouvoir garder un œil sur eux ».
La crainte que le processus de libéralisation soit à la fois incomplet, en trompe-l’œil et réversible, est donc manifeste. « Bien sûr que cela change de pouvoir parler politique au café ou dans les maisons de thé », explique Ko Thina, membre du Democratic Party for a New Society, un parti d'opposition initialement créé en 1991, laminé par les années d'exil et de prison de ses cadres et aujourd'hui en voie de légalisation. « Mais je ne considère pas que je sois libre de dire tout ce que je pense. Je continue à m’autocensurer, parce que je me méfie encore de ceux qui m'ont mis en prison et qui détiennent toujours du pouvoir. Aujourd'hui, le temps est au calme, mais nous ne savons pas si la tempête ne peut pas venir. »

Agrandissement : Illustration 7

Pour Hnin Hnin Hmway, une adhérente de ce même parti, qui a passé six ans dans les geôles de la junte, le constat est identique : « Il existe encore un décalage entre ce que je pense en privé et ce que je dis publiquement, parce que les changements d'aujourd'hui sont superficiels, donc je continue à faire attention. Je ne me sens toujours pas tranquille. La nuit, dès que j'entends une voiture s'arrêter devant chez moi, je pense qu'elle vient pour me chercher. »
Parole émancipée et affirmation personnelle
Toutefois, en dépit de cette peur encore diffuse, particulièrement présente parmi les fonctionnaires qui sont les plus réticents à répondre aux questions des journalistes, la libéralisation à l’œuvre permet l'émergence d'un espace public de discussion et d'information, jusqu'ici inexistant, que ce soit dans les cafés, à travers les kiosques qui ont fleuri dans les rues des grandes villes birmanes ces derniers mois, ou encore dans les librairies…

Postée devant trois rayons entiers « de livres politiques qui n'existaient pas du tout avant 2011 », une jeune vendeuse de la librairie Amay Eain, située rue Pansodan, à Rangoon, discute ainsi avec un jeune homme du dernier ouvrage autobiographique publié par Zarganar, le fameux satiriste. Yhe Yhe Mung, 29 ans, explique que « ce genre de livre se vend très bien, d'autant que Zarganar réussit à raconter avec humour ses expériences de prisonnier politique et de torture ».
Son interlocuteur, Thu Thu, 35 ans est un ancien employé du magasin. « Mais je reviens ici pour pouvoir feuilleter tous ces nouveaux livres, précise-t-il, parce que je ne peux pas me les offrir. Et puis, j'ai un projet d'écriture. À force de lire tous ces auteurs qui partagent leurs expériences personnelles, j'ai, moi aussi, envie d'écrire sur les miennes. »
La transformation la plus importante de la Birmanie en transition ne se voit sans doute pas à l'œil nu, à travers les nouveaux rayons des librairies ou la densification des kiosques des grandes villes. Il peut se résumer par une affirmation individuelle doublée d'une soif de savoir.
« Ce qui a vraiment changé dans les rues de Rangoon, à part les embouteillages, c'est que les gens lisent sans cesse, notamment les journaux, explique Thi Lah. Alors que nous restions le nez sur la vie quotidienne et ses soucis, désormais, les gens s'intéressent à la politique et prennent le temps de regarder, de lire, d'apprendre, de parler… »

Agrandissement : Illustration 9

Le parcours de la jeune femme est emblématique d'une Birmane urbaine de la classe moyenne et des nouvelles possibilités offertes – sous condition – par la période d'ouverture. « J’ai fait des études de droit et obtenu une licence d'avocat. Mais cela fait huit ans que je ne pratique plus, parce que travailler comme avocat dans ce pays revenait à marcher sur un mur étroit séparant la ville et la prison, d'autant que je m'occupais des prisonniers politiques. Il était impossible de savoir si on allait tomber à gauche ou à droite de ce mur. »
Lorsque la junte a décidé d'ouvrir le pays au tourisme, dans les années 1990, elle a donc décidé de devenir guide, notamment parce que cela permettait d'être en contact avec des étrangers. Désormais elle s'interroge : « Est-ce que je dois à nouveau changer de métier ? Tout ce qui se passe ouvre des perspectives. On est à l'affût, mais on se demande si ce moment va se poursuivre éternellement. Nous sommes encore en train d'observer avec circonspection tout ce qui se passe. On écoute, on regarde ce que les autres font. Mais les mentalités changent ; nous sommes moins soumis. Auparavant, à la banque ou dans une administration, les gens revenaient sans broncher le lendemain si on leur disait que leur dossier n’était pas prêt. Désormais, ils réclament leur dû immédiatement… »