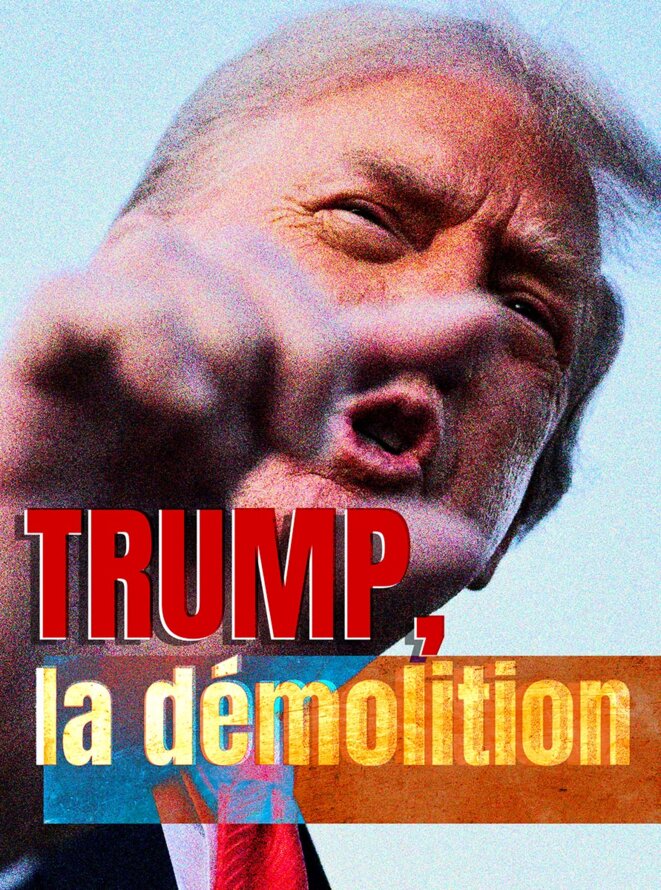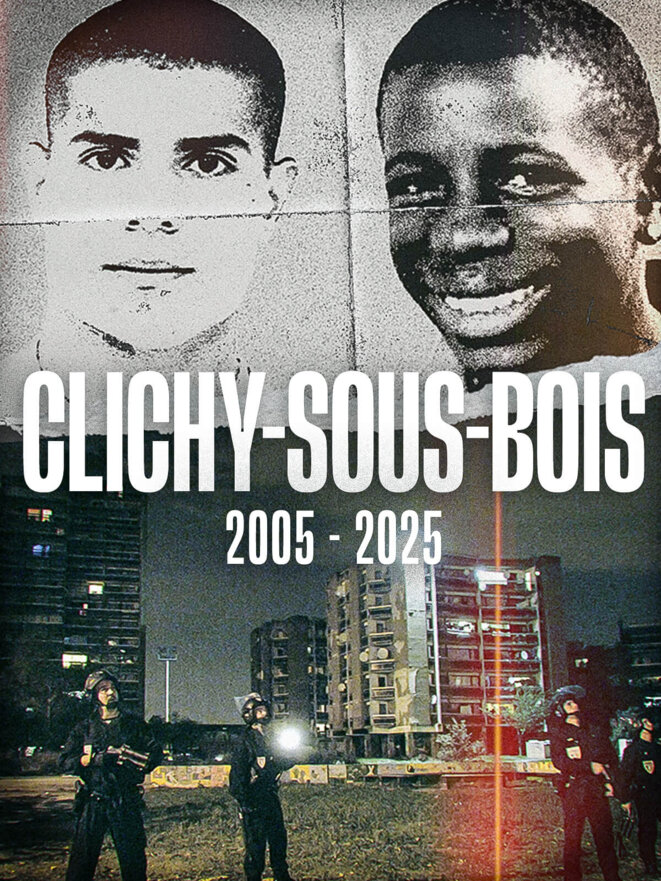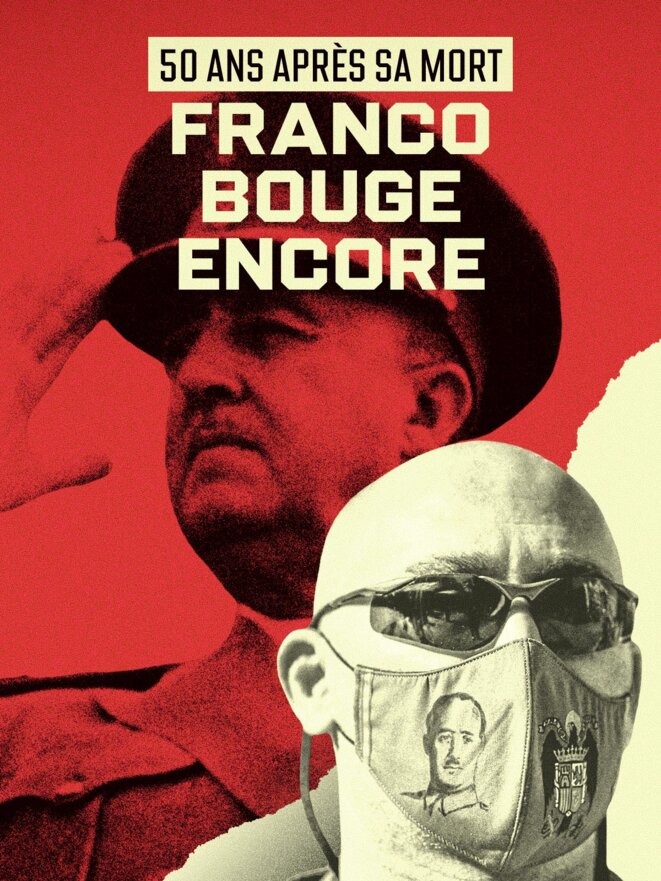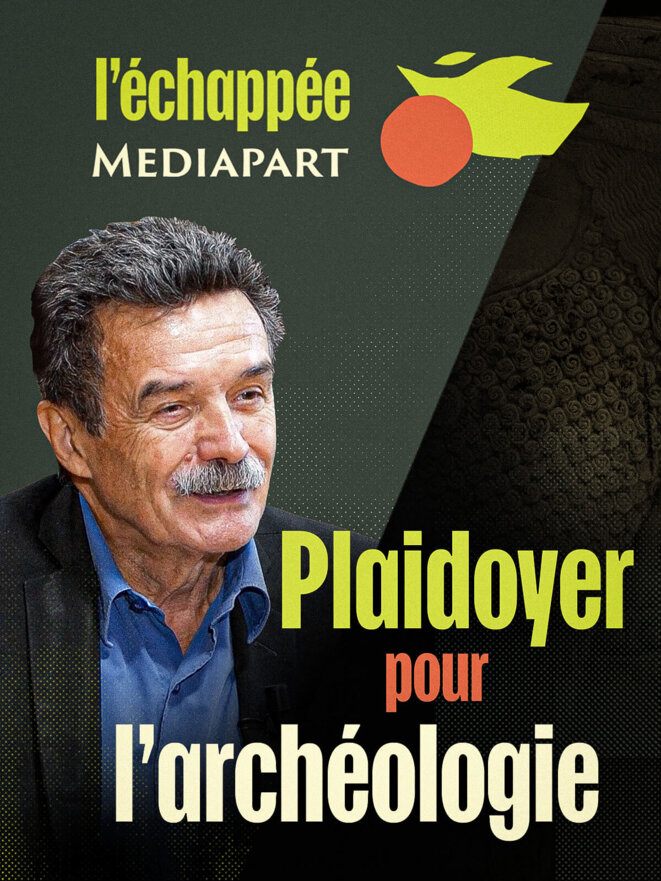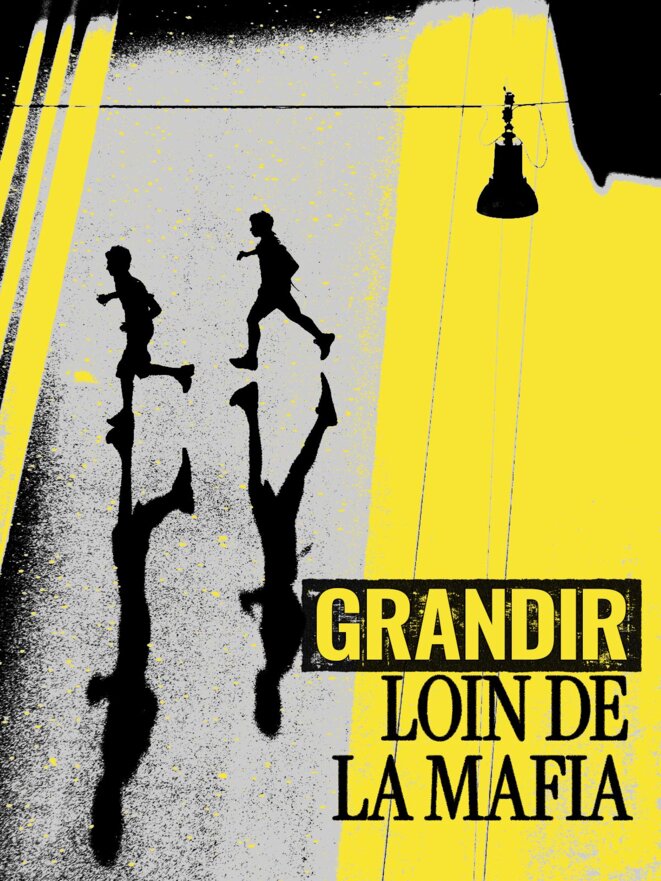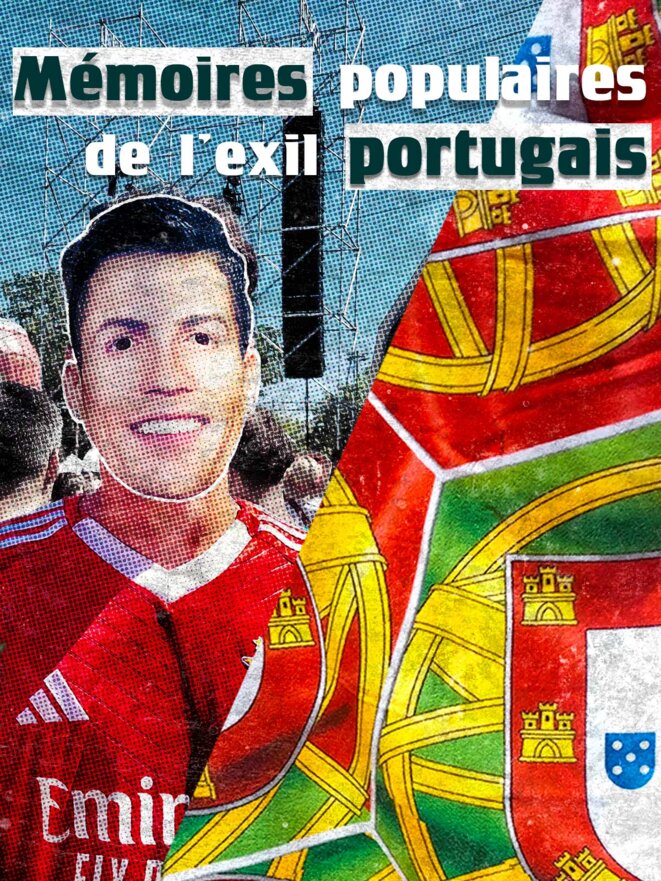À 58 ans, soit six ans avant sa retraite, Marcia craque déjà. Assistante sociale à l’Aide sociale à l’enfance, elle craque. Mais, surtout, elle raconte une carrière hachée comme le sont celles des femmes. Il y a eu toutes ces fois où elle a suivi les déménagements professionnels de son mari. Il y a eu la culpabilité qui a pesé sur elle au premier accouchement, quand elle est retournée au travail trois mois après. Puis il y a eu la galère qui a été la sienne lors de la deuxième naissance, quand elle a tenté de retourner au travail après trois ans de congé. Et puis, en fin de course, elle raconte la déception qui a été la sienne quand on lui a refusé le départ à la retraite anticipée, même si elle a commencé de travailler très jeune.
« J’ai 58 ans, je travaille à l’Aide sociale à l’enfance et je pleure presque tous les jours. Je ne sais sincèrement pas si je tiendrai comme ça encore six ans. Le travail social est devenu atroce, c’est devenu maltraitant autant pour les usagers que pour les travailleurs.
Le travail social, ça s’effondre comme l’hôpital, comme l’école, comme tous les services publics… Je n’ai pas la même usure que mes collègues qui n’ont travaillé que dans ce domaine, mais moi aussi je suis fatiguée.

Agrandissement : Illustration 1

Du côté de l’ASE, on manque de moyens, on n’a pas de lieu d’accueil pour les enfants, dans les familles ça dysfonctionne énormément. On reçoit beaucoup de violence de la part des parents puisqu’ils voient bien que le service public se dégrade et, en première ligne, c’est nous.
Puis, on est dans le Sud, on est en marge de la ville et on n’a pas de médecins-psychiatres dans les centres médico-psychologiques adolescents, ils sont dépassés. Dans ma collectivité, ils ne nous parlent qu’en chiffres en « taux de pénétration » de ci , « efficience » de ça, et si on n’est pas contents, on prend la porte. Le pire du management privé s’est imposé dans le public… Tout ça cumulé, c’est usant.
Je me demande au quotidien à quel moment, mon craquage m’enverra moi aussi grossir les rangs des fracassés de la vie.
En charge de publics fragiles, désargentés, cumulant les problématiques de santé physique et mentale, de logement ou éducatives, je me demande au quotidien à quel moment, mon craquage m’enverra moi aussi grossir les rangs des fracassés de la vie.
Moi, j’ai commencé à travailler tôt, en parallèle de mes études, dès 18 ans : sept trimestres avant la fin de mes 20 ans, trois entre mes 18 et mes 19 ans et les quatre trimestres de mes 20 ans, puisque j’ai travaillé toute l’année. Je vivais, j’étudiais et je travaillais dans le Sud et il m’arrivait, l’été, de monter en région parisienne pour trouver des jobs mieux payés. Je n’avais jamais de repos mais, en même temps, je ne me posais pas vraiment la question, il fallait que je travaille.
Ma mère est morte quand j’étais petite. Mon père, chef de chantier, est mort à 65 ans, avant d’avoir pu profiter de sa retraite, j’avais 20 ans. Avec mes quatre frères et sœurs, on s’est retrouvés très seuls. Et moi, je savais que je ne pouvais compter que sur moi-même pour m’en sortir.
Ma première année d’études en lettres, j’avais la bourse à l’échelon 9, le plus élevé. Mais mon père avait un cancer, je n’avais pas la tête aux études : j’ai raté mon année. Du coup, j’ai perdu mes bourses et j’ai dû travailler pendant l’année, en plus de mes jobs d’été en colonies de vacances et centres de loisirs. Pour financer mes études, je suis devenue pionne.
Après, j’ai voulu entrer à l’Institut de psycho-pédagogie médico-sociale (qui est devenu l’Institut régional du travail social) mais je n’ai pas pu, il fallait jouir de tout son temps. Avec mon travail de pionne à temps plein à côté, je ne pouvais pas. Alors j’ai fait une maîtrise de socio et l’été, je continuais d’avoir des petits jobs, j’ai nettoyé les toilettes des campings, j’ai travaillé à la Péniche Opéra, j’ai continué à bosser dans les colonies de vacances.
Ma maîtrise en poche, je suis partie à Paris en 1989, j’ai suivi mon conjoint qui voulait bosser dans l’édition et moi j’ai commencé à travailler en tant qu’employée de librairie et comme bibliothécaire. Puis je suis devenue adjointe dans un centre communal d’action sociale.
J’ai eu un premier enfant en 1993, Lucas, que j’ai inscrit à la crèche dès ses deux mois et demi pour reprendre mon travail. Le pauvre, il a chopé toutes les maladies, dont des bronchiolites asthmatiformes. Il devait prendre tout un traitement et on m’a dit qu’il fallait qu’il le prenne à vie. À ce moment-là, reprendre le travail, pour moi, c’était comme empoisonner mon fils. On me culpabilisait beaucoup. Je me souviens bien de ce médecin qui m’expliquait que je n’aurais pas dû le mettre à la crèche si tôt.
Puisque j’étais en congé parental et non pas au chômage, la porte de Pôle emploi m’a été fermée. C’est aussi comme ça qu’on exclut les femmes du marché du travail.
Puis, trois ans après, j’ai eu ma fille qui s’appelle Annouck. Elle est née aux Lilas et, tout de suite après, on a déménagé à Montpellier, mon mari était devenu enseignant et il avait été muté là-bas. Alors, là, je n’ai pas voulu la mettre à la crèche jeune et je me suis arrêtée trois ans pour m’occuper d’elle.
En 1999, à la fin de mon congé parental, j’ai négocié avec ma collectivité une fin de contrat. J’ai eu accès à des allocations de formation reclassement (AFR), pour que je puisse reprendre des études en travail social. J’ai fait la fameuse école que je voulais faire jeune, l’IRTS, pour une durée de deux ans.
Ensuite, j’ai trouvé du travail dans ma nouvelle branche et, depuis 2002, je travaille en tant que travailleuse sociale. J’ai été assistante sociale, dans la protection de l’enfance, auprès des agriculteurs âgés, en gérontologie, puis j’ai passé le concours pour travailler pour un département du Sud, pour lequel je travaille toujours.
Puis mon mari a démissionné de l’Éducation nationale pour s’installer en tant qu’agriculteur. Alors, pour l’aider, je me suis arrêtée pendant un an. J’ai beaucoup suivi mon mari, mon psy me le dit aussi.
En 2019, j’ai pris une disponibilité pour suivre mon mari qui est parti en Nouvelle-Calédonie, où il enseignait le français et le théâtre. Puis, je suis revenue auprès de ma collectivité en 2020, dans une autre spécialité, l’aide sociale à l’enfance.
Et là, mon mari a démissionné de l’Éducation nationale pour s’installer en tant qu’agriculteur. Alors, pour l’aider, je me suis arrêtée pendant un an. J’ai beaucoup suivi mon mari, mon psy me le dit aussi. Je me suis adaptée, tout le temps, tout le temps. Mais, en même temps, ça me faisait plaisir aussi. Aujourd’hui, je ne peux plus. Je suis fatiguée moralement et psychiquement par un travail très éprouvant et maltraitant pour ses salariés comme pour les usagers du service.
J’ai souhaité me renseigner sur la possibilité de prendre une retraite anticipée, vu que je totalise sept trimestres cotisés avant la fin de mes 20 ans. Normalement, au bout de cinq trimestres cotisés avant l’année des 20 ans, on peut partir plus tôt.
Quelle n’a pas été ma surprise d’entendre la conseillère de la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail me dire que, pour les carrières longues, les périodes de chômage étaient comptabilisées différemment. Seuls quatre trimestres peuvent être retenus dans le cadre des carrières longues, même si cette période était mise à profit pour une formation diplômante. Donc mes deux ans de formation financée par les AFR, ça ne compte pas.
Du coup, je ne peux pas partir à 60 ans, je dois attendre 64 ans. Au final, j’aurais travaillé 46 ans quand je partirai à la retraite. »