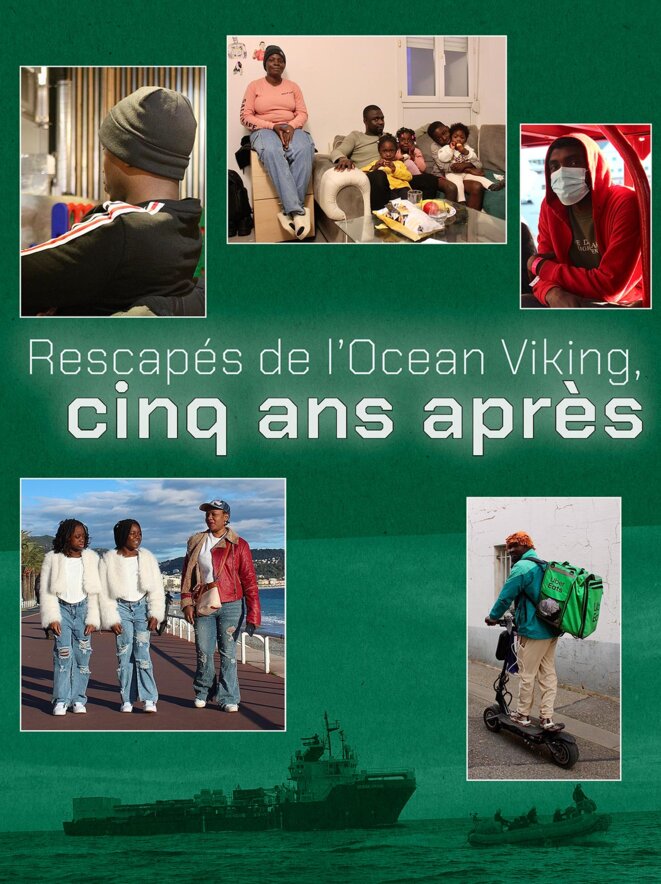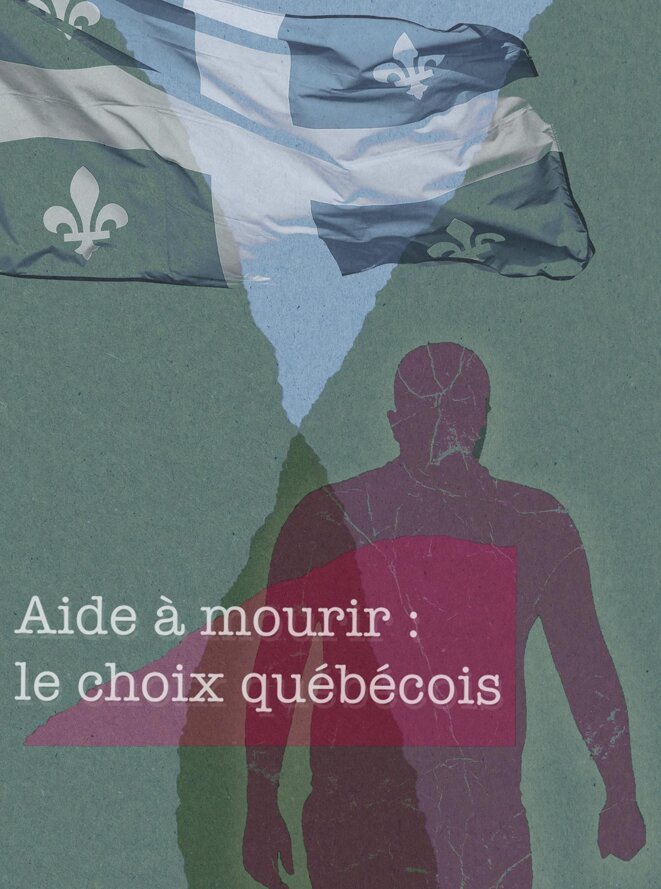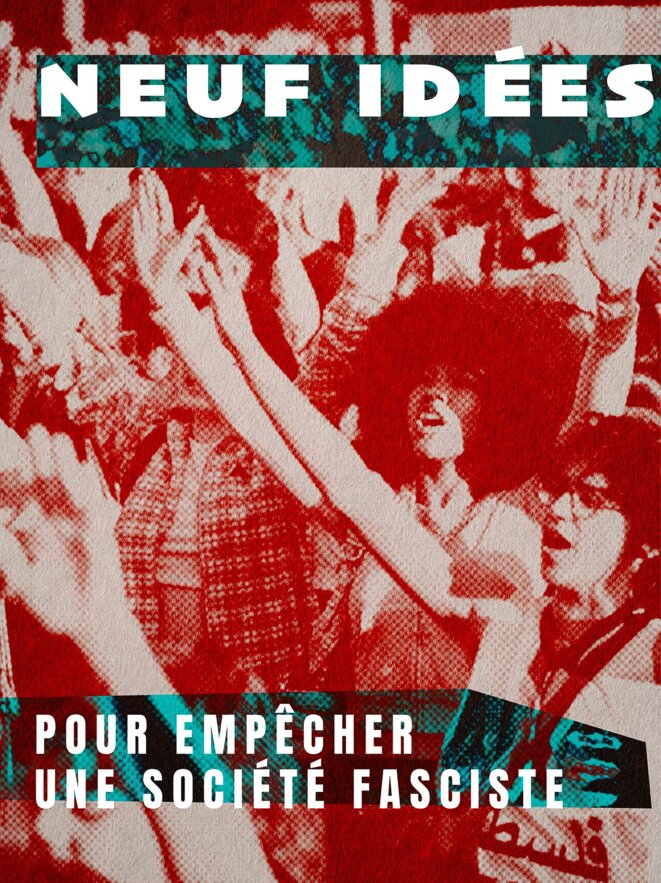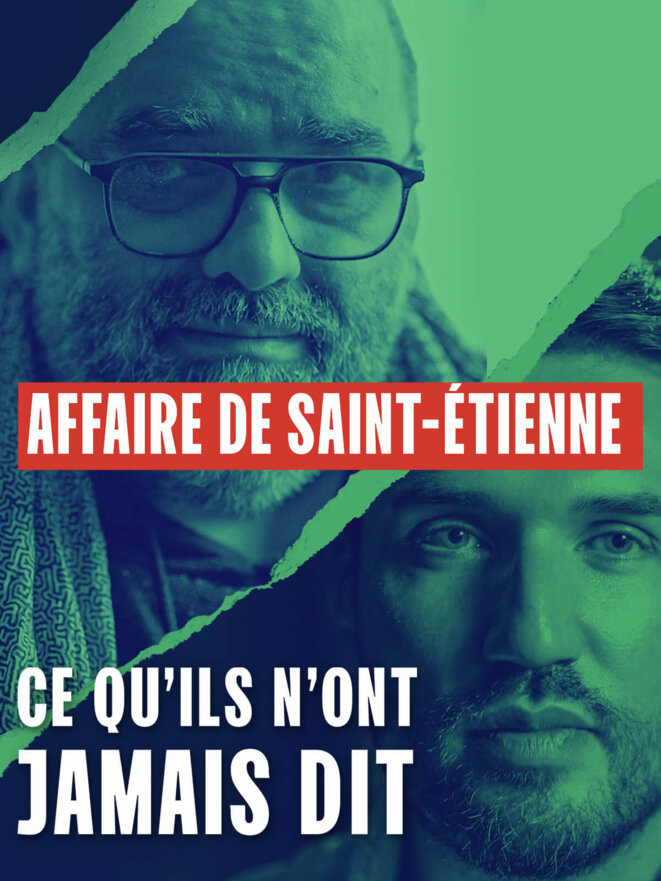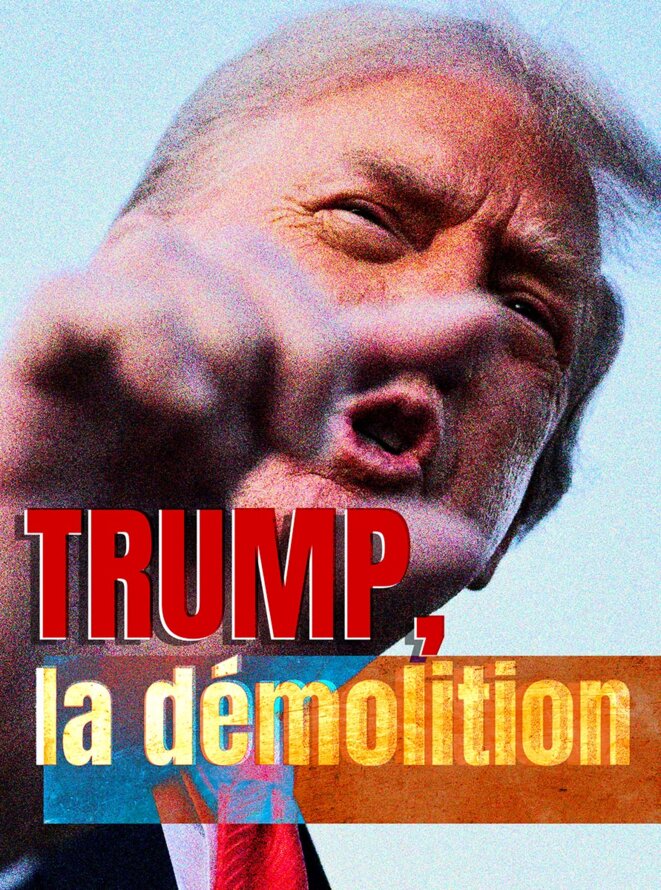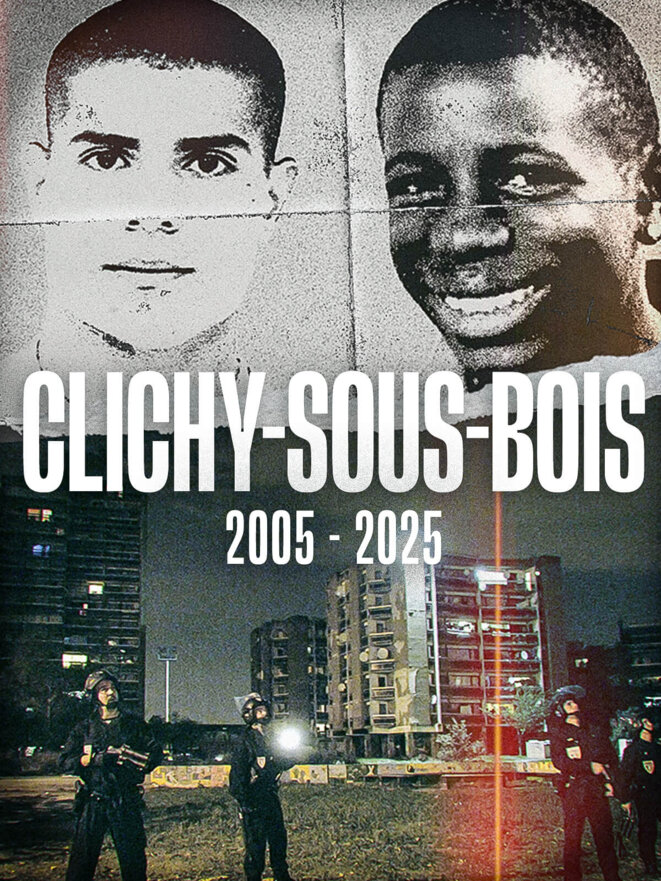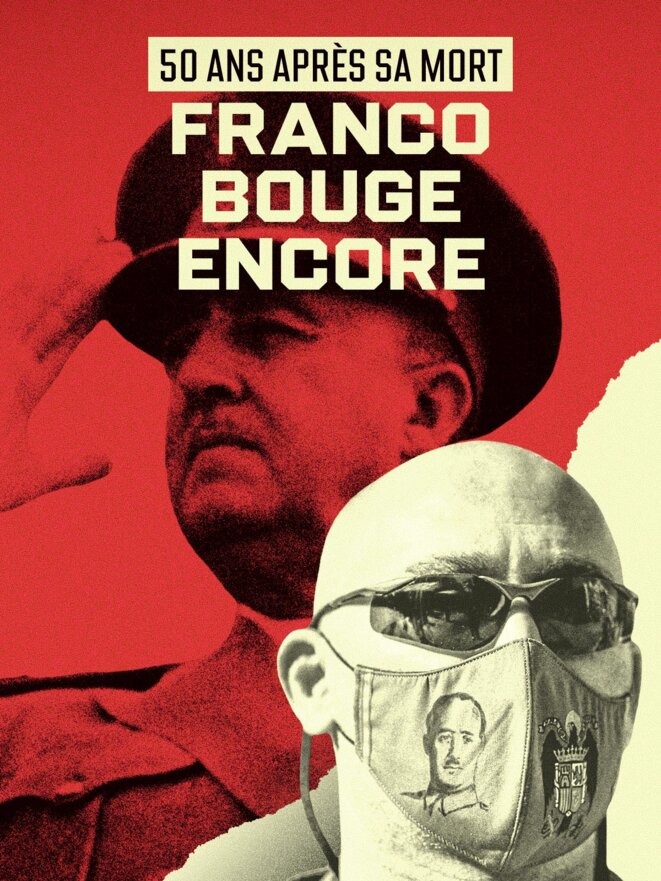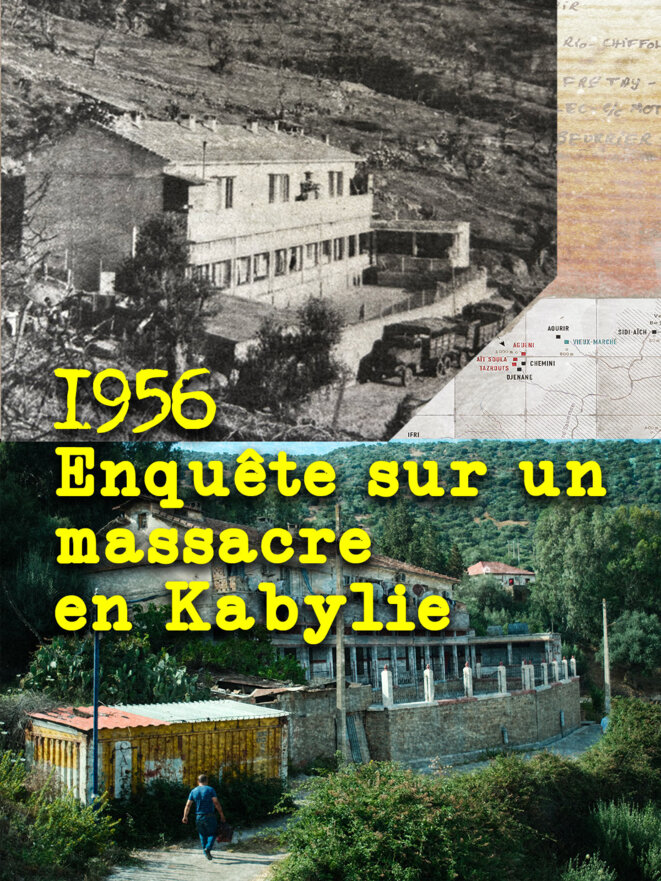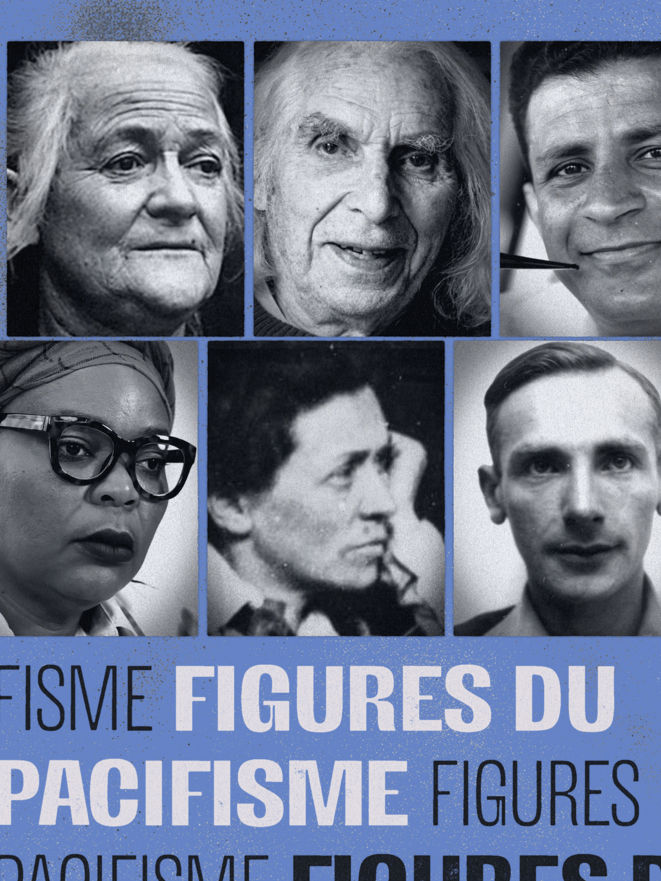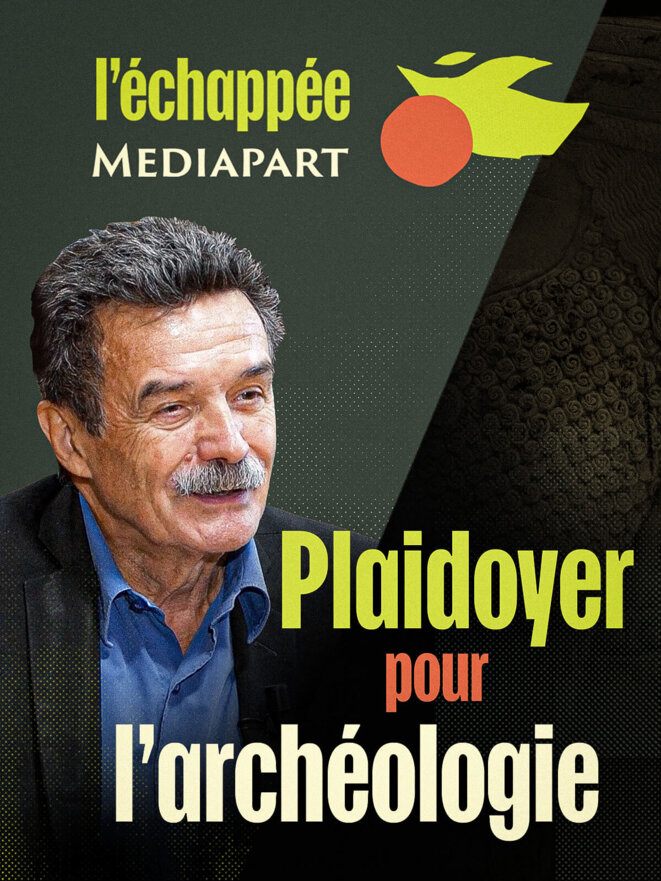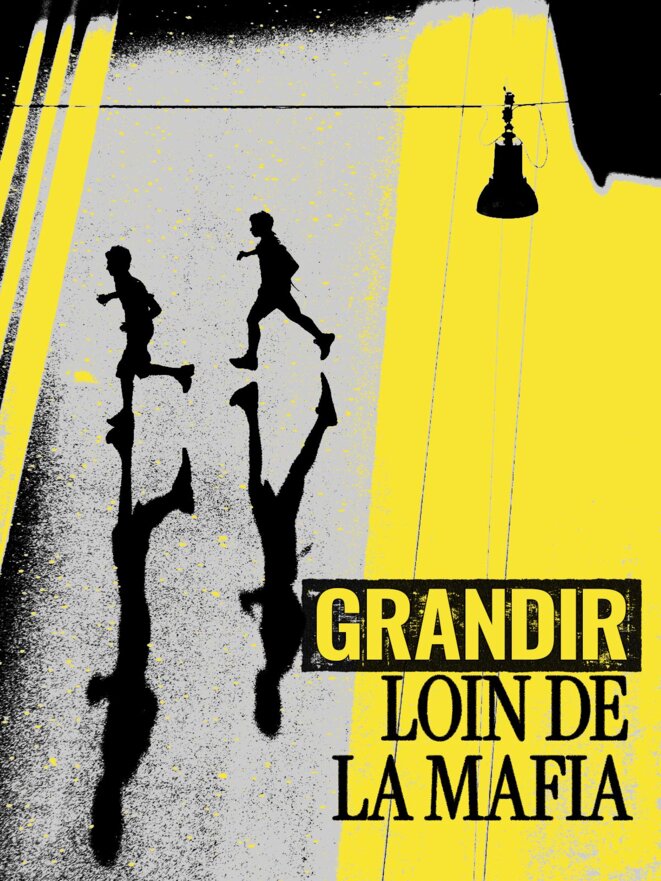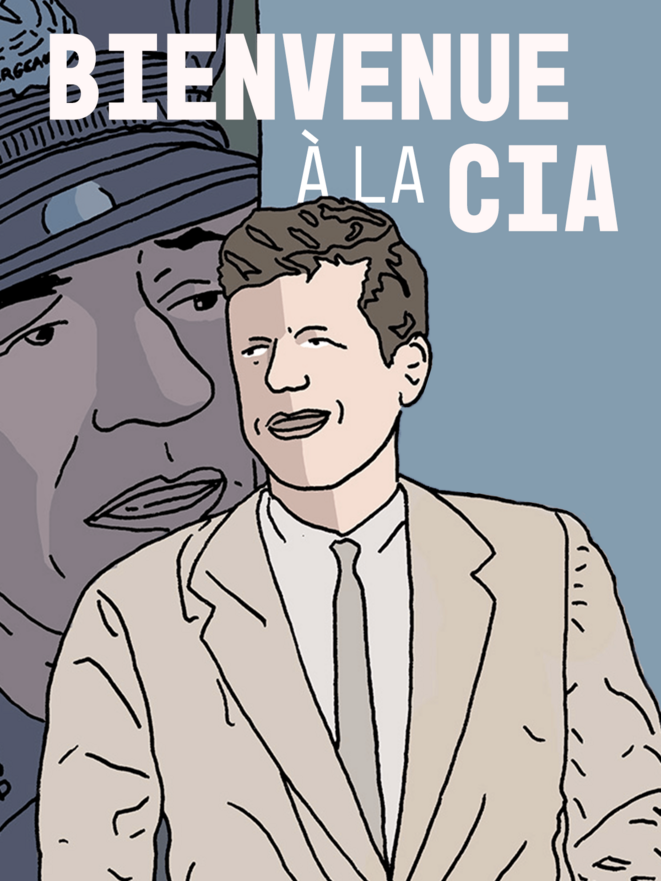Deux nouveaux drames viennent d’endeuiller coup sur coup la mer Méditerranée : au moins 36 migrants sont morts dans le naufrage de leur embarcation au large de la Libye le 6 mai. Tassés sur un bateau abîmé et surchargé, ils venaient de quitter le continent africain dans l’espoir de rejoindre l’Europe. Une semaine plus tard, un navire a coulé à quelques kilomètres de l’île italienne de Lampedusa, le 12 mai. Le but était proche, mais tous ne l’ont pas atteint : seuls 200 des 400 passagers auraient survécu.
Quelques jours auparavant, plus à l’est, un bateau a chaviré au large de l’île de Samos en mer Égée dans la nuit du 4 au 5 mai faisant au moins 22 morts. D’autres, parmi lesquels des femmes et des enfants, sont décédés le 21 janvier aux abords de l’île grecque de Farmakonisi. L’ouest de la Méditerranée n’est pas épargné : des migrants ont péri noyés le 6 février en tentant de contourner – par la mer – la frontière séparant le Maroc de Ceuta, l’une des deux enclaves espagnoles au Maghreb. En vingt ans, les morts se comptent par milliers : ils seraient près de 25 000 à avoir perdu la vie dans ce cimetière marin.

Agrandissement : Illustration 1

Ces conditions ne freinent pas les migrants confrontés au verrouillage progressif des voies légales d’accès à l’Union européenne. L’une des routes migratoires transméditerranéennes semble particulièrement fréquentée ces dernières semaines. Elle relie les côtes libyennes à la Sicile en Italie. Pourquoi celle-ci ? Parce que les départs s’y font plus facilement et que les arrivées y sont en principe plus sûres. Le chaos régnant en Libye où le pouvoir central n’exerce qu’une autorité de façade favorise le développement de réseaux mafieux, tandis que les contrôles officiels s’amenuisent. Avec la complicité d’une police locale corrompue, l’économie du passage (environ 1 500 euros la traversée sur une embarcation de fortune, selon l’Organisation internationale pour les migrations) explose car la demande s'intensifie.
L’éclatement et la persistance de conflits de la Syrie à la Corne de l’Afrique incitent les migrants à quitter durablement leur pays d’origine. Les difficultés dans les pays de transit (insécurité, racisme) les conduisent à tenter leur chance en Europe. Les jours de météo clémente donnent le signal du départ vers l’Italie, destination la plus proche géographiquement et rendue moins périlleuse depuis l’organisation de secours en mer. Entre janvier et avril 2014, selon Rome, quelque 22 000 personnes, principalement parties de Libye, y ont débarqué, soit dix fois plus qu’au cours de la même période un an plus tôt.
Les naufrages d’octobre 2013, qui ont fait plusieurs centaines de morts, ont changé la donne. Moins du côté de l’Union européenne que de la part de l’Italie, déterminée à montrer qu’elle a pris la mesure de la tragédie à ses portes. Dans le sillage de ces événements, un dispositif national de sauvetage a été mis en place sous l’autorité de la marine militaire.
De nombreuses vies ont pu être sauvées dans le cadre de cette opération baptisée Mare Nostrum. En mars, en trois jours, plus de 4 000 personnes ont été transportées saines et sauves dans des ports en Sicile. En avril, en quatre jours, 6 000 autres ont été secourues alors qu’elles se trouvaient à bord de plus de 40 bateaux. Selon la porte-parole du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Melissa Fleming, la plupart de ces personnes, passées par la Libye, en provenance de Syrie, d’Érythrée, de Somalie, du Nigeria, de Gambie, du Mali et du Sénégal, ont fui les violences, les persécutions et les conflits.

Agrandissement : Illustration 3

Devant la chambre des députés, le 7 mai à Rome, la ministre de la défense Roberta Pinotti a déclaré que 27 790 personnes au total, dont 3 034 mineurs, ont été prises en charge depuis le lancement, le 18 octobre 2013, de Mare Nostrum. Et que 200 « passeurs » ont été arrêtés. Ce bilan, soutenu par une partie de la gauche ainsi que par l’électorat catholique à la suite de l’appel du pape François, ne satisfait pas Matteo Salvini, le chef du parti anti-immigration de la Ligue du Nord, qui demande l’arrêt de l’opération, au motif que celle-ci créerait un « appel d’air ». « Les citoyens italiens finissent par financer les passeurs de clandestins et une invasion de nos côtes », fustige-t-il.
Le chef de la marine militaire, l’amiral Giuseppe De Giorgi, a réfuté, lors d’une récente conférence de presse, cette affirmation propagée par l’ensemble des partis de droite à la faveur de la campagne pour les élections européennes. « Il n’y a pas davantage d’immigrés, il y a simplement moins de morts », a-t-il assuré.
L’apparent consensus laisse toutefois transparaître de nombreuses incertitudes. Mis à part la communication efficace sur les vies sauvées, peu d’informations filtrent sur la réalité de cette opération militaro-humanitaire, prévue à l’origine pour ne durer que quelques mois. Son organisation opaque et son coût exponentiel (estimé entre 12 et 14 millions d’euros par mois par un groupe de sénateurs italiens) font l’objet de spéculations. De même que ses motivations cachées. Des doutes planent sur son cadre légal.
Seuls les contours sont connus. Selon la ministre de la défense, 782 marins italiens sont impliqués. Ils patrouillent à bord de cinq navires qui naviguent par roulement avec le soutien de carabinieri (police militaire), de garde-côtes, de policiers et de personnels des forces aériennes. Leur zone d’intervention, le canal de Sicile, est comprise entre les côtes italiennes et les eaux internationales longeant le sud de la Tunisie jusqu’à la Libye. Les réponses aux questions qui fâchent restent lacunaires. L’armée est-elle à même de mener des interventions humanitaires ? Dans quelles conditions ont lieu les sauvetages et les « interceptions » en haute mer ? Les droits des exilés sont-ils respectés ? Que deviennent les rescapés une fois qu’ils sont ramenés à terre en Italie ?

Agrandissement : Illustration 4

«L’un des buts cachés de Mare Nostrum est le refinancement du lobby militaro-policier-industriel»
Quelques rares chercheurs travaillent sur le sujet. C’est le cas de l’Italienne Martina Tazzioli, spécialiste des migrations en Méditerranée après la révolution tunisienne. Elle conduit actuellement des entretiens avec les différentes autorités représentées dans Mare Nostrum et a accepté d’en dévoiler des éléments à Mediapart.

Agrandissement : Illustration 5

L’une des caractéristiques de l’opération est que l’aspect humanitaire se double d’une logique militaire de surveillance des frontières et des migrations. Sauver des vies pour mieux contrôler – et empêcher – les départs. Les innovations et redéploiements technologiques visent à quadriller la zone, déjà militarisée à haute dose, afin de localiser le plus en amont possible les migrants potentiels. L’urgence humanitaire sert de prétexte à l’installation de nouveaux radars recueillant les informations nécessaires à l’identification des routes migratoires. Ces données sont utilisées pour faire pression sur les pays de départ et de transit pour qu’ils découragent les traversées et qu’ils acceptent, selon les accords signés avec l’Italie, le renvoi des migrants passés par leur sol – sont concernés en premier lieu l’Égypte, la Tunisie et le Nigeria.
Certains équipements sont utilisés pour la première fois : c’est le cas des drones (de type Predator de l’entreprise américaine General Atomics) qui jamais encore en Italie n’avaient servi à contrôler des déplacements de population. En plus des navires, sont réquisitionnés des hélicoptères, un véhicule amphibie et des avions. Tout en testant son matériel, l’Italie expose ses besoins en matière de maintenance : tel bâtiment maritime devrait être rénové, tel autre pourrait être remplacé par du matériel plus performant.
« L’un des buts cachés de Mare Nostrum est le refinancement du lobby militaro-policier-industriel », estime Salvatore Palidda, professeur de sociologie à l’université de Gênes. Auteur de Migrations critiques, repenser les migrations comme mobilités humaines en Méditerranée (Karthala, 2011), il inscrit ces développements dans la « militarisation » de la Sicile résultant de l’installation de bases américaines et de l’OTAN et souligne qu’ils correspondent à une recherche de fonds auprès des institutions européennes. Avec un résultat pour l’instant limité : la Slovénie serait le seul pays à avoir jusqu’à présent concrètement participé.
L’investissement de l’armée n’est pas sans conséquence. Une gestion spécifique des migrations se met en place. Dans le cadre d’accords bilatéraux entre l’Italie et la Libye, ainsi que du protocole européen EUBAM, des soldats italiens forment des personnels libyens à la surveillance des frontières. Des équipements militaires leur sont fournis. « Par ces méthodes, l’Italie externalise de facto la surveillance de ses frontières et abandonne le respect des droits des migrants à la discrétion de la Libye qui n’a pas signé la convention de Genève », résume dans un récent article l’avocat italien, spécialiste du droit d’asile à l’université de Palerme, Fulvio Vassalo Paleologo. Il dit observer un certain parallélisme entre les techniques déployées par l’UE pour lutter contre l’immigration irrégulière et celles pistant les activités terroristes.
Dans une note de novembre 2013, le Conseil de l’Union européenne souligne les difficultés posées par le recours à l’armée comme réponse à des questions migratoires et d’asile. En termes d’image, avec le risque qu’une telle opération soit comparée par les médias et les opinions publiques à une « guerre contre les réfugiés ». Mais surtout en termes de droit. Les rédacteurs du rapport doutent que l’armée soit compétente pour appliquer la convention de Genève de 1951 destinée à protéger les demandeurs d’asile. Ils estiment que les interventions en haute mer nécessitent des clarifications juridiques.
Qui, dans ces eaux, est responsable de quoi ? Sauver une embarcation en péril ayant déclenché un appel à l’aide est une obligation consacrée par divers traités internationaux organisant le droit maritime. Mais à quelles conditions un navire de guerre d’un pays peut stopper des bateaux de pêche et exiger qu’ils rebroussent chemin ? Les radars servent-ils à détecter les naufragés ou à « intercepter » les migrants le plus en amont possible dans le but qu’ils fassent demi-tour ? Le flou entretenu entre les opérations de secours (« SAR » pour Search and rescue) et les « interceptions » (à connotation répressive) n’est pas anodin.
La marine italienne affirme avoir cessé de refouler les embarcations, comme elle l’a fait avec la Libye avant de se le voir interdire par une décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 23 février 2012 (affaire Jamaa et autres c. Italie) condamnant les expulsions collectives. Mais il semble, dans le même temps, qu’elle s’autorise à les arrêter, y compris hors des eaux territoriales italiennes, en faisant appel aux autorités libyennes et tunisiennes pour que celles-ci viennent chercher les « indésirables ». Entre 2 000 et 5 000 personnes auraient ainsi été récupérées ces derniers mois. Ramenées à leur point de départ, elles n’ont le plus souvent pas été laissées libres de leur mouvement.
Plusieurs ONG dénoncent des emprisonnements arbitraires. Amnesty international révèle le cas d’un refoulement, ayant eu lieu en août 2013 en toute illégalité selon elle, après que les autorités italiennes ont demandé à un navire commercial de secourir une embarcation en péril dans les eaux internationales. Les passagers auraient été débarqués en Libye, puis emprisonnés, sans possibilité de demander l'asile. Un article du Globe and Mail décrit quant à lui la violence des conditions de détention en Égypte imposée à des survivants d’un naufrage à proximité de ses côtes. La législation européenne interdit pourtant strictement le renvoi de personnes dans des pays où leur vie est en danger.
«Les réfugiés risquent de se voir refuser l'accès à un examen équitable de leur demande d'asile»
En haute mer, une fois que l’« interception » par la marine italienne a eu lieu, le processus d’identification des migrants sur les bateaux de Mare Nostrum soulève de nombreuses interrogations. Les risques de violation des droits sont sous-jacents. Des entretiens sommaires sont réalisés à bord, soit par des policiers, soit par des militaires. Les personnes déclinent leur nom, leur nationalité, leur âge. Dans certains cas, empreintes digitales et photos d’identité sont prises. Le consentement pourrait faire défaut. Les traducteurs manquent.
L’avocat Fulvio Vassalo Paleologo, qui a eu l’occasion de rencontrer des demandeurs d’asile à leur arrivée, regrette l’absence d’accès à l’information concernant la protection des réfugiés. Amnesty international, dans une note au Conseil de l’Europe, s’inquiète de la non-individualisation des procédures et s’interroge sur l’opportunité de la présence annoncée de personnel libyen. Ce moment est utilisé par les autorités italiennes pour détecter les « trafiquants », c’est-à-dire ceux qui d’une manière ou d’une autre touchent de l’argent dans le cadre de la traversée. Les défenseurs des droits des étrangers craignent que le « tri » ne se fasse au mépris des règles internationales.

Agrandissement : Illustration 6

Les conditions de vie à bord sont aussi celles de l’urgence. Certains rescapés y passent trois, quatre jours, car les bateaux ne reviennent à quai qu’une fois qu’ils ont fait le tour des embarcations en péril. Hommes, femmes et enfants finissent entassés à l’extérieur, sur le pont, sur des bâches, à la merci des intempéries. Ils reçoivent le minimum vital, à savoir de l’eau et un peu de nourriture. Des médecins militaires sont supposés leur venir en aide. Les familles ont peur d’être séparées. Le centre d’accueil de Lampedusa étant fermé (depuis la diffusion d’une vidéo-choc sur le traitement des personnes retenues), les ports siciliens d'Augusta, de Pozzallo, d'Empedocle et de Catane prennent le relais.
Une fois débarqués sous le contrôle des soldats, la réception des migrants est assurée par des représentants des autorités civiles, de l’OIM, du HCR et d’ONG comme Save the Children et la Croix-Rouge. Des avocats et des psychologues les attendent sur place. Les conditions pour demander l’asile sont là encore problématiques : les dossiers sont examinés par la police, plutôt que par des officiers indépendants. Des expulsions (par avion) sont organisées vers les pays de transit et d’origine. Mais il est difficile de savoir à quel rythme et selon quels critères.
Nigérians, Tunisiens et Égyptiens sont dans le collimateur, en vertu des accords de réadmission en vigueur. Amnesty international a récemment dénoncé « le risque que des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants interceptés en mer dans le cadre de Mare Nostrum se voient refuser l’accès à un examen équitable et satisfaisant de leur demande ».
Les personnes autorisées à demander l’asile sont réparties en Sicile, dans des centres ouverts. Pour faire face à leur afflux, des mas de campagne, des maisons familiales, des couvents, des maisons de repos et même des résidences pour malades psychiatriques ouvrent leurs portes et mettent à disposition des lits (en échange de rémunération), selon un article de La Repubblica, qui raconte que les migrants évitent de donner leurs empreintes (en recouvrant leurs doigts de vernis) pour ne pas être renvoyés.
Instrumentalisant l’enjeu migratoire, comme le faisait en son temps Mouammar Kadhafi, le ministre de l’intérieur libyen par intérim, Salah Mazek, vient de menacer l’UE de « faciliter » le départ de « flots de migrants » si elle ne prête pas davantage main forte à la Libye. « La Libye a payé le prix de la présence de centaines d’Africains subsahariens porteurs de maladie, de crime et de drogue (…). Maintenant, c’est au tour de l’Europe de payer », a-t-il lancé lors d’une conférence de presse à Tripoli le 10 mai.
La récupération politique n’a pas de frontière. Au début du mois d’avril, le ministre italien de l’intérieur Angelino Alfano a lui aussi lancé un appel à Bruxelles, estimant entre 300 000 et 600 000 le nombre de candidats à l’émigration susceptibles de quitter prochainement les rives nord-africaines. En l'absence d'aide, a-t-il assuré, les autorités de son pays ouvriront les frontières et laisseront passer les réfugiés dans les autres États membres.
Lors du conseil européen des 26 et 27 juin, les chefs d’État et de gouvernement devraient se positionner sur la nécessité d’accroître les moyens techniques et financiers accordés aux pays européens les plus directement concernés, comme l’Italie, la Grèce et l’Espagne. La « coopération » avec les pays du sud de la Méditerranée devrait également être au centre de leurs préoccupations. Par ce terme, certains dirigeants entendent davantage de rapatriements.
Pour les ONG, comme celles rassemblées dans Migreurop, la stratégie visant à bloquer et renvoyer les exilés, outre qu'elle contrevient fréquemment au droit international, est contre-productive dans la mesure où elle les pousse à choisir des routes alternatives, toujours plus longues et dangereuses. Dénonçant la « militarisation » des frontières et l'« externalisation » de leur gestion à des pays tiers, elles appellent l'UE à revoir, dans le sens d'une plus grande ouverture, sa politique d'asile et d'immigration, afin de faciliter les entrées légales.